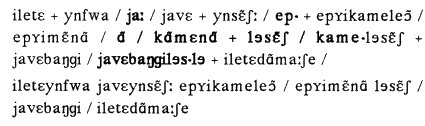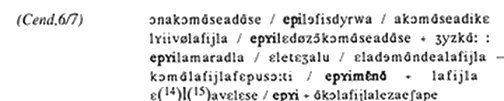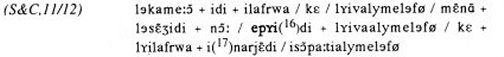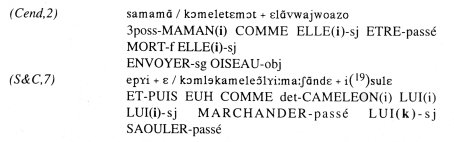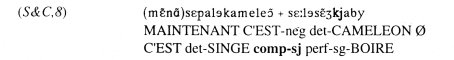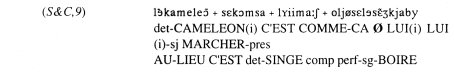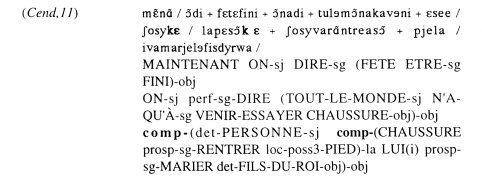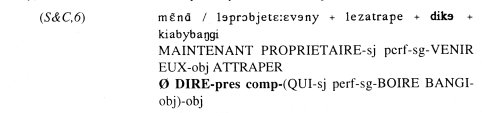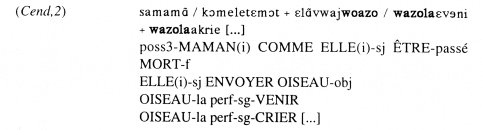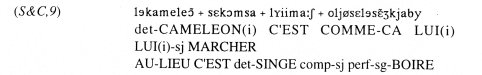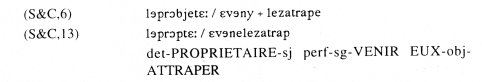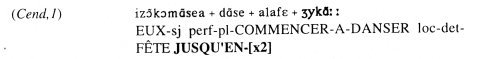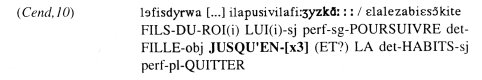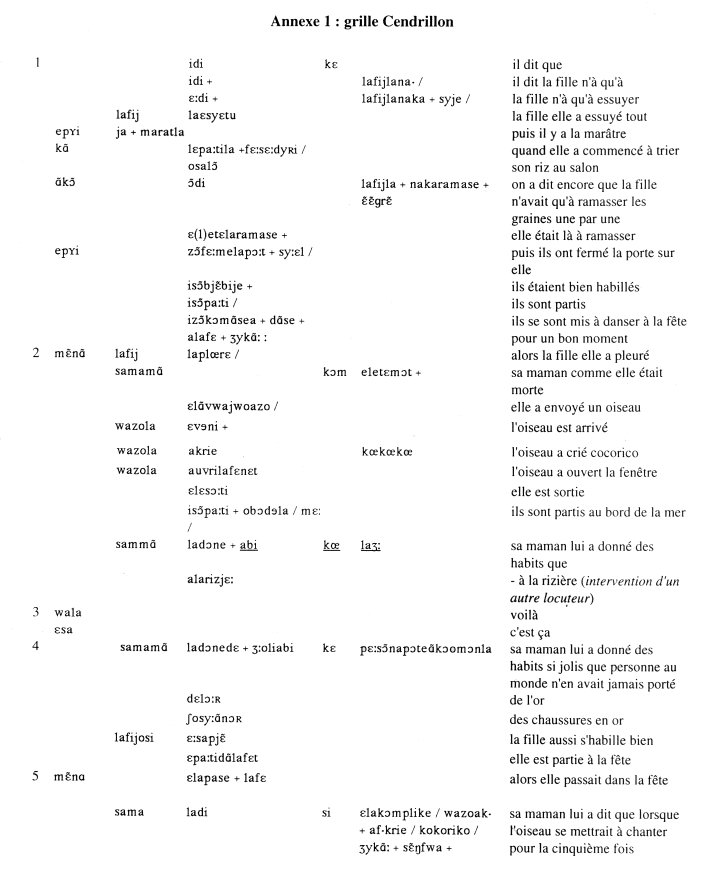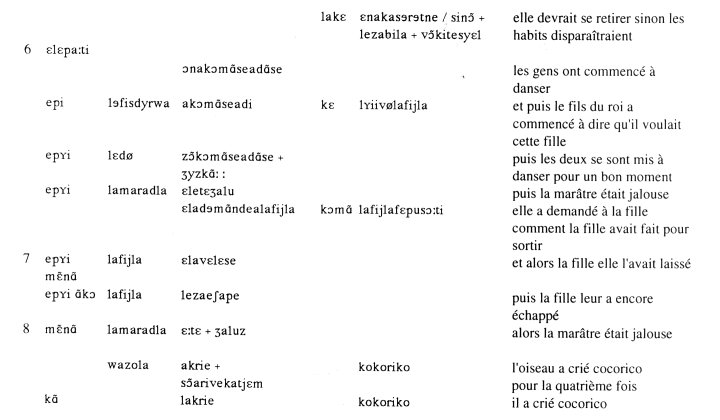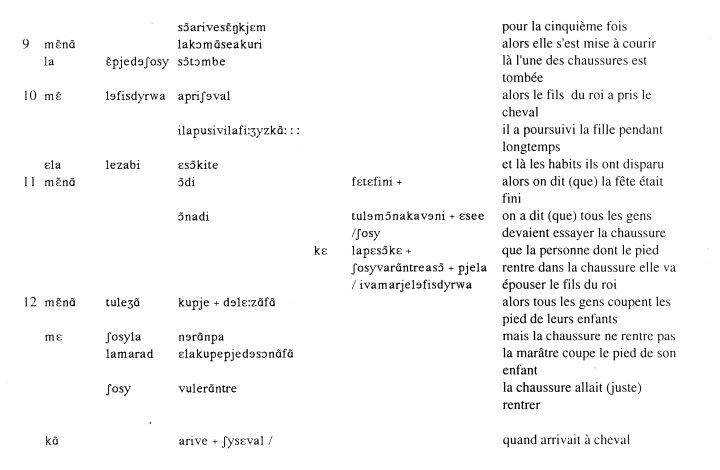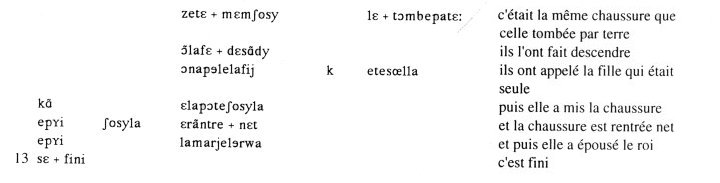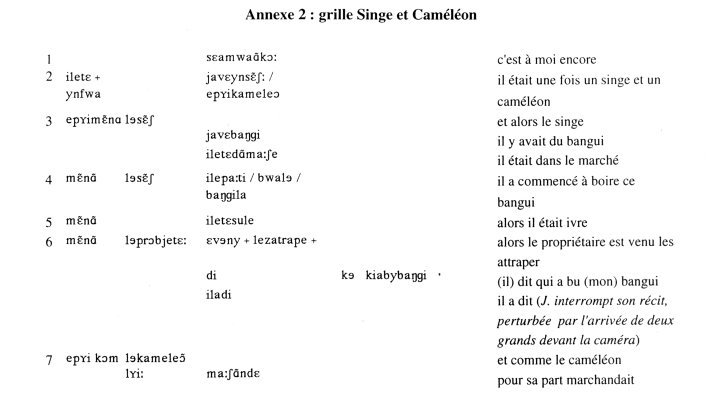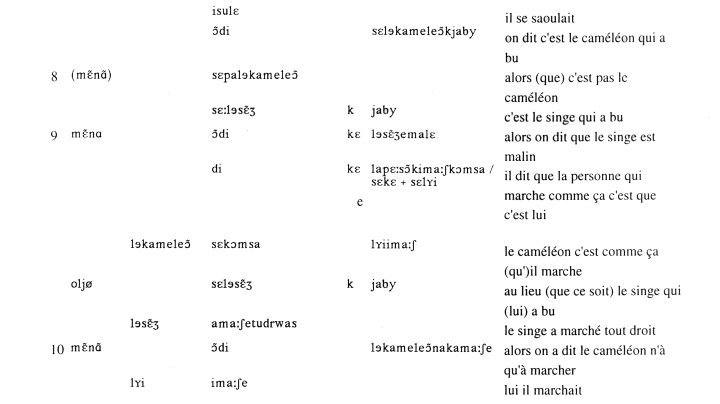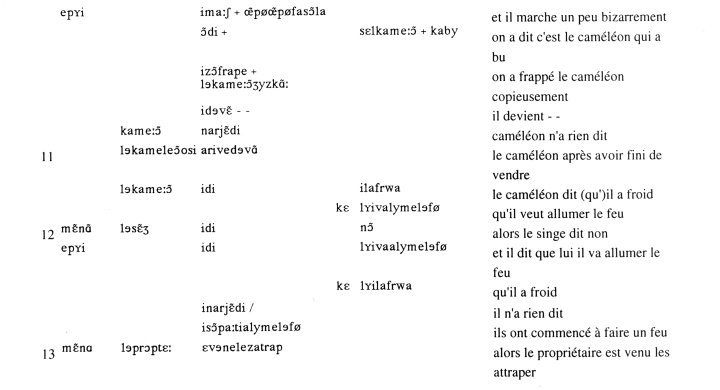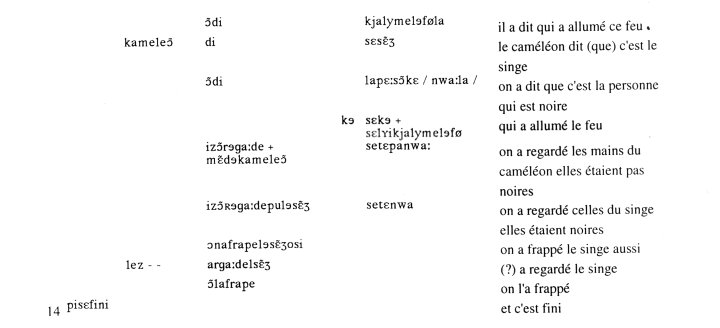CENDRILLON, SINGE ET CAMÉLÉON
:
CARACTÉRISTIQUES DU RÉCIT
EN ABIDJANAIS
Katja PLOOG
ERSS-Université de Bordeaux
La situation abidjanaise est célèbre en
sociolinguistique, du moins l’a-t-elle été dans les années
70 : le français y a subi des restructurations majeures et se trouve
largement vernacularisé aujourd’hui. L’objet des pages suivantes
sera d’illustrer, à partir de deux narrations-type, les stratégies
d'élaboration syntaxique et discursive caractéristiques des
récits d'enfants abidjanais. En guise de conclusion, nous proposerons
quelques pistes de réflexion pour approcher la zone de transition
entre français parlé et non-standard.
1. Le corpus
1.1. Le français à Abidjan : données
sociolinguistiques
À l’occasion de la colonisation, le français s’est immiscé
dans le plurilinguisme ivoirien qui comptait alors plus d’une soixantaine
de langues, la plupart du groupe Niger-Congo. Plus récemment, la
croissance urbaine a généré une hétérogénéité
supplémentaire des hommes et de leurs échanges, qui a été
propice au changement linguistique dans le cas d'Abidjan. Puis, une identité
nouvelle est née autour de l’ancienne langue coloniale : alors que
le français était "seulement" le supervéhiculaire
avant l’indépendance du pays, la foule de néo-urbains, aussi
hétérogènes que peu instruits, à la fois dans
le besoin de communiquer et soumis à la compétition urbaine,
l’ont plébiscité comme véhiculaire principal ; sa
réinterprétation par une communauté émergente
a provoqué des restructurations à tous les niveaux de la
langue1. Les enfants abidjanais de l'an 2000
acquièrent comme première langue de moins en moins souvent
leur langue ethnique, mais ce nouveau vernaculaire que j’appellerai
abidjanais
- par souci de clarté et bien que les locuteurs eux-mêmes
ne le nomment généralement pas de façon différentielle2.
Bien que beaucoup de traits du français parlé se retrouvent
en abidjanais et que le fonds lexical soit très majoritairement
à base française (exception faite d’un petit nombre d’emprunts
concentrés dans des champs sémantiques spécifiques),
l’abidjanais reste parfois quasiment opaque au francophone non local.
Le corpus d’étude a été recueilli
auprès d’une population d’enfants entre 8 et 14 ans ayant grandi
dans l’agglomération abidjanaise, composée d'individus non
scolarisés, déscolarisés,
et d'écoliers réguliers3. Tous pratiquent le "français"
— l’abidjanais — de façon courante en dehors de l’école,
en tant que langue seconde ou première, parfois exclusive.
Le corpus global de 30 heures comporte environ 3 heures
(nets) de récits.
1.2. Le récit comme type d’interaction
On définira le récit comme discours monologué
où le locuteur ne cède son tour de parole que lorsqu’il juge
lui-même sa tâche de production accomplie. On propose aux enfants
de raconter des histoires à la caméra en leur laissant la
maîtrise des paramètres discursifs (type, thème, longueur
du récit) et interactionnels (initiative, contexte). Nous avons
choisi de ne pas intervenir dans une narration en cours ; par conséquent,
un certain nombre de problèmes de compréhension n’a pu être
résolu de façon satisfaisante. Les récits recueillis
dans le cadre de notre enquête sont toujours produits à l’intention
de l’enquêtrice4, l’enregistrement est explicite et omniprésent.
Nous avons pris le parti de subdiviser les récits
recueillis en deux types de discours : les récits de vie
et les fictions. Si le récit prend pour temps d’énoncé
un non-présent (Benveniste 1965), le récit de vie se réfère
à une portion de temps antérieure au moment d’énonciation
et la fiction relate une portion de temps situé sur l’axe parallèle
de l’imaginaire. Mais pour nous, la distinction se justifie avant tout
par la qualité différente du référent sous-jacent,
sa source respective et la relation entre l’énonciateur et le protagoniste
de l’histoire. Le récit de vie, avec une source événementielle,
est ainsi propice à la production autant de premières personnes
que de troisièmes personnes, alors que la fiction privilégie
les troisièmes personnes et repose sur une inspiration linguistique.
Dans le cas des récits de vie, le focus est mis sur le locuteur
lui-même, qui se livre à l’enquêteur, et/ou se met en
avant ; les fictions mettent à l’épreuve en première
ligne le savoir-faire du narrateur.
Nos propos se limiteront aux récits fictionnels.
1.3. Le profil interactionnel des locuteurs
La pression exercée sur les écoliers par
les conditions d’enquête — menée dans le cadre de l’école,
où ils ne pouvaient raisonnablement refuser de participer — générait
un sentiment d’insécurité (momentané). À l’inverse,
la situation d'enquête avec les enfants de la rue était banale
(ou : routinière), ils m’approchaient seulement lorsqu’ils l’avaient
décidé eux-mêmes5. Volontaires, ils étaient
maîtres de leur intervention et jouissaient donc d’une relative sécurité
linguistique (momentanée). Toutefois, le rapport de force social
place les locuteurs illettrés en situation d’insécurité
(permanente). Tous étaient donc à la fois locuteurs légitimes
et illégitimes, dans une projection socio-temporelle différente,
en assumant la pluralité des normes à partir de leur compétences
linguistiques, mais aussi narratives — car tous étaient valorisés
dans leur rôle de locuteurs "experts" des contes et petites histoires
drôles qu’ils nous ont livrés au cours de l’enquête.
2. L’approche de récits non standards
2.1. La locutrice et les textes d’étude
Deux récits type sont joints en annexe, produits par une fillette
de huit ans, Jeanne, résidant avec sa grande
sœur (12 ans) dans un centre pour enfants de la rue en attendant d’être
rapatrié chez le père au Congo. Les deux ont été
recueillies dans la rue quelques temps après le décès
leur mère. Contrairement à la grande sœur, qui se souvient
du lingala et du voyage qui a conduit sa mère à Abidjan,
Jeanne a grandi dans la ville et ne parle que le français, sans
jamais avoir été scolarisée. Elle nous approchait
régulièrement pour nous proposer une nouvelle histoire. Car
malgré son jeune âge, Jeanne est experte en contes : elle
en connaît un grand nombre et les raconte avec le sérieux
propre aux professionnels, sérieux qui défie parfois l’effet
drôle voulu par la chute de l’histoire. Un sourire ne vient généralement
qu'esquisser le soulagement à l’achèvement de son récit.
Le choix de Jeanne présentait au moins trois
avantages :
- son attitude sereine qui était celle de quelqu'un
qui "joue le jeu" et qui le fait volontiers ;
- l’opportunité de disposer de plusieurs récits
du même locuteur ;
- la qualité de ses récits, qui font ressortir
clairement les tendances plus cachées chez d’autres enfants.
Nous avons choisi deux contes très courants.
Le premier, Cendrillon, est l’un des grands classiques de la tradition
occidentale : une jeune fille séquestrée par sa belle-mère
prend sa revanche grâce à l’intervention de forces mystiques
et finit par épouser le prince charmant. Le second, Singe et
Caméléon, est un conte spécifique à la
culture locale (ou régionale) : deux amis font des bêtises
et s’en accusent ensuite mutuellement pour éviter les sanctions
qui ne manquent pas de tomber ; la même histoire a été
produite indépendamment par plusieurs locuteurs.
Illustrer des stratégies récurrentes
à partir d’un seul locuteur peut être jugé partisan,
mais permet de préserver cohérence et cohésion du
texte et offre en outre une transparence relative par rapport aux éléments
avancés. La validité des phénomènes relevés
n’est pas fondée sur les seuls récits de Jeanne.
2.2. Démarche
Après la transcription initiale — phonétique
impressionniste, mais la plus précise possible — et le stockage
des textes dans la base de données, le corpus brut a fait l'objet
d'une annotation morphosyntaxique systématique ; les deux récits
ont ensuite été extraits et analysés en grilles. Le
principe des grilles consiste à disposer les répétitions
de positions syntaxiques en verticale et la construction syntaxique en
horizontale7 ; un même texte peut être présenté
de différentes manières sur une grille, selon l’observable
choisi. Les grilles fournies en annexe constituent souvent l'illustration
la plus efficace de notre argumentation : cette présentation possède
l’avantage de rompre avec la linéarité de la chaîne
de parole qui porte souvent préjudice aux mécanismes de l’élaboration
progressive du discours oral car la grille présente les piétinements
syntaxiques sans préjuger de leur nature ou fonction (involontaire
vs.
stylistique, hésitation vs. renforcement). Les ensembles
discursifs majeurs ont été numérotés et décrits
en composantes microsyntaxiques. La délimitation de ces ensembles
sans recours à la prosodie est certes plus ou moins
fiable selon les cas, mais nous verrons qu’il existe d’autres indices,
formels ou sémantiques. C’est seulement une fois la description
terminée qu’un certain nombre de "bruits" peuvent être éliminés
afin de constituer la séquence syntaxique maximale :
(S&C,2)8
(S&C,2)
|
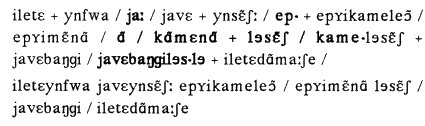 |
Le seul phénomène "déroutant" reste
alors l’anticipation du SN Singe.
L’objectif de cet article n’est ainsi pas de fournir
une description exhaustive de la structuration des récits non standard,
mais beaucoup plus modestement de proposer quelques pistes de travail pour
une approche syntaxique9 des récits non standard : l’appréciation
courante (même articulée par certains linguistes), est encore
celle d’un "parler sans grande cohésion syntaxique" (Crespo-Meunier,
1998 : 307). Or, les productions présentent grand nombre de traits
réguliers, mais qui demeurent cachés dans un continuum qui
les fait coexister avec le standard dans un même récit, cachés
dans la variabilité observée d’un locuteur à l’autre,
cachés enfin dans une grille d’analyse façonnée par
le crible standard. La description du non-standard nous oblige à
distinguer la filiation (étymologique) d’une séquence de
sa valeur : la présentation des extraits sous forme phonétique
offre un degré supérieur de fidélité à
la production (que l'orthographe standard ne peut fournir),qui doit également
faciliter la dissociation de sentiment linguistique et observation. L'interprétation
des formes ne se distille que progressivement ; aussi, l'argumentation
doit procéder "par spirales", en créant peu à peu
les liens entre phénomènes relevés.
2.3. L'élaboration du récit oral
Les récits possèdent certes une valeur
informationnelle qui en conditionne l’élaboration; d'ailleurs, la
réaction du "public" (enfants témoins, potentiels narrateurs
également) est généralement immédiate lorsque
le narrateur ne satisfait pas aux exigences de l’histoire, si un détail
est omis voire transformé. Mais la mise en forme est également
déterminée par des normes textuelles, et notamment celle
du récit oral traditionnel et celle du récit écrit
tel qu’il est proposé à l’école et dans les livres
de lecture. Il est ainsi apparu que le souci d’une restitution fidèle
se situe autant sur le plan formel que sur celui du contenu. La latitude
de gérer librement son discours permet au locuteur de recourir à
deux stratégies principales :
- se conformer au modèle scolaire pour valoriser
l’histoire,
- recourir à des structures stéréotypées
pour fournir un effort minimal (et dégager un potentiel supplémentaire
pour la gestion du contenu et/ou accentuer le rythme).
Ces vecteurs peuvent s’avérer convergents : une
élaboration très normalisée fait prédominer
des entités syntaxiques de type SVO. Or, il n'est pas aisé
de déterminer la part réelle de pré-constructions
et d’hypercorrections parmi les formes de routine.
Le récit non standard dans le contexte abidjanais
est essentiellement oral ; s'il ne l'est pas intrinsèquement, il
l'est culturellement. La majeure partie de la dimension prosodique a néanmoins
dû être écartée de l’analyse — alors que l'importance
de ce niveau pour la structuration du récit oral est certain. Par
exemple, le rythme constitue un critère important de la réussite
d’un récit : Jeanne produit en moyenne 530 unités sonores
par minute (8,96 par seconde) — comme elle, tous les conteurs "performants"10
ont un débit élevé11, avec des variations
régulières de la hauteur mélodique accentuant la structuration
symétrique des unités syntaxiques qui balisent le récit
pour l'auditeur. Si la régularité de la courbe semble se
construire plus à l’intérieur des segments que dans un énoncé
phonologique global, une étude détaillée des faits
intonatifs serait fortement souhaitable, des chercheurs comme Simard (1998)
insistent depuis longtemps sur ce fait.
La part non verbale du conte est plus représentée
dans Singe et Caméléon, par exemple à travers
l’imitation de l'allure du caméléon par un mouvement du torse.
Une autre fois, un enfant esquisse la disposition spatiale des éléments
sur le sol. De même, les enfants recourent aux bruitages et idéophones
pour rendre l’interventiond’animaux, comme en témoigne le discours
direct rapporté du premier oiseau dans Cendrillon (wazolaakrie/kœkœkœ,
Cend,2).
Ces dimensions manquent presque entièrement chez les écoliers.
3. Caractéristiques du récit
non standard
Sueur (1990 : 134s.), qui analyse les récits
d’enfants français, conclut que la structure énonciative
globale, qui passe toujours de la prédication d’état à
celle de l’action, s’articule de la manière suivante :
|
phases
|
1
|
2
|
3
|
| SUJET |
SN [-défini] |
SN [+défini] |
ANAPHORE |
| CONSTRUCTION |
présentatif |
détachement |
anaphorique |
| TEMPS |
imparfait |
présent |
passé composé |
| INTRODUCTEUR |
(et) puis, Ø |
et, après, alors |
alors |
Nous allons utiliser les paramètres de ce schéma
comme point de départ pour notre description - en excluant toutefois
l'articulation des temps verbaux, qui ne pourra être développée
ici.
3.1. Introducteurs
3.1.1. Délimitation du récit
Les bornes du récit abidjanais sont — assez indépendamment
du niveau de scolarisation des locuteurs — constitués par deux items
: [ilete+ynfwa]
il
était une fois sert de démarreur général
; sa capacité constructionnelle se restreint au niveau discursif,
dans la mesure où la présentation des protagonistes elle-même
est assurée par "y avait + SN (+P)" qui succède à
la formule initiale, comme dans Singe et Caméléon12
:
En devenant simple marqueur d’ouverture, l’introducteur
standard il était une fois semble se lexicaliser. Son pendant
de clôture est [sefini],
c’est
fini, qui marque de façon explicite la fin de la narration :
en effet, certains récits semblent inachevés malgré
la mention [sefini]
- qui reflète alors surtout l'auto-évaluation du locuteur
qui considère d’en avoir assez dit. Contrairement à il
était une fois, la formule de clôture semble préserver
le poids sémantique de finir, verbe par ailleurs très
utilisé.
Ces deux marqueurs délimitent l'étendue
du récit comme texte. L’action relatée par le texte s’articule
en événements constitutifs, marqués par et puis,
là, ou quand, qui se distinguent moins par leur valeur
sémantique propre que par l'articulation thématique avec
l'unité microsyntaxique qui les accompagne.
3.1.2. Connexion d’unités macrosyntaxiques
et marquage discursif
On constate tout d'abord que les termes introducteurs
les plus représentés en abidjanais ne sont pas ceux mentionnés
par Sueur, à part (et) puis, qui est en effet l'un des plus
fréquents.
|
 |
maintenant se substitue à
alors
: il articule l’enchaînement des événements, en gardant
une composante |
temporelle, du fait de la succession principalement
chronologique des événements verbaux. À la différence
des autres termes,
 |
marque surtout les transitions majeures dans le
récit : contrairement à son emploi standard, où il
est prédicat |
simple (ou adverbe). Sa valeur de prédicat bivalent,
relationnel, apparaît là où il n’est pas réalisé
: la seule césure à l’intérieur du récit Singe
& Caméléon — le passage de la première intrigue
à la seconde entre 10 et 11 — n’est pas marquée ; ici, la
non-marque (ou marque Ø) est un marquage fort.
|
 |
est parfois couplé à l'un des marqueurs
discursifs de clôture, focalisant sur l’événement lui-même
([sesa] |
ou sur le protagoniste et son action ([epati])
; ce dernier apparaît chez Jeanne lorsque Cendrillon s’apprête
à rejoindre la fête (Cend,6) ; on trouve [(s)esa]
pour clore l’"incident" de la précision [alarizje:]
apportée par un autre participant (Cend,3).
|
Le rapport entre |
 |
et [epYi] |
est inversé par rapport à celui décrit
par Sueur entre
alors et (et) puis. Nous |
avions écrit, dans la présentation générale
du corpus de notre thèse, que [epYi]
s’utilisait pour marquer une succession d’événements ainsi
que dans l’énumération — bref, comme forme forte remplaçant
et
dans la coordination verbale et nominale en général, à
l’instar de cet emploi relevé dans Singe & Caméléon
:
Or, sa distribution tend à se restreindre au
marquage d'un changement de topique13, qui se manifeste
le plus souvent par la réalisation d’un constituant nominal :
Mais c’est lorsqu’il n’y a pas de constituant nominal
que la fonction de [epYi]
est la plus visible :
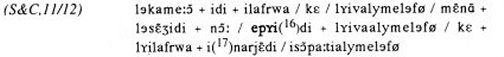
| |
det - CAMELEON ( i ) LU I (
i ) - sj DIRE - pres LU I ( i ) - sj sg -
pres AVOIR - FROID comp
LUI ( i ) - sj sg - prosp - ALLUMER
det - FEU - obj
MAINTENANT det - SINGE ( k ) LUI (
k ) - sj DIRE - pres NON
ET-PUIS LUI ( i ) - sj
DIRE - pres LUI ( i ) - sj sg - prosp -
ALLUMER det - FEU - obj comp
LUI ( i ) - sj sg - pres - AVOIR
- FROID
LUI ( k ) -sj sg - perf - neg - DIRE
EUX ( i + k ) - sj pl - perf - PARTIR
- ALLUMER det - FEU - obj |
|
Dans l'élaboration de ce discours rapporté,
l'apparente confusion des rôles des protagonistes résulte
de l'interprétation linéaire : après l’alternance
introduite par [epYi],
maintenue par [ke]18,
le Singe redevient topique.
L’enchaînement d’actions très liées,
souvent avec le même topique, se fait par [kã]
quand,
qui
présente alors un fonctionnement proche de celui d'après
cité
par Sueur. Par exemple, dans la dernière partie de Cendrillon
(Cend,12),
tout
tourne autour de la chaussure, les actions se précipitent.
[kã]
est ainsi utilisé avec une charge sémantique moindre qu’en
français, bien qu’il reste marqueur d’une ordonnance selon la succession
temporelle ; en cela, [kã]
se comporte de façon analogue à [menã].
L’emploi de [kã]
peut également se combiner à la répétition
de l’événement précédent, ce qui n’est pas
le cas dans les récits de Jeanne.
3.1.3. Marquage argumentatif
Le récit progressant essentiellement par accumulation
de séquences qui se succèdent dans le temps n'est qu'exceptionnellement
propice à l’argumentation. Cendrillon comporte néanmoins
quelques uns des outils linguistiques correspondants :
L'expression de la cause se fait par [kOm]
comme
ou [pae]
parce
que ; plus que leur valeur sémantico-logique distincte, c'est
surtout leur répartition sur les types de discours qui les différencie:
[pae]est
particulièrement fréquent dans lesdiscours spontanés,
alors que [kOm]n’apparaît
guère que dans les récits, où il est très utilisé
:
La première variante, avec un constituant nominal
antéposé, est la plus fréquente, mais elle semble
requérir l’unicité du sujet.
Notons que l'emploi de [me]
mais
(Cend,12) s'effectue apparemment comme en français standard,
son utilisation n'est cependant pas très développée.
De même, l'emploi du [la] connectif que l'on trouve dans Cendrillon
(Cend, 9/10) n'est pas très caractéristique des récits
non standards. La finalité est généralement exprimée
par [(pu)sa] (absent ici), reliant la conséquence à la cause
ou plusieurs événements à leur aboutissement.
3.2. Constructions et dispositifs syntaxiques
Le terme de dispositif permet de décrire
les différentes relations alternativement établies par une
rection - c'est un schème syntaxique comportant un nombre défini
de positions. Les deux principaux dispositifs représentés
ici sont le schème non marqué et celui en [se].Chacun
des deux peut comporter des expansions internes et ils peuvent se combiner
l'un à l'autre.
3.2.1. Le dispositif non marqué
Les deux récits présentés témoignent
d'un enchaînement symétrique d'unités syntaxiques semblables
: la séquence SVO (sujet-verbe-objet) est de loin la plus courante.
Si la réitération de schèmes stéréotypés
est souvent qualifiée de pauvreté stylistique, elle crée,
avec l'augmentation du débit, un rythme presque musical. Il s'agit
d'une stratégie d'élaboration très "didactique", et
caractéristique du récit oral.
Le dispositif est organisé autour de la "zone"
verbale (par ailleurs en voie de réorganisation : Ploog 1999b),
qui comporte en dehors du verbe lui-même le marquage actanciel sous
forme de clitique(s). La position nominale qui précède ce
noyau syntaxique ne peut s'assimiler au sujet, bien que ce soit le plus
souvent le constituant relatif au référent du sujet qui s'y
trouve. Dans l'exemple suivant, la première occurrence comporte
un constituant "objet" antéposé, la seconde un "sujet" :
(Cend,7)
|
lafijla + elavelese
det - FILLE - la( i ) ELLE ( k20
) - sj
ELLE ( i ) - obj AVOIR -
passé LAISSER
lafijla + lezaeSape
det - FILLE - la ( i ) - sj EUX (
k ) - obj sg - perf - ECHAPPER |
Pour distinguer cette position du thème (qui est de l'ordre référentiel)
et du sujet (qui se limite au premier argument du verbe) et sans préjuger
de son caractère ±détaché, nous la qualifions
de topique : le topique "produit" (réalise, comporte) un
constituant thématique, corrélé au prédicat
verbal qui organise l'unité microsyntaxique. Selon les caractéristiques
sémantiques du topique (intrinsèques et prédicatives),
celui-ci peut faire l'objet d'un double-marquage. S'il y a lieu de parler
de reprise dans ces cas-là, c'est le constituant nominal antéposé
qui "reprend" l'un des arguments verbaux clitiques.
3.2.2. Les dispositifs marqués
Contrairement au schème syntaxique qui antépose une séquence
nominale au mot verbal sans marque spécifique (a priori),
qualifié de détachement
par Sueur, les dispositifs marqués
mettent en œuvre une élaboration syntaxique plus complexe : à
travers ce qu’on a coutume de nommer l’extraction, où un
constituant, régi par un prédicat sans capacité constructionnelle
propre, comme
c'est ou il y a, se trouve expansé par
une proposition apparemment relative à fonction déterminative,
mais dont certaines propriétés sont celles de la complétive
; afin de les distinguer de leurs homologues avec un véritable caractère
présentatif, il nous est arrivé de les qualifier de leurres
structuraux (Ploog 2000b). Le constituant régi n’a pas de fonction
syntaxique dans la proposition basée sur le prédicat
sémantique, qui comporte sa propre position de sujet, souvent rempli
par le "mot" relatif :
Le parallélisme provoqué par la construction
elliptique témoigne de l'organisation informationnelle de la prédication
à travers ce dispositif, qui est centrée autour de l'élément
"extrait", et non, comme habituellement, autour du prédicat verbal
(ici [aby]).
Ainsi, ce dispositif est réputé offrir une alternative à
la succession canonique de thème et rhème.
Sur le plan syntaxique, le principe d'une dissociation
de deux entités enchâssées se trouve de fait en contradiction
avec les (nombreux) cas de forte contraction où le dispositif [se]
fait l’économie de la position du complémenteur :
Lorsque l’enchâssement n'est plus marqué,
on est tenté de considérer le prédicat "recteur" [se]
comme simple marqueur de syntagme ; toutefois, le dispositif permet encore
la négation et la variation temporelle, et lemarqueur [se]
peut lui-même se trouver effacé (à condition que [ke]
soit réalisé).
3.2.3. Expansions et intégration syntaxique
Nous entendons par expansion toute séquence
propositionnelle (composé autour d'un prédicat verbal) qui
enrichit le noyau syntaxique du dispositif. La fréquente absence
de position complémenteur ou de mot relatif est généralement
interprétée comme juxtaposition des unités syntaxiques.
Si nous retrouvons là le crible standard, il y a cependant lieu
de s'interroger sur une définition réaliste de l'intégration
syntaxique : dans quelle mesure [ke]
assure-t-il la subordination ? Quels autres outils permettent l'enchâssement
?
Les deux [k(e)]
du français — en ouverture des expansions verbale et nominale
— existent en abidjanais :
[ke]
remplit le rôle de marqueur relatif unique ; dans cette distribution,
il se trouve fréquemment couplé à l'enclitique [la]
qui "ferme" l'expansion, comme dans l'exemple ci-dessus, où la relative
détermine la personne. Toutefois, la réalisation est
loin d'être systématique : notamment les dispositifs marqués
par [se]
(cf. supra) et [ja] s'en passent quasiment une fois sur deux.
Le marquage de la complétive par [ke]
n'est pas systématique lui non plus. Néanmoins, le marquage
explicite pour maintenir le discours rapporté d'une proposition
à la suivante est très constant ; soit, le verbe recteur
est repris, comme dans
| la seconde séquence après |
 |
ci-dessus (Cend,11) ; soit, [ke]
marque l'intégration, comme dans la troisième |
(Cend,11). On pourrait alors qualifier
[ke]
de "conjonction de coordination des subordinations" : or, la notion de
subordination
réfère à une réalité linguistique trop
restrictive pour rendre compte de l'élaboration syntaxique observée.
Le flottement du marquage laisse penser que ce n'estpas [ke]
qui assure la connexion. Par exemple, on le relève aussi en présence
d'autres moyens de rapprochement de deux unités syntaxiques comme
le sujet Ø :
Le sujet Ø est partie essentielle des séries
verbales : ces prédicats verbaux composés de plusieurs noyaux
lexicaux constituent eux-mêmes un cas d'enchâssement.
|
La dynamique commune aux deux emplois
(verbal et nominal) de |
 |
consiste à marquer de
façon univoque une |
connexion déjà établie.
Il est donc plus adéquat de dire que l'intégration syntaxique
est assurée par divers moyens autres que [ke],
qui, le cas échéant, intervient de façon redondante
— lorsqu'il y a besoin d'un marquage fort.
3.3. Marquage du sujet et structure thématique
Nous entendons par thématisation un choix syntagmatisant21
de la part du locuteur : tout discours ayant un thème, celui-ci
évolue ou reste invariable, son interprétation se faisant
sur l’axe de l'élaboration structurale progressive ; latripartition
extraction-détachement-anaphorique proposée par Sueurschématise
implicitement le caractère intrinsèquement thématique
du sujet en français. Mais la linéarité de la langue
interfère parfois avec la condition de récupérabilité
du thème. Combettes22 (1978) dégage deux stratégies
de thématisation principales utilisées dans les récits
d'enfants. La première, la plus répandue, consiste à
placer un premier thème et de le maintenir face à la succession
des rhèmes qui forment le récit. Cette élaboration
est illustrée dans les récits de Jeanne par les "factorisations"
d'une part, où un thème antéposé reste valable
pour les propositions suivantes (la marque pour le protagoniste thématique
est le constituant clitique ou le sujet Ø : p. ex. le propriétaire
ci-dessus,
S&C,6), et d'autre part — tout aussi fréquemment
— par la répétition d'un constituant nominal :
L'autre type d’élaboration présenté
par Combettes consiste à reprendre un rhème précédent
pour l’utiliser dans la prédication suivante comme nouveau thème
: cette organisation thématique "croisée" semble plus marginale
dans les récits abidjanais, mais on la trouve à l'introduction
de l'oiseau (cf. ci-dessus, Cend,2) également. En tout état
de cause, il n'est pas judicieux d'opposer thème et rhème
de façon binaire comme il est coutume de le faire. En effet, certaines
occurrences réalisent à la fois un constituant extrait et
un autre, thématique, antéposé :
On comprend que Caméléon et comme
ça ont tous deux une valeur contrastive (sont focalisés).
L’originalité du dispositif en [se]
réside justement dans le fait que prédicat et rhème
— en tant qu’opposables au thème (cf. la définition
de Combettes supra) — n’y coïncident pas tout à fait.
Il convient de différencier avant tout entre
le constituant sujet, linguistique, et la somme des constituants
thématiques potentiels, référentiels ; nous
avons proposé de décrire cette position initiale, par un
terme neutre, celui de topique, qui désigne sur le plan syntaxique
simplement un lieu, sous-entendu : marqué. Notons que la
notion de topique chez les générativistes23
est plus restreinte que la nôtre ; elle y correspond à une
position nominale entretenant des liens lâches avec lastructure "propositionnelle"
(S’), obtenue par déplacement à l’intérieur de l’ensemble
énoncé.
3.4. Marquage aspecto-temporel
Comme la description de l'élaboration morphologique
du verbe est confrontée à un certain nombre d'obstacles "techniques",
l'analyse de la structuration aspecto-temporelle des récits en abidjanais
n'est que très peu avancée ; on ne pourra l'aborder ici que
de façon très succincte. L'omniprésence de la variabilité
morphologique dont témoigne la transcription est liée en
partie au débit de parole élevé (et aux limites de
la perception), ce qui est illustré par l'intervention réitérée
du propriétaire dans Singe & Caméléon,
décrite avec les mêmes items lexicaux mais une première
élaboration très "standard", et une seconde plus caractéristique
du non-standard abidjanais :
 et
[atrap]
de la seconde occurrence sont des formes verbales "non marquées"
; cet exemple montre que les séries verbales sont loin d'être
aussi exotiques qu'on se plaît parfois à l'affirmer : il ne
tient qu'à peu de choses — en l'occurrence à la réorganisation
(simplification ? réduction ? troncation ?) des désinences
verbales — pour aboutir à une interprétation syntaxique toute
autre.
Formellement, les temps verbaux principaux ressemblent
aux présent (non marqué), passé composé, imparfait
et futur périphrastique du français. Leur valeur respective
plus aspectuelle que temporelle est soulignée par la présence
d'autres moyens de cadrage de l'événement verbal, souvent
ad-verbiaux, parfois dans des positions inattendues ; ces moyens issus
du lexique français changent eux aussi de valeur en abidjanais.
A titre d'exemple, citons l'expression dérivée du français
jusqu’en
ou jusqu’à, qui se suffit à elle-même en abidjanais
: et
[atrap]
de la seconde occurrence sont des formes verbales "non marquées"
; cet exemple montre que les séries verbales sont loin d'être
aussi exotiques qu'on se plaît parfois à l'affirmer : il ne
tient qu'à peu de choses — en l'occurrence à la réorganisation
(simplification ? réduction ? troncation ?) des désinences
verbales — pour aboutir à une interprétation syntaxique toute
autre.
Formellement, les temps verbaux principaux ressemblent
aux présent (non marqué), passé composé, imparfait
et futur périphrastique du français. Leur valeur respective
plus aspectuelle que temporelle est soulignée par la présence
d'autres moyens de cadrage de l'événement verbal, souvent
ad-verbiaux, parfois dans des positions inattendues ; ces moyens issus
du lexique français changent eux aussi de valeur en abidjanais.
A titre d'exemple, citons l'expression dérivée du français
jusqu’en
ou jusqu’à, qui se suffit à elle-même en abidjanais
:
 n’a pas besoin d’indication temporelle autre que la durée et la
hauteur de la voyelle nasale, qui covarient avec l'extension temporelle
de l’événement : on comprend ici qu’ils se sont mis à
danser pour un long moment. [JyskA$]
accepte parfois la combinaison avec une indication temporelle — propositionnelle,
comme on le " soupçonne " dans cette occurrenceultérieure
:
4. Vers une définition du non-standard
Les caractéristiques des récits de Jeanne,
que nous avons qualifiées de stratégies d'élaboration,
illustrent la complexité de l'étude du non-standard : en
étudiant un peu plus en détail les deux contes de Jeanne
on constate que les phénomènes structuraux relevés
dans notre croquis ne se réalisent pas de manière systématique.
C'est l'une des caractéristiques majeures du non-standard : lié
dans un continuum auquel n'échappe aucun locuteur local, le non-standard
n'existe qu'en creux du standard et se trouve sans cesse mêlé
à lui.
L'abidjanais puise dans le français, s'appelle
français
—
mais n'en est pas tout à fait. Le pourquoi et comment ne se résume
toutefois pas au portrait des conditions d'emploi spécifiques, ni
à la chasse aux curiosités. Dans le cas de l'abidjanais,
le non-standard résulte certes d'un coup d'accélération
que le système français a reçu ; toutefois, le français
parlé en France possède lui aussi ses caractéristiques
non standard, certaines semblables (le complémenteur que),
d'autres distinctes (le sujet Ø) de l'abidjanais : la description
détaillée de ces traits — retenus dans la passoire du crible
réglementaire et échappant pour cette même raison le
plus souvent aux regards — contribuera à expliquer comment un système
linguistique peut fonctionner dans toute son hétérogénéité.
L'abidjanais ne fait que souligner de façon un peu criarde ce qui
fait l'essentiel d'une langue : sa variabilité et le caractère
non étanche du système.
La question des outils de description est cruciale ;
le lecteur a pu avoir l'impression que notre utilisation du terme marqueur
était abusive. Or, les outils de nomination courants ont été
forgés pour d'autres chantiers ; plutôt que de les multiplier
et de générer en corollaire une opacité certaine de
la description, nous avons pris le parti d'en utiliser les éléments
les plus neutres, en acceptant le manque de précision qu'ils comportent.
L'approche du non-standard n'est pas condamnée à s'en satisfaire
; lorsque la terminologie établie s'avère inadéquate,
la part d'affectation des différents niveaux d’analyse (morphologie,
sémantique, syntaxe, pragmatique) par les structurations non standard
doit seulement être établie avant, pour nommer en connaissance
de cause. C'est en cela que l'exploration du terrain non-standard apportera
sa pierre à l'édifice de la linguistique générale
— il n'y a plus qu'à se mettre au travail.
n’a pas besoin d’indication temporelle autre que la durée et la
hauteur de la voyelle nasale, qui covarient avec l'extension temporelle
de l’événement : on comprend ici qu’ils se sont mis à
danser pour un long moment. [JyskA$]
accepte parfois la combinaison avec une indication temporelle — propositionnelle,
comme on le " soupçonne " dans cette occurrenceultérieure
:
4. Vers une définition du non-standard
Les caractéristiques des récits de Jeanne,
que nous avons qualifiées de stratégies d'élaboration,
illustrent la complexité de l'étude du non-standard : en
étudiant un peu plus en détail les deux contes de Jeanne
on constate que les phénomènes structuraux relevés
dans notre croquis ne se réalisent pas de manière systématique.
C'est l'une des caractéristiques majeures du non-standard : lié
dans un continuum auquel n'échappe aucun locuteur local, le non-standard
n'existe qu'en creux du standard et se trouve sans cesse mêlé
à lui.
L'abidjanais puise dans le français, s'appelle
français
—
mais n'en est pas tout à fait. Le pourquoi et comment ne se résume
toutefois pas au portrait des conditions d'emploi spécifiques, ni
à la chasse aux curiosités. Dans le cas de l'abidjanais,
le non-standard résulte certes d'un coup d'accélération
que le système français a reçu ; toutefois, le français
parlé en France possède lui aussi ses caractéristiques
non standard, certaines semblables (le complémenteur que),
d'autres distinctes (le sujet Ø) de l'abidjanais : la description
détaillée de ces traits — retenus dans la passoire du crible
réglementaire et échappant pour cette même raison le
plus souvent aux regards — contribuera à expliquer comment un système
linguistique peut fonctionner dans toute son hétérogénéité.
L'abidjanais ne fait que souligner de façon un peu criarde ce qui
fait l'essentiel d'une langue : sa variabilité et le caractère
non étanche du système.
La question des outils de description est cruciale ;
le lecteur a pu avoir l'impression que notre utilisation du terme marqueur
était abusive. Or, les outils de nomination courants ont été
forgés pour d'autres chantiers ; plutôt que de les multiplier
et de générer en corollaire une opacité certaine de
la description, nous avons pris le parti d'en utiliser les éléments
les plus neutres, en acceptant le manque de précision qu'ils comportent.
L'approche du non-standard n'est pas condamnée à s'en satisfaire
; lorsque la terminologie établie s'avère inadéquate,
la part d'affectation des différents niveaux d’analyse (morphologie,
sémantique, syntaxe, pragmatique) par les structurations non standard
doit seulement être établie avant, pour nommer en connaissance
de cause. C'est en cela que l'exploration du terrain non-standard apportera
sa pierre à l'édifice de la linguistique générale
— il n'y a plus qu'à se mettre au travail.
Bibliographie
BENVÉNISTE, Émile, (1966). Problèmes
de linguistique générale. Tome 1, Paris, Gallimard (coll.
tel).
BLANCHE-BENVÉNISTE, Claire et JEANJEAN, Colette,
(1987), Le français parlé. Transcription et édition,
Paris : CNRS / INALF.
BYRNE, Francis, (1990), "Toward an account of preclausal
focus in some creole language", Linguistics 28/4,
661-688.
COMBETTES, Bernard, (1978). " Thématisation
et progression thématique dans les récits d’enfants ", Langue
française 38, 74-86.
DIK, Simon Cornelis, (1978), Functional Grammar.
Amsterdam / New York / Oxford : North-Holland Publishing
Company (Linguistic Series 37).
HATTIGER, Jean-Louis, (1983), Le français
populaire d’Abidjan : un cas de pidginisation. Abidjan, Publication
de l’ILA 87.
KERBRAT-ORECCHIONI, (1987), "La description des
échanges en analyse conversationnelle : l'exemple
du compliment", DRLAV, n°36-37 : 1-51.
KIHM, Alain, (1988). "Récupérer un
thème : une étude constrastive". Langue française
78, 57-66.
LAFAGE, Suzanne, (1978). "Description sommaire de
la situation sociolinguistique en Côte d’Ivoire". Abidjan :
Cahiers ivoiriens de recherche linguistique 3, 7-78.
LAFAGE, Suzanne, (1998). "Le français des
rues - une variété avancée du français abidjanais",
Faits
de Langues
11/12, 135-144.
NGALASSO, Mwatha M. et PLOOG, Katja, (1998). "Le
français des écoliers abidjanais : la revanche de la rue
sur
l’école ?", in, Batiana et Prignitz (eds.), Francophonies africaines,
49-65.
PLOOG, Katja, (1999a). Le premier actant en abidjanais.
Contribution à la syntaxe du non-standard. Université
Bordeaux 3, thèse de doctorat.
PLOOG, Katja, (1999b). "Turbulences dans la zone
préverbale : sujet Ø et conjugaison objective en français
d’Abidjan",
Le français en Afrique (ROFCAN) 13, 105-116.
PLOOG, Katja, (2000b). La syntaxe du premier
actant : entre contraintes morphosyntaxiques et élaboration
discursive. Etude d’un corpus parlé abidjanais, Toulouse, CNRS/Université
de Toulouse-le-Mirail (Carnets
de grammaire n°6).
RONAT, Mitsou, (1979). "Pronoms topiques et pronoms
distinctifs", Langue française 44, 106-128.
SIMARD, Yves, (1998). "Français de Côte
d’Ivoire : principes d’organisation de l’énoncé", in Queffelec
(éd.),
Recueil d’études offert en hommage à Suzanne Lafage ROFCAN
12, 295-310.
SUEUR, Jean-Pierre, (1990), "Sur la syntaxe du récit
oral", Lingvisticae Investigationes 14/1, 95-148.
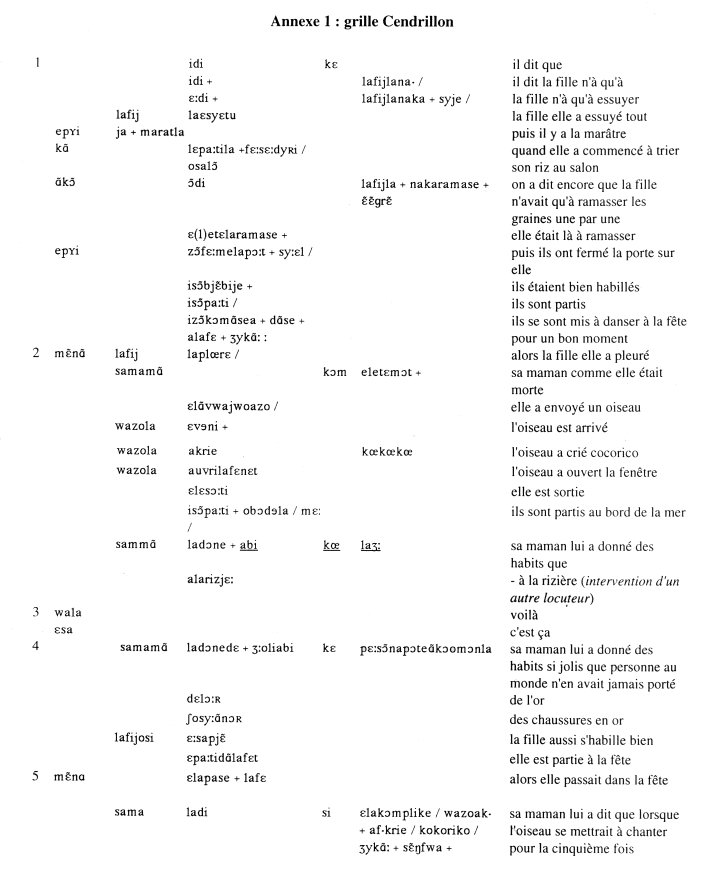
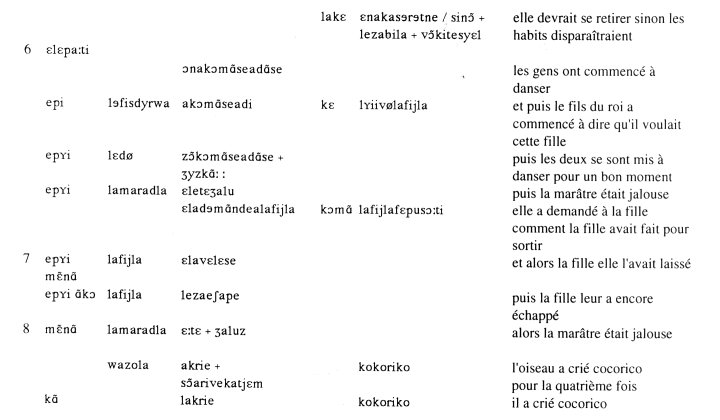
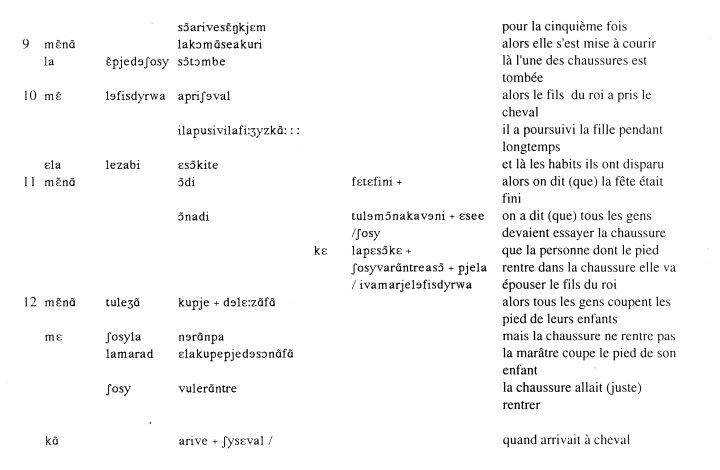
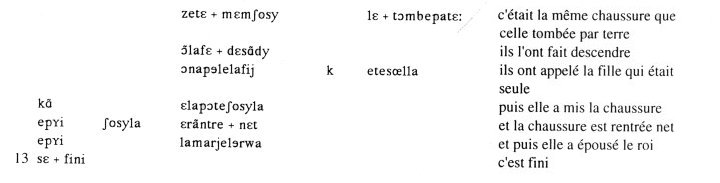
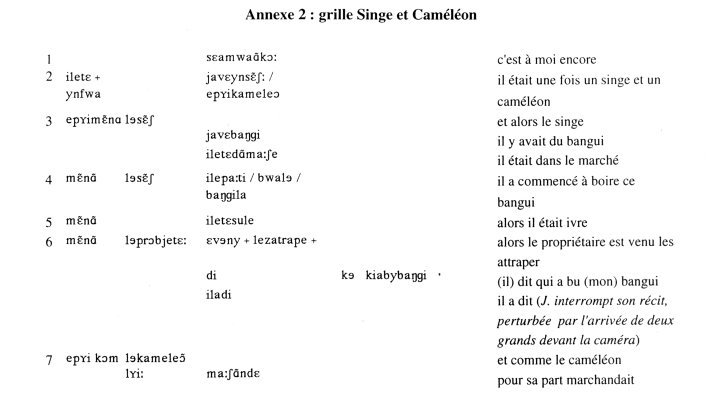
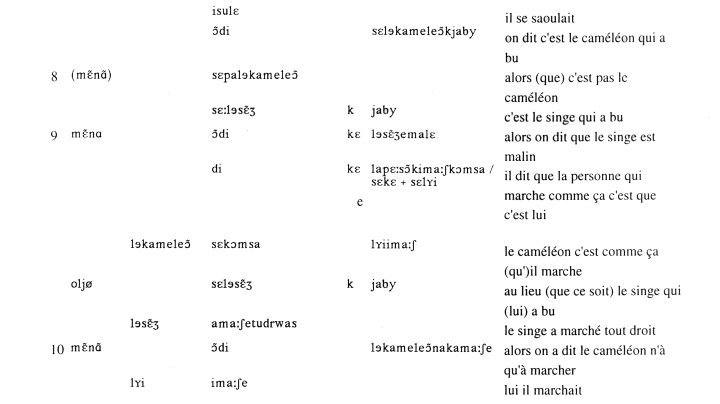
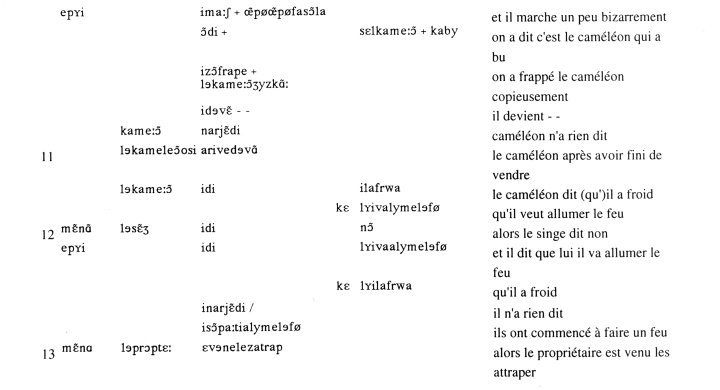
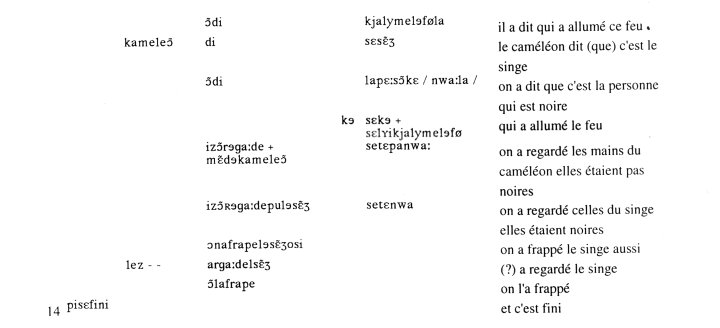
|