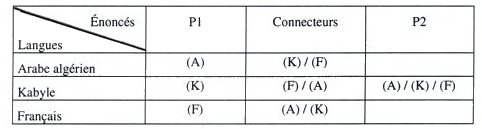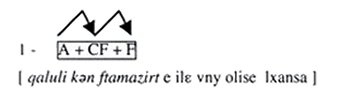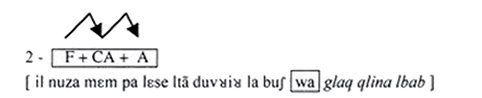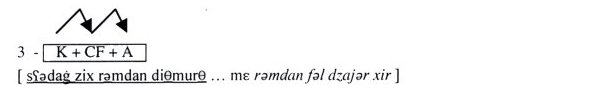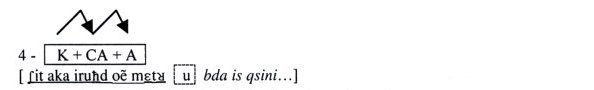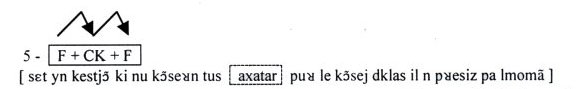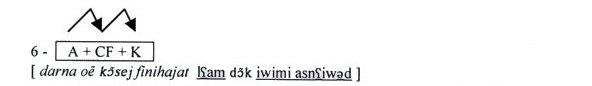LA STRUCTURATION DES ÉNONCÉS
ISSUS DU SWITCHING :
UN ÉTERNEL RECOMMENCEMENT.
T. Zaboot
Université M. Mammeri
TIZI-OUZOU - ALGÉRIE
Introduction
S’il est vrai que la langue a toujours été perçue
dans son rôle social, comme facteur d’intégration et de cohésion,
il n’en demeure pas moins que l’idée qui a pendant longtemps prévalu,
selon laquelle un peuple occupe (ou évolue dans) un
espace (territoire ou pays), pratique
une langue et constitue une
nation, est battue en brèche, par l’épreuve du temps. Avec
la mondialisation, une ère nouvelle s’est ouverte pour laisser place
à des échanges commerciaux de plus en plus intenses et, par
la même occasion, laisser place à de nouveaux modes d’expression
et de communication.
Si l’esperanto était apparu (1887) dans le but de faciliter les
échanges de tous ordres, entre les hommes ne partageant pas la même
langue, d’autres modes d’expression et de communication ont également
fait leur apparition afin de jouer le rôle de " modus vivendi ",
de compromis linguistique, au service d’interlocuteurs d’horizons différents.
C’est ainsi, par exemple, qu’étaient apparus
les pidgins, les sabirs… L’intérêt essentiel visé par
les locuteurs qui, ne pratiquant pas la même langue, usent de ces
voies de communication afin d’établir des relations principalement
commerciales. En somme, le verbe au service du commercial.
Que l’on parle de pidgins, de sabirs ou d’autres
modes d’expression, l’on constate, à chaque fois, qu’ils convergent
tous vers la même direction. Leur finalité est similaire :
réussir les échanges communicatifs et donc, les transactions
commerciales.
Cet autre mode d’expression et de communication qui sera la préoccupation
centrale de ce travail est désigné par les anglo-saxons :
"code-switching". Il se distingue des autres modes d’expression à
finalité réduite, à objectifs circonscrits et limités,
par, entre autre, son emploi qui couvre des sphères plus étendues,
des zones de communication plus vastes. Son usage ne se réduit pas
à servir, exclusivement, d’auxiliaire linguistique dans des transactions
commerciales. Sa mise en pratique peut se retrouver dans de nombreuses
inter-actions verbales. Il s’agit du "code-switching", dit conversationnel,
tel que défini par P. Gardner-Chloros1:
"(…) alternance ou (…) glissements (de codes) qui ont lieu à l’intérieur
d’une même conversation… sans qu’il y ait changement d’interlocuteur,
de sujet ou d’autres facteurs majeurs dans l’interaction" (1). Le "code-switching"
conversationnel n’a pas d’existence préalablement établie
comme celle des langues qui entrent dans sa composition et qui lui donnent
essence. Son existence est toujours en devenir. En somme, il n’a d’existence
que lorsqu’il est pris en charge par un locuteur qui " switch ".
1. Esquisse d’une typologie
Afin de recentrer le cadre de cette étude, nous dirons que,
s’il est évident et admis que les systèmes linguistiques
qui coexistent sur une même aire, sont bien des phénomènes
collectifs, extérieurs aux individus, en revanche, leurs manifestations,
réunies dans la pratique du " switching ", constitue, elle, leur
mode d’organisation individuelle.
Après de nombreuses hésitations, nous
avons été tenté de mettre en place ce qui pourrait
être considéré comme une esquisse d’une typologie de
l’organisation structurelle des énoncés complexes issus de
la pratique d’un "code-switching", tel qu’il est pratiqué par des
locuteurs algériens.
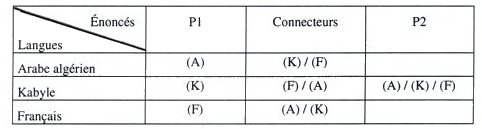
En nous référant au tableau ci-dessus
qui, grosso-modo, synthétise les modes de structuration relevés
dans le corpus2que nous
avons exploité, nous proposons les illustrations suivantes :
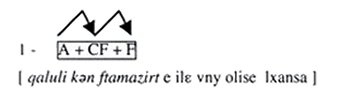
"on m’a dit qu’il était à Tamazirtn
et il est venu au lycée El-Khansa"
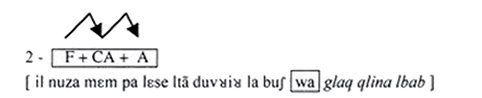
"il nous a même pas laissé le temps
d’ouvrir la bouche et il a fermé la porte sur nous".
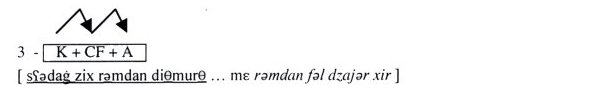
"j’ai déjà vécu le ramadan
au village,… mais le ramadan est meilleur (mieux) à Alger".
Il n’est pas inutile de rappeler et de préciser que les propositions
qui participent à la constitution des énoncés complexes
du "code-switching" peuvent être truffées d’emprunts ou d’interférences
:
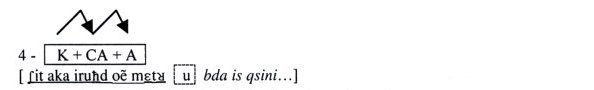
" peu après, un maître (d’internat) s’amène et
me demande "
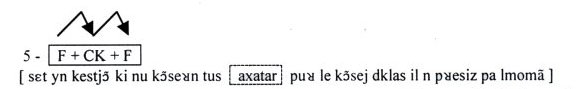
"c’est une question qui nous concerne tous parce que pour les conseils
de classe, il ne précise pas le moment".
Concernant le dernier énoncé cité, il serait quelque
peu surprenant de parler de "switching". Mais nous dirons, tout simplement,
que l’effet attendu et habituellement assigné à la pratique
de l’alternance codique est atteint. En effet, la pratique du "switching",
essentiellement centrée sur le récepteur, vise d’abord à
persuader, à convaincre. Il semblerait alors que le locuteur adopte
la formule qui convient le mieux à son discours, à son vis-à-vis,
ainsi qu’à la situation de communication dans laquelle il se trouve
impliqué.
On notera donc que le locuteur use de l’effet de contraste qui résulte
de l’emploi d’un connecteur emprunté à un système
linguistique différent de celui dans lequel sont rendus les énoncés
qu’il relie. Ceci renforce considérablement l’effet d’expressivité
souhaité.
En tout état de cause, nous dirons, à la suite de Kahlouche3(que
"… seront considérées comme kabyles, les phrases bilingues
dont le syntagme prédicatif (à noyau verbal ou nominal accompagné
de ses modalités) est kabyle ; et inversement pour
les phrases françaises…" et / ou arabes4.
Après cette rapide digression, nous revenons à la pratique
alternée de codes linguistiques ainsi qu’aux modes de structuration
des énoncés qui résultent du "switching". C’est ainsi
que nous dirons que, même si la proposition principale (P.P.) et
le connecteur sont rendus dans la même langue, il ne faudrait pas
déduire hâtivement que l’emploi d’une langue induit automatiquement
l’usage d’un connecteur puisé dans son système. Les énoncés
1,2 et 3, cités plus haut, attestent la véracité de
ce propos.
Également, il serait singulier de conclure
que la subordonnée est toujours rendue dans la même langue
que le connecteur. Puisque, d’une part, le changement de codes linguistiques
s’opère, le plus souvent, au niveau de l’interconnexion phrastique,
d’autre part, le connecteur constitue le point de rupture intonative, le
lieu privilégié de rencontre d’énoncés produits
dans des langues différentes :
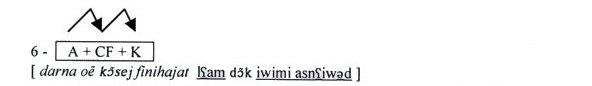
"nous avons tenu un conseil de classe en fin d’année, donc pourquoi
le refaire"
2. Autres modes d’organisation structurelle
Certains énoncés complexes issus du " switching " obéissent
à un mode de structuration relativement complexe qui peut être
schématisé ainsi :
|
L 1 + "plate-forme d’ancrage" en L 2 + connecteur en L 2
+ L 2
|
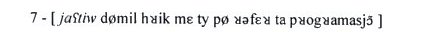
"ils donnent deux mille briques mais tu peux refaire ta programmation"
L’intervention de la L 2, dans la seconde position, se trouve précédée
de ce que nous appelons plate-forme d’ancrage :
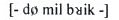
"deux mille briques"
De même que :
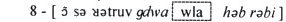 5 5
"on se retrouve demain, si Dieu veut"
[-gdwa-]
"demain"
Il s’agit, en fait, d’unités linguistiques
: "deux mille briques", [ gdwa-]
"demain", qui se présentent dans une langue différente de
la précédente mais appartenant au système dans lequel
se trouve rendue la subordonnée. "deux mille briques", [ gdwa-]
"demain", qui se présentent dans une langue différente de
la précédente mais appartenant au système dans lequel
se trouve rendue la subordonnée.
Cette formule : plate-forme d’ancrage, correspond à ce que Marouzeau6désigne
par : "construction proleptique qui caractérise l’organisation structurelle
de bien des productions du "code-switching"".
Peut-on alors dire que la subordonnée a de
fortes chances d’être rendue dans la langue dans laquelle se trouve
rendu le connecteur puisque, généralement, il suit la plate-forme
dite d’ancrage, et le plus souvent, il fonctionne comme starter linguistique
de l’alternance ?
Il y a effectivement de fortes chances pour qu’une
phrase liée à une autre par une marque, formellement identifiable,
soit rendue dans la langue de cette dernière. La présence
de la plate-forme d’ancrage augmente considérablement le taux de
probabilité.
Néanmoins, ceci ne doit pas être considéré
comme une règle générale, pas plus que la proposition
principale n’induit automatiquement l’emploi d’un connecteur puisé
dans le système de la langue dans laquelle elle se trouve rendue.
Conclusion
Le parler d’un locuteur qui pratique le "switching" se caractérise
par une instabilité structurelle, relative au positionnement des
énoncés rendus dans les différentes langues, composantes
de son "code-switching".
Il se caractérise aussi par sa variabilité
quant à la langue à laquelle il emprunte le connecteur. "…
la norme commune, linguistique et sociale, n’offre pas un modèle
de comportement stable au locuteur, mais seulement une image idéale
quoique contestable et souvent contestée que, de toute façon,
on approche plus qu’onatteint".7
Une démarche grammairienne, normalisante, qui chercherait à
établir des lois d’agencement, des règles structurelles des
énoncés complexes du "code-switching", serait condamnée
inéluctablement à l’échec.
Sa viabilité ou sa validité serait
tributaire d’un renouvellement quasi-permanent du modèle de structuration
proposé. Seules peuvent être émises des hypothèses.
Il serait donc vain de vouloir à tout prix "institutionnaliser"
des normes de régulation portant sur l’ordonnancement des énoncés
complexes issus de la pratique alternée de codes linguistiques.
Une norme imposée pour réguler la structuration ou l’agencement
des énoncés qui participent à la constitution du "code-switching"
aboutirait, par conséquent, à de nombreuses sous-divisions,
jusqu’à constater que chaque usage du "code-switching" est "idiosyncrasique".
L’instabilité linguistique favorise l’émergence de modes
d’agencements structurels impromptus, sans cesse renouvelés.
Bibliographie
GARDNER-CHLOROS, P. (1983). " Code-switching : approches
principales et perspectives ", La
linguistique, vol. 19, fasc. 2, Paris, P.U.F.
KHALOUCHE, R. (1990). " Diglossie, norme et mélange
de langues ", Minoration linguistique au Maghreb,
cahier de linguistique sociale, Université de Rouen.
LABIOT, P. (1979). " Saturation grammaticale et
saturation discursive : remarque sur quelques emplois de :
pour ", D.R.L.A.V., 21, Université de Paris VIII,
MANESSY, G., WALD, P. (1979). Plurilinguisme,
normes, situations, stratégies, Paris, L’Harmattan.
ZABOOT, T. (1990). " Un code-switching algérien
: le parler de Tizi-Ouzou ", thèse de doctorat de
linguistique, Université René Descartes Paris V, Paris
1P. Gardner-Chloros,
1983, p. 23.
2Corpus exploité
lors de l’élaboration de notre thèse de doctorat
A : arabe algérien (souligné
de deux traits)
K : kabyle (souligné d’un trait)
F : français (non
souligné)
3R. Kahlouche,
p. 77.
4C’est nous qui
ajoutons et qui soulignons.
5Enoncé
souvent produit par une animatrice de la radio algérienne, chaîne
III.
6Marouzeau,
in P. Labiot, 1979, p. 131
7G. Manessy,
P Wald, 1979, p. 8.
|