 Introduction
Introduction Introduction
Introduction
1 PRéSENTATION GéNéRALE DE LA CÔTE-D'IVOIRE
1.3.4 La
population ivoirienne
1.3.5 Structure
de la population selon la religion
1.4.1 La
période pré-coloniale
2.1 Hiérarchie
des langues locales
2.1.3 Les
langues véhiculaires
2.1.4 Le
français langue officielle
2.2 L'exposition
au français : status et corpus
3 DESCRIPTION
SUCCINCTE DES VARIéTéS EN PRéSENCE
3.1 Le
français populaire ivoirien (FPI)
3.2
Les
français des scolarisés
3.2.2 Le
français « ordinaire » des Ivoiriens
3.2.5 Les
opinions des locuteurs
4 L’INVENTAIRE
DES PARTICULARITES LEXICALES DU FRANÇAIS EN COTE-D’IVOIRE
4.2.1 Constituer
un Inventaire ivoirien (IFCI°)
4.2.2 Mais
un inventaire à orientation différentielle
4.2.3 Et
à visée non-normative
4.2.4 Une
enquête étendue à tous les Ivoiriens francophones
4.2.5 Portant
sur toutes les formes de communication, tous les domaines, tous les registres
4.2.6 Une
perspective polylectale
4.3
Les
particularités lexicales
4.3.1 Quelques
précisions indispensables
4.3.2 Typologie
fonctionnelle des particularités lexicales
4.3.3 Collecte
et sélection des données.
4.4.1 Le
classement de la nomenclature : la macro-structure
4.4.2 La
constitution des articles : la micro-structure
|
La Côte-d'Ivoire est un pays complexe qui n'a émergé comme état sous sa forme géographique actuelle que durant l'époque coloniale. Pourtant, de l'Indépendance aux années 80, on a pu parler de "miracle ivoirien" tant le développement a été rapide et la modernisation apparemment réussie. Mais les problèmes économiques et politiques n'ont pas manqué à partir des années 80 et notamment ensuite après la disparition du Président Houphouët-Boigny. Principal pays d'implantation africaine des Français, bien qu'actuellement la communauté française semble y être en constante diminution, il est devenu, malgré la présence d'une soixantaine de langues pour la plupart fort dynamiques, l'état le plus francophone au sud du Sahara, au point que le français, langue importée, tend même à pouvoir y compter au rang des langues nationales. C'est de cette appropriation spectaculaire et de l'extraordinaire créativité montrée par le vocabulaire français dans son implantation locale que nous avons voulu rendre compte dans le présent ouvrage. Cet enrichissement a pratiquement touché tous les domaines couverts par le lexique, c'est pourquoi il nous a paru nécessaire de fournir un ensemble d'informations générales et succinctes afin de permettre au lecteur de mieux appréhender une situation sociolinguistique qui n'en est pas à un paradoxe près. |
|
La Côte-d'Ivoire est un État francophone de l'Afrique occidentale, sur le Golfe de Guinée. Elle est limitée au sud-ouest par le Libéria (la frontière suivant le fleuve Cavally), à l'ouest par la Guinée, au nord par le Mali et le Burkina Faso, à l'est par le Ghana, au sud par l'Océan Atlantique, sur environ 600 km. La côte est régulière mais protégée par la barre*(1), ce qui, faute de port naturel, a rendu difficile, pendant des siècles, l'accès à l'intérieur par la mer. De forme quadrangulaire, ce pays de 322 460 km2 constitue une sorte de plateau uniforme, aux reliefs peu contrastés, s'élevant insensiblement du sud-est vers le nord-ouest avec pour point culminant, le mont Nimba, à la frontière guinéo-libérienne (1 750 m.). Ces faibles reliefs sont cependant compartimentés par des cours d'eau (un certain nombre de rivières et quatre fleuves) coulant pour la plupart du nord vers le sud, souvent encaissés, au débit irrégulier et coupés de chutes et de rapides, navigables seulement en aval pour le flottage des grumes. La Comoé, bien que traversant le pays sur 1000 km en longeant la frontière du Ghana, a une trop faible dénivellation pour être aménagée. Le Bandama, constitué du Bandama blanc (qui se jette dans le lac de retenue de Kossou) et du Bandama rouge (ou Marahoué), forme ensuite le lac de Taabo et fournit l'électricité pour Abidjan et la région du Centre, grâce à deux barrages aménagés sur son cours. Le Sassandra qui vient de Guinée, alimente le lac de retenue de Buyo. Le Cavally, lui, entre en Côte d'Ivoire en pays dan et dévale avec des rapides la zone montagneuse en traçant la frontière avec le Libéria. |
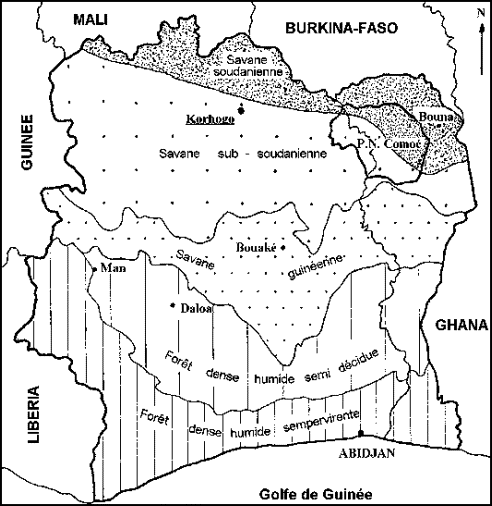 |
|
Une nette opposition bioclimatique sépare cependant le sud et le nord en deux régions caractéristiques : au sud, la forêt de type sub-équatorial, au nord, la savane de type tropical, le centre établissant une sorte de transition progressive entre les deux climats. a) le sud : Le long du golfe de Guinée, la côte orientale, basse et sableuse, est marquée par de vastes lagunes (Tadio, Ebrié, Aby), partiellement navigables et séparées de l'océan par de minces cordons sablonneux, alors que la partie occidentale après l'embouchure du Sassandra, est formée de falaises rocheuses. La zone de mangroves*, riche en espèces aquatiques, cède ensuite la place à la forêt dense dont l'extension (12,5 millions d'hectares dans les années 1960) a été quasiment amputée des deux tiers pour céder la place à des défrichements en vue de l'exploitation des essences commerciales (acajou*, assaméla*, aboudikro*, fraké*, framiré*, bété*, etc.) ou l'ouverture de zones de plus en plus vastes dévolues à des plantations* industrielles (caféiers, cacaoyers*, palmiers* à huile, agrumes, hévéas*, etc.) au point qu'elle ne couvre plus que 4,6 millions d'hectares (dont 1,6 million dans les parcs nationaux) malgré une importante campagne gouvernementale de reboisement. Dans le centre du pays, de Bondoukou à Man, la forêt devient claire avec des arbres plus petits et à feuilles caduques en saison sèche. Dans le sud, on distingue quatre saisons*: une grande saison des pluies, de mai à juillet, une petite saison sèche d'août à septembre, une petite saison des pluies d'octobre à novembre, une grande saison sèche, de décembre à fin avril. Les températures sont toujours supérieures à 18°C, l'amplitude thermique est quasi nulle (21° et 33°C). L'humidité est forte : 2 500 mm de précipitations en moyenne. Cependant, en allant vers le centre du pays, les pluies deviennent moins abondantes (de 1 000 à 2 500 mm) et l'écart des températures moyennes (entre 14° C et 39°C ) grandit. Une saison sèche de novembre à mars précède une saison des pluies marquée par deux points culminants de pluviométrie : en juin et septembre. b) le nord : La savane* arborée(: savane guinéenne) avec une pointe descendant jusqu'à Yamoussoukro, couvre tout le nord de la zone forestière. Cependant, autour de l'immense lac artificiel de Kossou ou des nombreuses rivières, on rencontre des forêts*-galeries, qui vont s'insérer dans la grande forêt. Dans les régions plus septentrionales, on trouve la savane arbustive ( : savane sub-soudanienne) où les arbres laissent la place à des formations d'arbustes et d'épineux (acacias*) puis au nord la savane herbeuse (: savane soudanienne). Les cultures sont traditionnelles (igname*, mil*) et commerciales (coton*, riz*, canne* à sucre, anacarde*). Le climat est de type tropical soudanien avec une saison faiblement humide et une saison sèche (novembre-mai) placée sous l'influence de l'harmattan*. L'amplitude thermique est très marquée (entre 10°C et 42°C). |
|
La Côte-d'Ivoire est l'un des 6 membres de l'Union monétaire ouest-africaine (UMOA*). L'unité monétaire est le franc CFA* (: franc de la Communauté financière africaine) indexé sur le cours de l'euro (1 euro = 655, 957 francs CFA par décret ministériel du 31.12.1998. 100 F CFA = 0, 152 eur.). Le PNB (: Produit National Brut) était en 1997 de 10, 2 milliards de dollars (dans lesquels l'agriculture représentait 36 %, l'industrie : 24 %, les mines : 2 % , les services : 38 %) ce qui plaçait, à cette date, la Côte d'Ivoire au 70ème rang sur les 133 pays du monde pris en considération et donnait un PNB de 653 dollars par habitant (88ème rang). En 1994, pourtant, la dette représentait 177, 6 % du PNB et le taux de chomage dans la population était de 17 %. En 1997, le taux d'inflation s'élevait à 3, 4 % . Cependant un programme de redressement (remboursement échelonné de la dette, baisse des dépenses publiques, diminution du nombre des fonctionnaires, privatisation de certaines entreprises d"Etat, etc.) semblait devoir favoriser actuellement un certain redémarrage s'il n'y avait eu les troubles graves qui ont éclaté dans le pays en septembre 2002. |
|
L'économie ivoirienne repose avant tout sur l'agriculture (cultures vivrières et cultures d'exportation) qui, en 1995, occupait encore 94 % de la population active et attirait de nombreux saisonniers en provenance des pays voisins. Mais la variation des cours des matières agricoles est très dangereuse pour la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao et dixième producteur de café. C'est pourquoi, pendant longtemps, une sorte de caisse de compensation, pour les petits planteurs, la Caistab* a permis d'amortir les trop grandes amplitudes du prix des produits agricoles sur le marché mondial. Un tel système a conduit le pays à s'endetter lourdement alors que les marchés devenaient de moins en moins favorables, de telle sorte qu'en 1987, la Côte-d'Ivoire a dû se déclarer insolvable et connaître des années difficiles. Enfin, en 1994, est intervenue, heureusement, une hausse importante des cours du café et du cacao qui, conjuguée à la dévaluation* du franc CFA, a permis au pays de renouer avec la croissance après plus de sept années de récession. Les autres cultures d'exportation sont, dans le sud, la banane*, l'ananas* et l'avocat*, le coton, la canne* à sucre dans le nord. Dans un effort de diversification, le gouvernement encourage depuis plusieurs années la plantation de palmiers à huile*, d'hévéas*, voire, plus récemment encore, d'anacardiers* et de rocouyers*. Les grands barrages (Kossou, Ayramé) ont facilité l'introduction de la riziculture* irriguée. Quant à la forêt, exploitée dès l'époque coloniale, et même surexploitée, notamment dans la zone frontalière du Libéria, elle fournissait encore, en 1992, par les exportations de bois d'oeuvre et bois précieux 3,4 % du PNB. La pêche vivrière est pratiquée sur la côte mais surtout dans les lagunes, les lacs et les rivières ou dans les fermes aquacoles* qui tendent à se multiplier (carpes*, machoirans*, tilapias*). La pêche maritime industrielle pour les conserveries porte sur la sardine*, le thon*, la bonite*, les crevettes. (100 000 tonnes/ an en moyenne). |
|
Le secteur minier reste marginal. La production pétrolière, lancée en 1980, trois ans après la découverte des premiers gisements offshore, semble avoir régressé mais on commence à exploiter de prometteurs gisements de gaz naturel qui alimentent plusieurs centrales thermiques. 60 % cependant de l'électricité produite est fournie par 6 barrages hydroélectriques permettant même à la Côte-d'Ivoire d'exporter 300 GWh vers le Ghana, le Togo et le Bénin. Quelques mines d'or et de diamants sont exploitées de façon très artisanale. L'industrie ivoirienne, autrefois liée à l'agriculture et à la forêt (agroalimentaire, dépulpage du café, séchage du cacao, égrenage du coton, première transformation du latex, sciage du bois, papeterie) est aujourd'hui en pleine diversification afin de tenter de maîtriser la chaîne de production. En 1960, ont été mises en place des industries textiles et mécaniques pour réduire les importations. Puis, entre 1970 et 1980, les activités de transformation des matières premières agricoles ont été développées (par exemple, dans le nord du pays, création de vastes complexes* sucriers). |
|
Plus de la moitié du réseau routier, en bon état, est praticable toute l'année. 5.600 km bitumés en 1995 contre 1.000 en 1970. La voie ferrée qui relie Abidjan à Ouagadougou, achevée en 1950, offre un débouché maritime au Burkina et aide la prospérité des villes ivoiriennes desservies. L'aéroport international de Port-Bouët à Abidjan est un des plus modernes d'Afrique et des liaisons aériennes existent aussi avec les principales villes de l'intérieur. Malgré le handicap de la barre* qui a rendu longtemps délicat l'accès à de nombreux ports, le commerce maritine est florissant, surtout à Abidjan et à San Pedro, modernisé afin de favoriser le développement de la région frontalière de l'ouest. Le tourisme est un secteur encore à développer mais de nombreux parcs* naturels ont été inaugurés, (Marahoué, Taï, Comoé, etc.) et des stations balnéaires de l'est du pays sont l'objet d'une certaine promotion (Assinie, etc.) |
 |
|
La Côte d'Ivoire est une république de type présidentiel et pluraliste depuis 1990. La Constitution, promulguée en 1960 a été amendée en 1985. L'assemblée nationale compte 175 députés élus pour 5 ans, tout comme le Président de la République, qui est rééligible sans limitation du nombre de mandats. Ce dernier est assisté par un Premier Ministre. L'actuel Président, Laurent Gbagbo a été élu le 27.10.2000. Le pays compte 58 départements, 230 sous-préfectures, constituant 19 régions depuis 1997. La capitale* politique, depuis 1983, est Yamoussoukro, au centre du pays. |
|
La population totale était évaluée en novembre 1998 à 15.366.672 habitants (7.844 623 hommes : 51 % et 7. 522.049 femmes : 49 %) ce qui correspond à un taux d'accroissement annuel moyen de 3,3 % sur la période intercensitaire 1988-1989. (RGPH-98, 2 édition, 2001 : 5). Ce taux est l'un des plus élevés de l'Afrique subsaharienne. Avec un tel rythme, la population double tous les 22 ans. Cependant la répartition géographique de la population montre un net déséquilibre entre la zone forestière qui, bien que ne représentant que 47 % de la superficie totale du territoire, concentre 78 % de la population globale, alors que la zone de savane, plus étendue (53 % du territoire) ne compte que 22 % de la population globale. Il y a donc une grande disparité au niveau régional et départemental dans la densité moyenne nationale qui est de 48 hab. au km2. La région des Lagunes rassemble, par exemple, (à cause du poids démographique de la ville d'Abidjan) près du quart de la population du pays, avec une densité de 273 h. au km2, alors qu'au nord, les départements de Bouna, de Dabakala et d'Odienné, ne comptent respectivement que 8 h./km2, 10 h./km2 et 11h./ km2. Les taux
d'urbanisation varient également très fortement d'une région à
l'autre : de 14 % dans le Zanzan, à 57 % dans la Vallée du Bandama et
84 % dans la région des Lagunes (à cause d'Abidjan). Le nombre des
villes dépassant les 100 000 h. est passé, en dix ans, de cinq à
huit. Ce sont par ordre d'importance = Abidjan : 2.877.978 h, capitale*
économique du pays, deuxième métropole de l'Afrique de l'Ouest après
Lagos (Nigéria). Bouaké : 461.618 h., Daloa : 137.107 h.,
Yamoussoukro, capitale politique et administrative : 155.803 h., Korogho
: 142 039 h., San Pedro : 131 800 h., Man : 116 657 h., Gagnoa : 107 124
h. De ces huit villes, Korogho est la seule appartenant à la zone de
savanes. Quant à Abidjan, elle représente à elle seule 19 % de la
population totale et 44 % de la population urbaine. Dans l'espace
intercensitaire 1988-1998, le nombre d'habitants s'y est accru de près
d'un million (très exactement 948 970 h.). Des estimations plus récentes
(Jeune Afrique/L'Intelligent, 2 avril 2001 : 45) évalueraient
aujourd'hui à 3 millions le nombre des Abidjanais. Pour l'ensemble du pays, la transition démographique amorcée vers les années 1980, avec un taux brut de natalité de 48 naissances pour 1000 habitants et un taux de mortalité de 13 décès pour 1000 habitants, s'accélère sous l'effet de l'urbanisation, du relèvement du niveau d'instruction des filles et de l'amélioration de la santé. 43 % de la population a moins de 15 ans (ce qui traduit une légère baisse par rapport à 1988). La population adulte (15-59 ans) représente 53 % de l'ensemble mais le groupe des plus âgés (60 ans et plus) n'est que de 4 % (en augmentation de seulement 1 point). Certaines données statistiques font apparaître des éléments intéressants : - la forte présence des moins de 15 ans et des plus de 60 ans dans la population rurale, - la prédominance des hommes sur les femmes en milieu urbain dès le début de l'âge adulte, vraisemblablement en raison de la migration masculine massive vers la ville pour des causes économiques. - le poids démographique important des étrangers. |
|
La population du pays (15.366.672 h.) est constituée de 74 % d'Ivoiriens et de 26 % d'étrangers (4.000.047 personnes soit un taux d'accroissement moyen annuel de l'ordre de 2, 6 %).(RGPH –1998) Les plus fortes proportions d'étrangers résident dans les régions forestières (Comoé, Bas Sassandra) : entre 45 et 43 % , alors que les savanes en attirent peu (par exemple, Denguélé : 6 %). Abidjan, pourtant, en 2001, ne compterait plus que 900.000 non-Ivoiriens (29 %). Cette population étrangère est composée en majorité d'hommes (55 %), provenant en très grande majorité des pays de la CEDEAO*, en particulier des pays frontaliers. Il faudrait cependant ajouter une précision importante : 47, 3 % de la population étrangère, notamment chez les ressortissants du Burkina, du Mali, du Bénin ou du Nigéria, n'est pas immigrante mais est née en Côte-d'Ivoire. Dans le tableau ci-dessous qui prend en considération les données censitaires de 1988 et celles de 1998, on peut observer une baisse du poids démographique du Mali, du Ghana, de la Guinée, en ce qui concerne les étrangers non africains. Par contre, le poids du Libéria particulièrement (le département de Tabou, près de la frontière libérienne détient le record de population étrangère avec 54,6 % d'étrangers) et celui de l'Afrique centrale sont en augmentation, sans doute en raison des troubles ou des guerres qui ravagent ces régions. Le RGPH de 1998 ne donne pas la ventilation des étrangers non africains. Les plus nombreux étant, sans doute les Libanais puis les Français. Car la communauté française, (la plus importante de l'Afrique subsaharienne), d'environ 60 000 personnes dans les années 1960-1970, ne cesse de diminuer. En 1985, elle ne comptait plus qu'à peu près 30 000 résidents. Pour diverses raisons, (baisse constante de la coopération culturelle et technique, insécurité grandissante, troubles politiques, etc.) cette réduction s'est, depuis, poursuivie. Dans sa livraison n°2177, relatant les récents troubles ivoiriens, Jeune Afrique l'Intelligent fait état d'à peine plus de 18 000 Français recensés au Consulat français de Côte d'Ivoire. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
Burkina Faso |
1
564 650
|
51,5
|
2
238 548
|
56,0+
|
|
-
Mali |
712
500
|
23,4
|
792
258
|
19,8-
|
|
-
Guinée |
225
845
|
7,4
|
230
387
|
5,7-
|
|
-
Ghana |
167
783
|
5,5
|
133
221
|
3,3-
|
|
-
Bénin |
86
375
|
2,8
|
107
499
|
2,7-
|
|
-
Niger |
84
826
|
2,8
|
102
220
|
2,6-
|
|
-
Libéria
|
4
711
|
0,2
|
78
177
|
2,0+
|
|
-
Togo
|
42
664
|
1,4
|
72
892
|
1,8+ |
|
-
Nigeria |
52
875
|
1,7
|
71
355
|
1,8+
|
|
-
Sénégal |
39
727
|
1,3
|
43
213
|
1,1-
|
|
-
Mauritanie |
16
650
|
0,5
|
18
152
|
0,5=
|
|
-
Autre Af.Occ |
2
364
|
0,1
|
3
923
|
0,1=
|
|
-
Afr.centrale |
3
727
|
0,1
|
10
770
|
0,3+
|
|
-
Reste Afr. |
886
|
NS
|
4
793
|
0,1+
|
|
-
Afr.du Nord |
1
142
|
0,1
|
1
925
|
0,0-
|
|
Reste
du monde |
32
312
|
1,1
|
32
714
|
0,8-
|
|
-
Non déclaré |
-
|
-
|
58
015
|
1,4
|
| - TOTAL |
3 039 037
|
100
|
4 000 047
|
100 |
|
Comme la plupart des autres états subsahariens, la Côte d'Ivoire a des frontières qui ont été tracées lors de la colonisation, sans égard pour les réalités ethniques et culturelles. C'est un carrefour composé de peuples, de cultures et de religions très diverses, même si l'on ne prend pas en compte les étrangers (un quart de la population globale), dont, rappelons-le, plus de 47 % sont nés dans le territoire. Toujours est-il que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui une véritablemosaïque culturelle, source à la fois de diversité et donc de richesse, mais aussi de rivalités, de tensions et de turbulences. J. Vallin in J.A./L'Intelligent, 25.10/06.11.2000 : 36). C'est pourquoi il semble intéressant de montrer la répartition de la population par groupes ethniques telle qu'elle figure dans les pages publiées du dernier RGPH. Pour la lecture de la carte et du tableau ci-joints, un certain nombre d'explications semblent nécessaires : + D'une part, toutes les ethnies du pays (on en compte une soixantaine) ne sont pas mentionnées. Seules figurent celles qui comptent environ une centaine de milliers de ressortissants. Telle est la raison pour laquelle le pourcentage par rapport au groupe ethnique n'est jamais égal à 100 %. + Généralement, les appellations habituelles, en français, des ethnies ne diffèrent pas des appellations désignant, dans le parler ordinaire, la langue usitée par le groupe : ainsi les Baoulé (4) parlent le baoulé. Ce n'est pas toujours le cas cependant. "Sénoufo" désigne un groupe ethno-culturel important dont les langues sont, entre autres, le syènambélé, le tagbana, le djimini et le palaka. Mais il est assez fréquent que des documents administratifs parlent globalement de langue sénoufo. Nous avons cru préférable, par conséquent, de ne pas modifier les dénominations utilisées par les sources consultées. + Cependant, la carte linguistique ci-dessous, pour être lisible dans le format du livre, exigeait une assez grande simplification, par exemple pour les langues lagunaires, nombreuses sur un espace limité. Elle permet malgré tout d'avoir une représentation schématique de la répartition des quatre groupes de langues ivoiriennes. + En résumé donc, le pays peut être découpé en 4 zones ethniques, selon des critères essentiellement linguistiques et culturels ainsi que selon un clivage approximatif est /ouest /nord /sud. Chacune de ces zones ethno-linguistiques se poursuit d'ailleurs à l'extérieur des frontières ivoiriennes dans un ou plusieurs des pays voisins. |
|
Ils constituent un peu moins de la moitié de la population de nationalité ivoirienne (42 %) et un peu moins d'un tiers de la population globale. Ils occupent approximativement le sud-est. Comme pour le RGPH de 1988, la progression démographique actuelle du groupe se situe dans la moyenne nationale (3 251 228 en 1988 / 4 780 797 en 1998). Ils parlent des langues relevant du groupe Kwa de la famille Niger-Congo (au total à peu près 17 langues comptant de nombreux dialectes) entre lesquelles il est d'usage de distinguer = + les
langues akan proprement dites : abron, agni, baoulé, + et les langues lagunaires : abé, abidji, abouré, adioukrou, alladian, akyé, avikam (: brignan), ébrié, éga, éhotilé, essouma, krobou, m'Batto, n'zima. (Expression du parlé, Nouvelles Editions Ivoiriennes, 1999). Arrivés en Côte-d'Ivoire par vagues successives entre le 17 et le 18ème siècle, les Akan ont schématiquement pour caractéristiques culturelles : + un système politique centralisé (royaumes Abron, Sanwi, Indénié,...), + un système de parenté à succession matrilinéaire, + une organisation sociale hiérarchisée juxtaposant nobles, hommes libres, captifs* et descendants de captifs, + l'existence de classes* d'âge, notamment chez les Lagunaires. Ce groupe a connu de nombreuses transformations depuis la colonisation : forte scolarisation des garçons et des filles, christianisme ou syncrétismes religieux, agriculture d'exportation diversifiée et rémunératrice, urbanisation intensive, extension démographique vers l'ouest. |
|
Ils constituent 11 % de la population d'origine ivoirienne. Ils occupent le sud-ouest. Par rapport au RGPH de 1988, leur poids dans la population globale a diminué, passant de 14, 6 à 8, 4 %. (1 136 291 en 1988 ® 1 446 790 en 1998). Ils parlent 16 langues assez nettement apparentées et relevant du groupe Kru [kru] de la famille Niger-Congo : ahizi, bakwé, bété, dida, gnaboua, godié, guéré, kodia, kouya, kouzié, krou (: kroumen*), néyo, niédéboua, oubi, wané, wobè. (Expression du parlé, Nouvelles Editions Ivoiriennes, 1999). Là aussi, on peut observer un certain flottement dans les appellations : ainsi Guéré et Wobé appartiennent en fait à l'ethnie Wè. Installés sur le territoire forestier actuellement occupé depuis vraisemblablement la préhistoire, ce groupe est caractérisé par son fractionnement en petites communautés indépendantes, sans pouvoir central, au sein desquelles la seule autorité reconnue est celle de l'aîné du patrilignage, au centre d'un réseau très complexe de relations inter-lignagères La colonisation a connu de nombreuses difficultés à s'imposer dans cette région forestière. Mais les transformations ont ensuite été rapides : taux élevé de scolarisation des garçons et des filles, christianisme et religions syncrétiques chez les autochtones. L'agriculture dynamique (cacao surtout), les produits vivriers, et l'exploitation forestière ont attiré de nombreux allogènes*, tant étrangers qu'ivoiriens. Ainsi, par exemple, dans la région krou du Haut Sassandra ( départements de Daloa, Issia, Vavoua) sur un total de 1 071 977 résidents, les Krou sont seulement 187 727, alors que les Akan sont 238 221, les Mandé nord : 124 919, les Mandé sud : 72 788, les Gour : 65 330 et les non Ivoiriens : 373 422. Dans la région du Bas Sassandra, la proportion des autochtones est encore plus faible, 163 070 contre 435 840 Akan, 75 565 Mandé nord, 41 530 Mandé sud, 74 465 Gour et 596 844 non Ivoiriens. Des faits de même nature peuvent être observés dans l'ensemble de l'aire krou. Ce qui ne va pas sans créer un certain malaise dans cette région, particulièrement avec la crise économique qui vient de secouer la Côte d'Ivoire et avec l'infiltration d'anciens combattants armés venant du Libéria. |
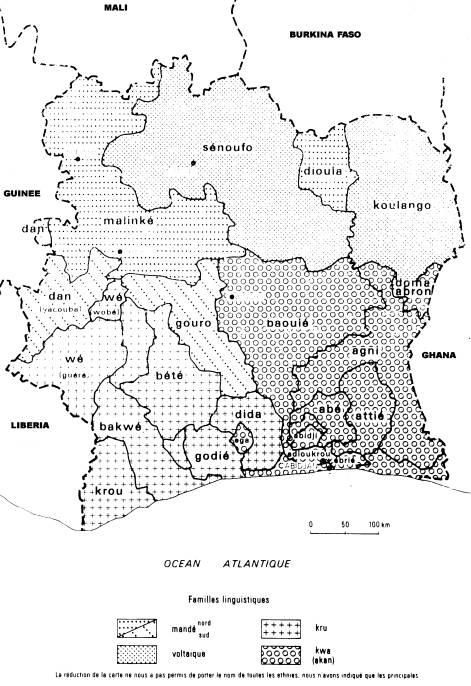 |
|
Il est d'usage d'opérer une partition linguistiquement et culturellement justifiée entre deux sous-groupes séparés depuis fort longtemps et ayant évolué dans des environnements très différents. |
|
Ils représentent 10 % de la population ivoirienne. Ils sont installés de longue date dans le centre et le centre ouest, au nord de l'aire krou. Au nombre de 831 839 en 1988, ils sont, en 1998, 1 142 336. Ils parlent des langues relevant du groupe mandé mais nettement différenciées : gagou (: gban), gouro, mona, n'gain, ouan, toura, yakouba (: dan), yaourè. (Expression du parlé, Nouvelles Editions Ivoiriennes, 1999). L'unité politique de base est le village*. Ils sont patrilinéaires. Le masque* occupe une place essentielle dans leur société. Ils ont un artisanat traditionnel tout à fait remarquable (masques, ponts de lianes,etc.) La colonisation s'est imposée difficilement dans ces régions. Mais l'agriculture s'est développée et est maintenant semblable à celle des groupes kru . |
|
Ils représentent 16,4 % de la population ivoirienne et occupent le nord ouest ainsi que une partie centrale du nord autour de la ville de Kong. Au nombre de 1 236 129 en 1988, ils sont 1 873 200 en 1998 . Ils parlent des langues très fortement apparentées du groupe mandé de la famille Niger-Congo : bambara, dioula*, gbin, malinké (mahou, koyaka, etc.), nigbi. (Expression du parlé, Nouvelles Editions Ivoiriennes, 1999). Une variété de malinké, le dioula tagboussi [: de brousse] s'est imposée comme véhiculaire dans les échanges nord /sud et dans les villes de Côte d'Ivoire. Il est vrai que cette langue permet également les échanges commerciaux avec les populations mandéphones d'un grand nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest : Mali, Burkina, Guinée, etc. Dès le 13ème siècle, (cf. 1.4) la cité de Kong constituait un centre commercial réputé qui servait de carrefour entre le pays de la cola (Worodougou) et les villes du Soudan occidental. Par vagues successives du 14 au 18ème siècle, les Mandé s'installèrent dans le nord-ouest. La société mandé est organisée en lignages patrilinéaires dominés par l'autorité patriarcale. Plusieurs lignages constituent un village, plusieurs villages un canton et plusieurs cantons une chefferie* (ou un royaume). La société est divisée en castes* et caractérisée par une forte islamisation. Ainsi, Binger, lors de son séjour à Kong, (1887-1889), mentionne l’existence d’une vingtaine d'écoles coraniques dans la région et note :"L'instruction est très développée à Kong : il y a peu de personnes illettrées. L'arabe qu'ils écrivent n'est pas ce qu'il y a de plus pur ; on est cependant étonné de les voir aussi instruits, car aucun Arabe n'a jamais pénétré jusqu'à Kong."(1892 : 326) (5). |
|
Groupe
ethnique
|
Recensement
global
|
ethnies
principales
|
%Îau
groupe ethnique
|
%
Par rapport à la pop ivoir.
|
%
Par rapport à la pop. totale
|
|
Baoulé
|
|
2
629 438
|
55,0% |
23,4% |
17,1% |
|
Agni
|
|
755
355
|
15,8% |
6,7% |
4,9%
|
|
Akié
(Attié)
|
|
473
298
|
9,9% |
4,2%
|
3,1%
|
|
Abé
|
|
196
012
|
4,1% |
1,7%
|
1,3%
|
|
Abron
(Doma)
|
|
162
547
|
3,4% |
1,4%
|
1,1%
|
|
Adioukrou
|
|
119
519
|
2,5% |
1,1%
|
0,8%
|
|
Ebrié
|
|
109
958
|
2,3% |
1,0%
|
0,7%
|
|
N’zima
(Appolo)
|
|
81
273
|
1,7% |
0,7%
|
0,5%
|
|
Abouré
|
|
66
931
|
1,4% |
0,6%
|
0,4%
|
|
Abidji
|
|
62
150
|
1,3% |
0,6%
|
0,4%
|
|
Alladian
|
|
28
684
|
0,6% |
0,3%
|
0,2%
|
|
Avikam
(Brignan)
|
|
23
903
|
0,5% |
0,2%
|
0,2%
|
|
Ahizi
|
|
19
123
|
0,4% |
0,2%
|
0,1%
|
|
AKAN
|
4
780 797
|
4
728 191
|
98,9%
|
42,5%
|
31,1%
|
|
Bété
|
|
492
089
|
34,0%
|
4,4%
|
3,2%
|
|
Guéré
|
|
294
251
|
20,3%
|
2,6%
|
1,9%
|
|
Dida
|
|
180
307
|
12,5%
|
1,6%
|
1,2%
|
|
Wobè
|
|
143
995
|
10,0%
|
1,3%
|
0,9%
|
|
KROU
|
1
446 790
|
1
110 642
|
76,8%
|
12,9%
|
9,4%
|
|
Malinké
|
|
996
542
|
53,2%
|
8,9%
|
6,5%
|
|
Dioula
|
|
505
764
|
27,0%
|
4,5%
|
3,3%
|
|
Mahou
|
|
215
418
|
11,5%
|
1,9%
|
1,4%
|
|
Koyaka
|
|
101
152
|
5,4%
|
0,9%
|
0,7%
|
|
MANDE
NORD
|
1
873 200
|
1
818 876
|
97,1%
|
16,7%
|
12,2%
|
|
Yakouba
(Dan)
|
|
629
427
|
55,1%
|
5,6%
|
4,1%
|
|
Gouro
|
|
383
824
|
33,6%
|
3,4%
|
2,5%
|
|
MANDE
SUD
|
1
142 336
|
1
013 251
|
88,7%
|
10,2%
|
7,4%
|
|
Sénoufo
|
|
1
185 288
|
59,2%
|
10,5%
|
7,7%
|
|
Koulango
|
|
289
338
|
14,4%
|
2,6%
|
1,9%
|
|
Lobi
|
|
205
529
|
10,3%
|
1,8%
|
1,3%
|
|
Tagwana
|
|
183
580
|
9,2%
|
1,6%
|
1,2%
|
|
Djimini
|
|
125
712
|
6,3%
|
1,1%
|
0,8%
|
|
GOUR
|
2
002 625
|
1
989 447
|
99,3%
|
17,8%
|
13,0%
|
|
Sous
total
|
11
245 748
|
10
660 407
|
|
|
|
|
Naturalisés&
Sans
|
120
877
|
|
|||
|
Total
pop nat
|
11
366 625
|
|
|||
|
Étrangers
|
4
000 047
|
|
|||
|
Total
pop
|
15
366 672
|
|
|
Ils représentent 17,5 % de la population d'origine ivoirienne et occupent le nord-est. Au nombre de 1 266 234 en 1988, ils sont 2 002 625 en 1998. Ils parlent des langues Voltaïques [gur] de la famille Niger-Congo : birifor, degha (: deya), gondja, gouin (: kirma), kamara, komono, koulango, lobi, lorhon (: téguéssié), nafana, samogho, sénoufo (syènambélé : tagbana, djimini, palaka), siti (: kira), toonie. (Expression du parlé, Nouvelles Editions Ivoiriennes, 1999). Les Gour, installés depuis plus d'une dizaine de siècles, dans les savanes du Nord, sont organisés en grands lignages matrilinéaires (à l'exception de ceux de Boundiali qui sont patrilinéaires). L'unité politique est le village et l'institution centrale des Sénoufo est le poro* dont les femmes sont exclues et qui marque profondément leur organisation sociale et leur culture. Le Sandoho féminin, lui, assure la pérennité des matrilignages et fournit les devins. Essentiellement agriculteurs et artisans, traditionnalistes*, animistes* ou islamisés, les Gour sont restés dans l'ensemble pendant longtemps assez en marge de la scolarisation et de la modernisation. |
|
Aux différenciations ethniques, linguistiques et socioculturelles de la Côte-d’Ivoire, renforcées parfois par l'apport démographique d’immigrés d’ethnies apparentées provenant des pays voisins, la religion ajoute une nouvelle partition, non seulement forêt /savane mais encore milieu urbain /milieu rural. + En 1998, comme en 1975 et en 1988, la religion musulmane constitue la religion dominante du pays. Cela s'explique en partie par l’importante immigration en provenance notamment des pays frontaliers du Nord et de l'Ouest, très fortement islamisés : Mali, Guinée, Burkina-Faso. L'Islam est donc majoritaire quel que soit le milieu mais il l'est plus en milieu urbain (46 %) qu' en milieu rural (25 %) + Les chrétiens ou les adeptes de religions syncrétiques comme le harrisme* sont majoritairement présents dans le sud et en milieu urbain : catholiques : près de 23, 3 % de la population urbaine, et 16, 4 % du monde rural, protestants : 6, 9 % dans les villes et 6, 4 % en milieu rural. |
| RELIGION |
effectif |
|
effectif |
|
|
catholique
|
2
247 762
|
20,8
|
2
976 023
|
19,4
|
|
protestant
|
572
376
|
5,3
|
1
018 402
|
6,6
|
|
harriste*
|
154
069
|
1,4
|
197
515
|
1,3
|
|
autres
chrétiens
|
-
|
-
|
470
495
|
3,1
|
|
musulmans
|
4
182 410
|
38,4
|
5
931 958
|
38,6
|
|
animiste*
|
1
840 297
|
17,0
|
2
569 032
|
11,9
|
|
autres
religions
|
368
648
|
3,4
|
136
904
|
1,7
|
|
sans
religion
|
1
452 132
|
13,4
|
2
569 032
|
16,7
|
|
non
déclarés
|
-
|
-
|
108
648
|
0,7
|
|
Total
|
10 815 694
|
100,0
|
15 366 672
|
100,0
|
|
+ L'animisme* est, en fait, la deuxième religion du monde rural (17, 6 % contre 4, 2 % en ville). Mais cette proportion pourrait bien être sous-évaluée dans le recensement de 1998. En effet, dans le monde rural, semble-t-il, la population a une certaine réticence à déclarer sa véritable appartenance religieuse car on y observe une proportion non négligeable de "sans religion", ce qui peut paraître surprenant dans un univers africain, traditionnel, par essence même religieux. |
|
On ne connaît pas grand chose du lointain passé, les recherches archéologiques étant difficiles en zone forestière. Le pays semble cependant avoir été peuplé par vagues successives depuis le néolithique. Nous nous en tiendrons aux évènements les plus connus de l’histoire relativement récente. |
|
Dès le Xème siècle, le commerce transsaharien atteint le nord ivoirien (or, sel, noix* de cola). Les premières populations manden s'établissent aux environs du XIIIème siècle à la lisière de la grande forêt. Tandis que se constituent les empires du Ghana, du Mali et du Songhay, dans le nord ivoirien, peu à peu se créent des villes (: Kong, Bondoukou) afin d'ouvrir des marchés le long de circuits commerciaux unissant le pays ashanti au Niger. Au XVIIIème siècle, Kong devient, durant le règne de Sékou Ouattara, le centre de l'empire des Manden Dioula*, (: commerçants musulmans) qui va jusqu'à l'actuelle Bobo Dioulasso (actuellement au Burkina). Le pouvoir animiste traditionnel de la région est peu à peu renversé et les populations locales sont islamisées, à l'exception des Sénoufo et des Lobi (vraisemblablement présents dans la région depuis le XIème siècle) qui conservent leur identité animiste et leurs coutumes. Vers le XVIIIème siècle a lieu également la grande migration des Akan, (les Baoulé, venus de l'actuel Ghana, sous la conduite de la Reine Abla Pokou). Ceux-ci instaurent, au centre du pays, un pouvoir centralisé de royaumes dirigés par des souverains absolus, ce qui constitue un mode de société très différent de celui des populations forestières déjà présentes, placées sous l'autorité des Anciens*. |
|
Mais déjà, dès le XVème siècle, les explorateurs portugais sont parvenus jusqu'à la côte de Guinée à laquelle ils donnent des dénominations rappelant, soit l'hostilité des populations : Costa de Mala Gens (nom dont provient l'appellation "malaguette*" désignant le poivre* de Guinée), soit l'intérêt majeur qu'ils y découvrent : "Côte des dents*", "Côte du morphil*", ancêtre de l'actuel "Côte-d'Ivoire". C'est à eux que l'on doit également certains toponymes encore utilisés : Sassandra, Fresco, San Pedro, etc. Au XVIIème siècle arrivent les Hollandais, puis les Anglais. Le commerce côtier porte sur les épices, l'ivoire, les étoffes de coton et les esclaves. Mais il se déroule surtout en mer, à bord des caravelles, car peu de comptoirs sont installés sur la côte trop inhospitalière. Quant aux Français, venus les derniers, ils s'intéresseront d'abord peu à cette région d'accès difficile et se contenteront ensuite pendant un certain temps de signer des traités d'amitié avec les populations agni du littoral en ouvrant quelques missions vouées généralement à une disparition rapide. On connaît la célèbre histoire des deux jeunes "princes" d'Assinie, emmenés et élevés à la cour de Louis XIV et l'échec des espoirs fondés sur l'opération du retour d'Aniaba dans son pays. A partir de 1830 cependant, Anglais et Français rivalisent dans la région pour s'assurer par des traités avec les chefs locaux le monopole du commerce de l'ivoire, de l'or ou de l'huile* de palme. Les Français ouvrent des comptoirs à Assinie et Grand-Bassam, placent le royaume de Sanwi, encore inexploré "sous la protection" de Louis-Philippe (1842-43), fondent le fort de Dabou (1853). Le négociant Verdier introduit la culture du café (1870) et l'officier Binger (futur premier gouverneur du pays) fonde la Compagnie de Kong pour gérer les plantations de café. Un partage des zones d'influence intervient entre la France et l'Angleterre (Congrès de Berlin, 1885). Aussi Treich-Laplène (agent du négociant Verdier) remonte le long de la Comoé, atteint Bondoukou puis Kong, en signant tout le long de son voyage des traités avec les populations. Enfin, Binger avec une expédition partie de Bamako, rejoint Treich-Laplène à Kong et ensemble ils redescendent vers Grand-Bassam (mars 1889). Cependant, dans son expansion vers le nord, la France se heurte au conquérant manden Samory Touré qui, en 1897, fait raser Kong pour avoir pactisé avec les Français. Mais, après d’âpres combats, Samory doit se rendre aux Français et est déporté. |
|
Le décret du 10 mars 1893 érige la Côte-d'Ivoire en colonie française et en délimite les frontières, proches du tracé actuel, hormis l'intégration (provisoire), au nord, de la Haute Côte d'Ivoire (maintenant appartenant au Burkina). Binger en est le premier gouverneur. En 1905, la colonie de Côte-d'Ivoire est rattachée à l'A.O.F. Pourtant, dans les faits, les populations résistent farouchement et les diverses régions ne sont conquises qu'une à une. Active jusque vers 1915 (révolte des Bété, des Baoulé), la résistance aux colons français devient ensuite passive. La mise en valeur économique du pays est entamée et confiée à des grandes compagnies (SCOA, CFAO, etc.). Cependant les administrateurs français négligent pratiquement le Nord et l'Ouest du pays et s'intéressent essentiellement au Sud. Les colons aménagent la côte et développent quelques infrastructures routières (grâce au travail* forcé) et médicales. Ils favorisent l'implantation de cultures d'exportation. dans le territoire forestier. Pour la main d'oeuvre indispensable, ils recrutent des travailleurs dans le nord du pays ou les territoires voisins. Et on voit peu à peu apparaître dans le sud un important groupe de planteurs africains qui développent la culture du café puis du cacao et dès 1920, s'unissent en associations. Au cours des deux guerres mondiales, les Français mettent la colonie à contribution : recrutement de soldats, accroissement du travail forcé, fourniture gratuite de certains produits (caoutchouc). Le durcissement du régime et la pression économique des années 40 provoquent le mécontentement des populations et la montée du nationalisme. En 1946, pour la première fois, la colonie participe aux élections françaises. Félix Houphouët Boigny, un Baoulé, qui a pris la tête d'un syndicat de planteurs de cacao à l'origine du Parti démocratique de Côte-d'Ivoire (PDCI), section ivoirienne du Rassemblement démocratique africain (RDA) fondé en 1946 à Bamako, est élu député de la Côte-d'Ivoire à l'Assemblée française. Il est à l'origine de la loi abolissant le travail forcé dans les territoires d'Outremer, statut auquel vient d'accéder son pays. D'abord apparenté au Parti Communiste français, le PDCI-RDA s'oppose violemment à l'administration française. Mais, en 1951, Houphouët adopte une stratégie de coopération et rallie l'Union démocratique et socialiste de la Résistance (dont fait partie le Ministre de la France d'Outremer d’alors, François Mitterand). Il participe à l'élaboration des réformes qui débouchent enfin sur la décolonisation. Le 4 décembre 1958, la Côte-d'Ivoire devient une république au sein de l'Union française avec Houphouët comme Premier Ministre. Celui-ci est choisi comme président lors des élections qui suivent la proclamation de l'lndépendance le 7 août 1960. |
|
La Côte-d'Ivoire s'affirme alors comme le pays le plus riche de l'AOF, enlevant au Sénégal son ancienne prépondérance. Abidjan, la capitale* (après Grand Bassam et Bingerville), est devenue et centre financier et port de mer avec l'ouverture du Canal de Vridi. Houphouët-Boigny renforce son pouvoir, écarte l'un après l'autre ses successeurs éventuels, établit le régime de parti unique qui crée une stabilité politique et favorise ainsi une forte croissance économique (1960-1970) dans laquelle les Baoulé occupent une place prépondérante. Malgré cette prospérité relative, d'autres ethnies se sentent lésées et font resurgir les particularismes locaux. D'abord, les Agni qui ne sont plus le pôle économique dominant comme à l'époque coloniale, puis les Bété, (marginalisés par les colons) qui avaient déjà mis en place une opposition à Houphouët en créant un autre syndicat agricole : la Mutualité bété et qui se présentent contre le PDCI en tant que MSA (Mouvement socialiste africain). En 1970, une révolte à Gagnoa est durement réprimée. Les tensions avec les ethnies Krou dans leur ensemble resteront fortes. Au contraire des Bété, les populations du Nord, notamment Dioula et Sénoufo, participent par leurs migrations vers le sud au grand brassage ethnique préconisé par le Président et appuient ce dernier. Mais dès lors que la prospérité s'affaiblit, la politique capitaliste et paternaliste d'Houphouët-Boigny suscite une opposition croissante (manifestations étudiantes, conspirations dans l'armée). Malgré cela, au cours des années 80, le président entreprend des travaux grandioses, notamment à Yamoussoukro, son "village*" natal où vient d'être transférée la capitale (1983). Or l'économie est frappée par la baisse des cours mondiaux du café et du cacao (le cacao payé à l'exploitant passe de 400 FCFA en 1986 à 200 FCFA en 1990 !! ). En proie à la "conjoncture*", le pays est amené à suspendre le remboursement de sa dette. La pression de l'opposition s'accentue et le multipartisme est instauré. L'opposition dirigée par l'historien bété Laurent Gbagbo, député du FPI (: Front populaire Ivoirien), qui a connu la prison de 1971 à 1973 et l'exil forcé de 1982 à 1988, est cependant battue aux élections présidentielle de 1990. Une quarantaine de partis (dont la plupart disparaîtront rapidement), occupent la scène politique et la démocratie naissante est encore très fragile. La contestation étudiantine est durement réprimée en 1991. Gbagbo est condamné à deux ans de prison en 1992, tandis que les trois plus grands créanciers du pays, le FMI, la Banque Mondiale et la France (: Caisse de Coopération économique) tentent d'obtenir un assainissement de la crise économique par des mesures impopulaires : compressions du service public hypertrophié, privatisation à outrance, dévaluation du franc CFA, etc. En 1990, le président nomme l'économiste dioula Alassane Dramane Ouattara au poste de Premier Ministre. Compte-tenu de son âge avancé, Houphouët-Boigny prépare enfin sa succession en faisant amender la constitution. Désormais, en cas de vacance du pouvoir, c’est le président de l'Assemblée nationale qui achèvera le mandat présidentiel. Donc, lorsqu'après 33 ans de pouvoir sans partage, Félix Houphouët-Boigny meurt le 7 décembre 1993, Henri Konan Bédié, un autre Baoulé, président de l'Assemblée nationale, assure l'intérim puis est élu président le 22 octobre 1995 avec 62 % des voix. Le climat économique semble plus favorable : reprise de la croissance, inflation modérée mais l'atmosphère politique est alourdie par les partis d'opposition qui ont boycotté l'élection en raison de mesures mal perçues : retrait du code électoral, interdiction des manifestations, etc. L'insécurité urbaine devient préoccupante, les investisseurs étrangers se font prier, l'opinion publique et les milieux d'affaires restent sceptiques sur la volonté du gouvernement de mettre fin à une corruption endémique (procès de Roger Nasra accusé d'avoir détourné près d'un milliard de FCFA des caisses du Trésor public). Et, malgré une hausse des salaires dans le secteur agro-industriel, une forte proportion de la population urbaine vit toujours au-dessous du seuil de pauvreté. Le Président Bédié s'enferme dans une impasse politique et économique, puis se crispe sur la bataille politico-juridique qu'il mène contre son rival potentiel, Alassane Dramane Ouattara, ancien Premier Ministre et ex-directeur général adjoint du FMI, candidat lui aussi à l'élection présidentielle d'octobre 2000. Il s'agit de démontrer que ce rival n'est pas ivoirien (au titre du principe de l'ivoirité*) et que, de ce fait, il ne peut briguer la magistrature suprême. Ce qui mécontente les partisans de celui-ci, nombreux en zone urbaine et dans le nord du pays. Or, la crise économique est sévère : chute des cours du café et du cacao, suspension des aides du FMI, de la Banque Mondiale et de l'Union Européenne après les dérapages budgétaires et des détournements de fonds. ("scandale des 18 milliards de francs CFA de l'Union Européenne"). Bref, à la suite d'une prime non versée aux militaires, une mutinerie éclate et la Côte d'Ivoire connaît le 23 décembre 1999 le premier coup d'état de son histoire. Henri Konan Bédié est renversé et contraint de quitter le pays tandis que s'installe au pouvoir le Général Robert Gueï qui est à la tête de la junte militaire. Ce dernier déclare avoir trouvé les caisses vides et lance une opération « mains propres » sans beaucoup de résultats. Manquant de fonds, la junte donne la priorité au paiement des salaires et sacrifie le remboursement de sa dette dont les arriérés s'élèvent à plus de 10 milliards de francs. La crise est grave car seule la France a promis une aide d'urgence mais seulement après les législatives de 2000 qui devraient amener le retour du pays dans la voie démocratique. A l'élection présidentielle, le 22 octobre 2000, à laquelle Alassane Ouattara ne participe pas pour cause de « non ivoirité" », Gueï est battu et l'opposant historique se réclamant du socialisme, Laurent Gbagbo est élu. De graves violences suivent : celles exercées par des militaires contre les partisans de L. Gbagbo, puis celles de ces derniers soutenus par la police et la gendarmerie contre les partisans d'A.Ouattara. Le nouveau gouvernement entreprend un certain nombre de réformes mais il ne connaîtra qu'un bref état de grâce (découverte d'un charnier de 57 civils à Yopougon qui ravive les tensions). Alors que la classe politique cherche à se rassembler dans un "forum de réconciliation" auquel prennent part tous les partis politiques car une profonde fracture est en train de s'agrandir entre le sud chrétien et le nord musulman, la réconciliation amorcée s'effondre avec un second coup d'état particulièrement meurtrier, le 19 septembre 2002. Et le pays semble s'enfoncer dans une sorte d'amorce de guerre de sécession nord /sud aux issues pour l'instant bien difficiles à percevoir (6). |
|
Selon l'article 1 de la Constitution ivoirienne, la seule langue officielle du pays est le français. Mais, nous l'avons vu, la Côte-d'Ivoire est un véritable carrefour linguistique dans lequel toutes les langues parlées localement ne présentent pas le même statut. |
|
La grande majorité des langues ivoiriennes, bien que symbolisant l'appartenance à un groupe déterminé et constituant le facteur fondamental de cohésion du groupe, n'ont qu'une utilisation intra-ethnique. Les seules différences statutaires qui s'établissent entre elles, sont en relation avec le nombre de dialectes qu'elles comptent et l'étroitesse de la parenté linguistique qui lient ceux-ci, le nombre des locuteurs-natifs et le poids économique de la région d'implantation. Tous ces facteurs sont importants pour déterminer le taux de perméabilité linguistique et le taux d'expansion. Généralement, les langues dont les locuteurs-natifs dépassent la centaine de milliers ont une assez faible perméabilité linguistique tandis que leur dynamisme, réel, demeure cependant limité à leur environnement géographique. (Lafage, 1996 : 588) (7). |
|
Un seul document officiel fait référence à des langues nationales bien que les langues pouvant recevoir cette appellation ne soit pas mentionnées expressément. Il s'agit du texte d'une loi portant sur la réforme de l'enseignement, adoptée le 16 août 1977 par le parlement ivoirien (titre VIII, article 67). Selon l'article 68 de la même loi, l'Institut de Linguistique Appliquée de l'Université d'Abidjan (: I.L.A) est chargé de préparer l'introduction des langues nationales dans l'enseignement. Mais les textes définissant les modalités d'application de la loi de 1977 n'ont jamais paru. Cependant, les chercheurs se sont mis en devoir de réaliser des descriptions scientifiques complètes, de préparer du matériel didactique, d'engager des expérimentations, en un premier temps pour quatre langues démographiquement dominantes et régionalement dynamiques, représentant chacune un des quatre principaux groupes linguistiques répertoriés dans le pays : le baoulé pour le groupe Akan , le bété pour le groupe Krou, le dioula pour le groupe Mandé et le "sénoufo" pour le groupe Gour. En fait, l'ILA et la SIL (: Société Internationale de Linguistique) ont accompli ensuite un travail similaire pour toutes les langues ayant un certain poids démographique. Treize langues vernaculaires (comprenant une langue gour étrangère, le mooré, représentant l’ethnie majoritaire de la plus importante communauté de résidents étrangers en Côte-d'Ivoire, les Burkinabè) ont obtenu de facto un statut de langue nationale car on leur a accordé un rôle d'une certaine importance à la radio, à la télévision, et même mais seulement pour les langues ivoiriennes, dans l'alphabétisation, le pré-scolaire et quelques expériences d'enseignement dans le primaire. |
|
De jure, la communication à l'échelle de la nation repose sur le français langue officielle mais aussi langue étrangère importée. Cependant de facto des solutions locales apparaissent : les véhiculaires que l'on pourrait définir comme "[.] tout parler spécifique à fonction interethnique impliquant une prédominance de locuteurs non-natifs ainsi que des modifications de la structure linguistique engendrées par cet usage particulier". (Lafage, 1982 : 13) (8). Deux parlers largement usités présentent localement et cette fonction et cette fonctionnalisation : le dioula tagboussi [djula tagbusi] et le français populaire ivoirien (F.P.I). Une enquête de 1992 montre d'ailleurs que le bilinguisme oral français-dioula est majoritaire (58,9 % ) sur les marchés d'Abidjan (Kouadio N'Guessan et als, 1992 : 111-191) (9). |
|
C'est un parler mandé nord propre aux "Tagboussi" c'est-à-dire à "[.] tout Manding ivoirien ou non, et même toute personne, originaire du Nord et de religion musulmane, née dans le sud de la Côte d'Ivoire" (Téra in Braconnier, Maire, Téra, 1983 : 17) (11). Il a donc des locuteurs permanents, les Tagboussi mais aussi des locuteurs occasionnels bien plus nombreux : tout mandéphone du nord ivoirien aux parlers maternels fortement apparentés, tout mandéphone étranger d'immigration récente, (les "Nagboussi"), et même de fort nombreux locuteurs de toutes origines, puisqu'il s'agit du vecteur du petit commerce, des transports, des échanges nord / sud. Selon une enquête déjà ancienne, (Atin, 1978 : 80) (12) en 1978, le dioula tagboussi était utilisé par 47,7 % de la population. Lié à l'Islam et à l'urbanisation, malgré certaines réticences des ethnies côtières, ce véhiculaire n'a cessé depuis de s'étendre. Langue maternelle d'une partie de la population et langue seconde d'une majorité des Ivoiriens, à des degrés divers, le dioula tagboussi est né d'une nécessité d'uniformisation visant à satisfaire des besoins de communications intra-dialectaux et inter-ethniques. C'est cette fonctionnalisation qui fournit à la Côte-d'Ivoire un manding commun, à la fois différent des dialectes du terroir ouest ivoirien ou de Kong, mais également différent des parlers guinéen et malien, d'où son nom mélioratif de "dioula de Côte-d'Ivoire". C'est aussi ce qui, à côté de traits stables caractéristiques, en fait un parler « particulièrement mouvant [.] à cause de l'arrivée continuelle de nouveaux immigrants qui s'intègrent aux familles déjà installées, provoquant nouvelles modes et mimétismes chez les enfants des familles hôtes ». (Tera in Braconnier et als, 1983 : 20.) (13). Doté actuellement d'une écriture, de descriptions linguistiques, de dictionnaires et de quelques manuels, ce parler est également objet d'enseignement à l'université et quelques expérimentations didactiques dans le primaire ont eu lieu en divers points du pays. On verra plus loin la place que lui confère actuellement son hybridation avec le français de la rue. |
|
C'est vraisemblablement la variété de français autochtone la plus ancienne du pays mais ce n'est plus aujourd'hui qu'une des variétés locales dans le système de variétés que constitue la langue officielle en Côte d'Ivoire car, avec l'extension de la scolarisation, sa place tend à se réduire en même temps que le nombre des analphabètes et semble devoir bientôt se limiter aux plus de quarante ans ou aux immigrés de fraîche date. Mais on peut en retrouver l'influence profonde dans tout français ivoirien actuel. Cette variété qu'on appelera plus tard "français populaire ivoirien" a été introduite dans le pays à la fin du XIXème siècle avec la conquête militaire. A l'origine, c'est une sorte de sabir le « forofifon naspa » utilisé par les militaires, les administrateurs ou les négociants pour communiquer avec leurs auxiliaires africains et éventuellement en former de nouveaux. Son expansion est vraisemblablement le fait des militaires soudanais (ceux que l'on appelle alors, à tort, les "tirailleurs sénégalais" mais qui sont généralement issus des actuels Mali et Burkina), enrôlés dans les troupes coloniales. Car, comme le souligne Manessy en parlant du Mali (1979 : 334) (14), dès 1882 (mais sans doute un peu plus tardivement en Côte d'Ivoire), l'instruction publique a été, en un premier temps, confiée à des sous-officiers ou à des interprètes locaux dans les principales bourgades, même si, à partir de 1895, le gouverneur Binger fait appel aux missionnaires de la Société des Missions Africaines de Lyon à qui il confie l'enseignement dans la nouvelle colonie et qui s'installeront d'abord dans le sud et le centre. Ce parler rudimentaire se répand par la suite et se complexifie par nécessité avec les garde-cercle* et les migrations du travail* forcé. Mais son implantation va s'accélèrer avec le retour au pays des anciens combattants de 14-18, puis de 39-45. Il s’étendra enfin grâce au "miracle ivoirien" qui suit l'indépendance, par l’accélération de l'exode rural et l’accroissement de l'immigration étrangère. En effet, né de statégies de communications par contacts directs, de stratégies d'apprentissage non guidé, développé par le besoin d'intercommunication intense dans l'hétérogénéité urbaine, accru par l'extrême mobilité des populations, par un brassage ethnique qui touche même le plus petit village, cette sorte de "français parlé approximatif" fonctionne comme un sociolecte. Il semble en effet l'apanage d'une classe socialement relativement homogène quoique linguistiquement hétérogène, celle des "petits*" (mais non celle des "en bas d'en bas*" ), persuadés que toute promotion sociale passe par l'acquisition du français, fût-il des plus imparfaits. Le FPI concrétise aussi le désir d'intégration locale des immigrés de toutes origines par l’apprentissage sur le tas, du parler estimé le plus utile. Dès les années 60, beaucoup d'enfants des quartiers populaires, parfois avant même la scolarisation, possèdent le FPI comme langue de la rue, parallèlement à la langue africaine familiale (qui peut changer d'un foyer à un autre). On l'utilise donc, en ville, à l'école maternelle comme transition vers le français plus "académique"du primaire. Mais bien des scolarisés en conservent au delà de l'école, l'usage occasionnel dans la vie quotidienne, comme un mode d'expression parallèle au "gros français*" de l'administration, de la politique et des circonstances formelles. En somme, tout se passe comme si s'installait, pour l'utilisation locale du français, une sorte de diglossie véhiculaire. Quantifier le nombre de locuteurs du FPI est une entreprise périlleuse. On ne peut qu’en tenter une approximation relative. Ainsi, si l'on considère comme essentiels locuteurs "naturels" de ce français approximatif, les résidents de 6 ans et plus, décrits comme francophones analphabètes, on peut grâce au RGP (: Recensement général de la population) de 1975 les évaluer déjà à 686 000 (sur 1 864 100 Francophones des deux sexes répertoriés) et grâce à l'EPR de 1978 (: Enquête à passages répétés) à 852 000 sur 2 529 400 Francophones des deux sexes répertoriés), ce qui souligne la rapidité de la diffusion du français dans la population alphabétisée ou non. De nombreux travaux ont tenté la description scientifique de ce FPI, appelé aussi FPA (Français populaire d'Abidjan) car il est évident qu'il s'est particulièrement répandu dans la mégapole du sud (15). Il apparaît, en fait, comme une sorte de « pré-créole continuum », système de variétés très approximatives et encore assez instables, en voie de créolisation sur certains points, dans lequel trois modèles d'évolution se font jour : une restructuration interne sur le modèle des langues africaines (spécialement les plus répandues comme le dioula et le baoulé) ; une restructuration sur le modèle de la langue-cible, pas forcément d'ailleurs en totale conformité avec ce modèle ; et une restructuration interne, à la fois indépendante des diverses langues sources et de la langue cible. (cf. Hattiger, 1983) (16). L'importance sociale du FPI est illustrée par les abondantes représentations écrites stéréotypées que l'on peut trouver dans le théâtre (cf par exemple la "pièce "L'oeil" de Bernard Zadi Zaourou), dans la presse (anciennes rubriques de "Moussa" du défunt Ivoire-Dimanche, journal "Zazou" des années 80, et actuels "Gbitch!" et "Ya Fohi*"), les bandes dessinées comme "Dago à Abidjan" etc. Il s'agit là, bien évidemment, de pastiches à des fins humoristiques, produits par des intellectuels dont le FPI n'est pas le mode usuel de communication en français mais dont l'observation est assez fine quoique surtout orientée vers les traits les plus différenciateurs. Les spécialistes désignent ces représentations stéréotypées des années 1970-1980 par l'appellation "français* de Moussa" (le locuteur type étant le paysan du Nord, héros de chroniques bien connues) ou "Français* de Dago" (le locuteur type étant le paysan du sud-ouest, héros de la célèbre bande dessinée). Cependant, avec la démocratisation massive de l'enseignement, touchant, à presque parité dans le sud les filles et les garçons, avec les efforts de l'alphabétisation en français diffusée auprès de jeunes adultes, le FPI, sans disparaître totalement, semble actuellement n’exister sous sa forme pidginisée des années 70 que chez les peu ou non scolarisés les plus âgés ou à l’intérieur du monde rural . Partout ailleurs, il s’est fondu dans la communication ordinaire, non sans se transformer quelque peu, l'urbanisation ayant engendré un certain nombre de remises en cause des valeurs anciennes traditionnelles, ce qui ne va pas sans conflits sociaux, adaptations linguistiques et besoins communicatifs impératifs à assouvir. Mais nous reviendrons plus loin sur les nouveaux avatars du français populaire ivoirien. |
|
Sauf parfois dans sa période récente, l'histoire de l'implantation du français langue officielle en Côte-d'Ivoire ne diffère guère de celle des autres colonies africaines de la France. On en trouvera un excellent résumé chez Quéffelec (17) et, en ce qui concerne plus précisément la Côte-d'Ivoire, le récit détaillé dans l'ouvrage de Désalmand (18). Dès l'implantation de l'administration coloniale, et en quelques points du sud du pays, quelques années avant celle-ci, l"importation" du français par le canal de l'école, a été un des soucis majeurs des colons, l'objectif étant essentiellement en un premier temps de former des auxiliaires et des cadres subalternes. La Côte-d'Ivoire connut donc, comme tout le reste de l'Afrique française d'alors, les mêmes développements et les mêmes problèmes : arrivée puis implantation des Missionnaires et des Soeurs, rivalités entre missions catholiques et protestantes (ces dernières étant suspectées d'agir pour le compte des Anglophones), installation d'écoles religieuses, puis ouvertures des premières écoles laïques, organisation d'un système scolaire à travers toute l'A.O.F (arrêtés du 24 novembre 1903), enfin, le 1er janvier 1904, suppression de toute subvention aux écoles confessionnelles, ce qui a eu pour effet, durant un certain temps, la marginalisation de leur survie. La guerre de 1914-18 et, dit-on, la crainte du communisme international entraînèrent ensuite une attitude plus conciliante de l'administration qui, le 14 février 1922, signa un décret règlementant l'enseignement privé et l'exercice de la propagande confessionnelle en A.O.F., interdisant par exemple l'emploi dans les cultes de langues autres que le français, le latin et les langues locales. De 1903 à 1945, l'enseignement colonial proprement dit, qui, peu à peu, s'organisait, fonctionna avec des programmes "adaptés", tout-à-fait distincts des programmes français (contrairement au mythe fort répandu et décrié de "Nos ancêtres les Gaulois"), sauf dans quelques écoles urbaines dites "écoles européennes". (4 à Abidjan en 1944 !). Ce n'est donc qu'à partir de 1945 (Conférence de Brazzaville) que l'organisation de la scolarisation en Côte-d'Ivoire tendra à devenir plus ou moins calquée sur le modèle métropolitain. Dès 1946, s'ouvre donc "l'ère de décolonisation" de l'éducation. C'est un vif engouement pour l'enseignement de type français. En 1949, l'école primaire devient obligatoire, les effectifs sont multipliés par trois. On crée des "cours normaux" où les moniteurs sont formés en trois ans et les instituteurs en quatre. L'enseignement secondaire est institué et le pays envoie déjà quelques étudiants poursuivre leurs études supérieures en France ou à l’étranger. Lors de l'Indépendance, le pays est donc déjà caractérisé par la diglossie enchâssée dont il connaît encore des traces encore aujourd'hui : + d'une part, diglossie entre le français « variété haute » remplissant toutes les fonctions afférentes au pouvoir et les langues africaines, assimilées à des « variétés basses » (vie quotidienne, famille, marché, etc.); + d'autre part, « français de l'élite », proche de la norme du colonisateur et « FPI », variété locale pidginisée usitée par une partie sans cesse croissante des masses populaires peu ou non scolarisées. Cette vision des faits existe toujours au moins pour une partie des intellectuels ivoiriens comme français, même si dans les faits observables sur le terrain, le « français des élites » et le FPI tendent maintenant à se fondre en un ensemble de variétés d’un français régionalisé commun. La constitution de 1960 (article 1) avait fait du français, nous l’avons vu, la seule langue officielle afin qu'il réponde à trois objectifs : - servir de vecteur à l'unité nationale contre d'éventuels particularismes locaux, - ouvrir largement le pays au développement technologique et aux grands échanges internationaux, - être le medium de la gestion du pays. Telles semblent être encore les objectifs officiels avancés par les autorités du pays. |
|
La démocratisation de l'enseignement est alors activement menée. Des écoles, des collèges, des lycées, des lycées professionnels sont créés dans toutes les régions, une université s'ouvre à Abidjan. Jusqu'à la récession, l'Etat ivoirien consacrera 42 % de son budget de fonctionnement et 13 % de son budget d'investissement à l'éducation et à la formation ; les salaires des enseignants seront décrochés de la fonction publique de façon à attirer les meilleurs éléments nationaux et la Coopération Culturelle avec la France mais aussi avec les autres pays francophones (Belgique, Québec) se développera intensément et avec succès afin de suppléer à un certain manque de personnel qualifié durant les premières années. |
|
|
1975 |
1978 |
1980 |
1990 |
|
francophones
non scol. (H) |
18,3% |
19,9% |
20,9% |
21,9% |
|
francophones
non scol. (F)
|
7,6% |
8,5% |
9,9% |
15,0% |
|
Ensemble
|
13,2% |
14,1% |
15,7% |
17,6% |
|
Francophones
scolarisés(H)
|
28,9% |
35,5% |
38% |
48,7% |
|
Francophones
scolarisés (F)
|
16% |
20,2% |
23,7% |
35% |
|
Ensemble
|
22,7% |
27,8% |
31,2% |
42,3 |
|
%
total des Francoph.
|
35,9% |
41,9% |
48,9%
|
59,9% |
(Accroissement du nombre des Francophones, par rapport à la population ivoirienne
de 6 ans et plus, de 1975 à 1990)
|
A partir de 1968, le gouvernement investit beaucoup dans l'enseignement primaire télévisuel qui commencera à fonctionner dès 1973, relayé sur presque tout le territoire jusque dans les petites écoles de brousse* afin d'y renforcer grâce aux télémaîtres* formés spécialement, un enseignement rénové du français parlé visant une utilisation aisée de la langue, avec des résultats encourageants. Le plus remarquable de cette diffusion du français, c'est la montée rapide de la scolarisation des filles, particulièrement dans le sud du pays, mais également, l’accroissement du nombre des femmes souhaitant apprendre à lire, à écrire et à parler français par le canal de l’alphabétisation, alors que le nombre des hommes ne semble guère progresser de 1980 à 1990. Mais ces résultats (excellents par rapport à ceux des pays voisins) peuvent sembler quelque peu décevants, compte tenu des moyens engagés. Certes, les effectifs entrant en première année du primaire sont plus importants chaque année en raison de l'explosion démographique. Ils ne représentent cependant qu'une part relativement restreinte du nombre des enfants scolarisables, pour diverses raisons : manque d'argent pour des familles incapables d'acquitter l'écolage*? préférence des musulmans pour l'école coranique? refus d'envoyer les filles à l'école? discrédit de "l'école* des Blancs" qui, au fur et à mesure que le temps passe, ne débouche plus à coup sûr sur la promotion sociale? Par ailleurs, les études semblent très sélectives et constituent un véritable "parcours du combattant" durant lequel l'échec est très douloureusement ressenti. Les scolarisés se concentrent dans les plus bas niveaux d'instruction. La déperdition scolaire au cours du primaire reste importante mais, malgré le renforcement des heures de cours de français : 15h.45 en première année de cours préparatoire et encore 11h.20 en dernière année de primaire (CM2), sur 30 h hebdomadaires de cours, l'entrée au collège pour laquelle existe un concours exigeant (car le nombre de collèges ouverts ne parvient pas à suivre la croissance démographique de la scolarisation) constitue un important goulet d'étranglement. La Commission d'Orientation qui affecte les élèves reçus au concours, en fonction de leurs résultats, à travers les différents établissements du pays, vise en fait le brassage ethnique dans l'internat et l'obligation pour les élèves de recourir au français pour l'intercommunication durant la scolarité. Elle crée ainsi cependant ce que, plus tard, on qualifiera de "tourisme scolaire" (19) et coupe plus ou moins les élèves de leur milieu originel. Quant aux enfants qui n'auront pas pu bénéficier d'un "recrutement* parallèle" faute de bras* longs, déscolarisés, par régression des acquis et effacement de toute référence à la norme scolaire, ils augmenteront le nombre des utilisateurs du FPI. et souvent aussi celui des "enfants de la rue". Mais un second goulet d'étranglement encore plus rigoureux (5,2% de déperdition en 1980, 8,9% en 1990) attend les collégiens pour l'entrée en Seconde. Or, le seuil collège / lycée marque généralement pour l'élève ivoirien le passage à l'acquisition de la pratique courante du français normé avec effacement progressif des approximations de l'interlangue. Les épreuves du baccalauréat marquent la dernière étape de l'accès à l'université mais elles sont encore plus sélectives. Le nombre des heureux élus pouvant briguer une bourse universitaire est par conséquent très restreint. L'usage local du français apparaît donc comme un continuum qui traduit certes des degrés très différents de possession, comme le montrent les diverses estimations et projections qui en ont été faites et dont nous ne citerons ici que les pourcentages (par rapport à l'ensemble de la population de 6 ans et plus) qui semblent plus parlants que les chiffres. (Direction des Statistiques, 1984), (Perrin, 1985) (20). On y considère 5 niveaux établis en fonction de la scolarité et de la moyenne des résultats constatés dans l'usage de la langue officielle. |
|
|
Niveau |
|
|
|
N1'
|
pas
de scolarité :
|
15,7% |
17,6% |
|
N1
|
4
années primaires :
|
13,1% |
14,4% |
|
N2
|
fin
primaire : lecture-écriture
simple
|
10,5% |
15,1% |
|
N3
|
1er
cycle secondaire :
|
6,1% |
9,9% |
|
N4
|
2ème
cycle secondaire :
|
0,9%
|
2% |
|
N5
|
Bac-
Etudes sup :
|
0,6% |
0,9% |
|
La longue crise des années 1980-1995, ce que le peuple appelle la "conjoncture*", a pesé lourdement sur les performances de l'éducation. Certes, le nombre des élèves du primaire est passé de 330 000 en 1963 à 1,6 million en 1995, celui des élèves du secondaire de 20 000 à 464 000. Mais, en réalité, le taux de scolarisation, en constante progression au cours des années 70, n'a cessé de régresser à la fin des années 80. Dans le tableau de la page suivante où* le taux net de scolarisation représente les effectifs d’un groupe d’âge officiel dans un degré donné d’enseignement. Il est exprimé en pourcentage de la population correspondante. Il est calculé ici pour la population âgée de 6 à 11 ans. (Institut national de la statistique cité par Afristat sur le site), on pourra constater cette baisse entre 1988 et 1998.
|
|
Taux
de scolarisation et d’alphabétisation en %
|
1988 |
1998 |
|
Taux
net de scolarisation*
|
54,6 |
48,2 |
|
Garçons
|
62,6 |
52,4 |
|
Filles
|
46,2 |
43,8 |
|
Taux
d’alphabétisation des adultes
|
35,2 |
36,3 |
|
Garçons
|
44,4 |
40,6 |
|
Femmes
|
25,9 |
28,5 |
|
On voit ici que le rythme d’accroissement scolaire n’a pas tenu ses promesses et qu’il a même fortement régressé pour les jeunes enfants en dix ans tandis qu’au contraire, le taux d’alphabétisation des adultes a connu une légère hausse, vraisemblablement en raison d’une plus grande participation des femmes. Le taux de scolarisation du secondaire, en revanche, est resté stable mais bien faible, à 22 %. De même, les résultats aux examens se sont effondrés. C'est que l'Etat n'a plus les moyens de suivre la demande de scolarisation liée au spectaculaire essor démographique. Le budget de l'éducation diminue donc sans cesse, passant de 31,4 % du budget général en 1981-94, à 18,8 % en 1994-1998. L'offre scolaire y perd en quantité (d'écoles et de maîtres) et en qualité (matériel, qualification des enseignants, etc.). L'enseignement rénové télévisuel (supprimé en 1982 car estimé trop axé sur l'apprentissage de l'oral, aux dépens de l'écrit), a été remplacé par une didactique ivoirisée de type "français langue seconde". Malgré cela, les professeurs du secondaire, presque totalement ivoiriens maintenant, déplorent une dégradation constante du français à l'école : surcharge d'effectifs (60 élèves par classe)? formation inadéquate des maîtres (Bac + 2 pour les collèges, CAPES pour les Lycées, en moyenne)? effets des crises politiques et de l'agitation sociale avec la multiplication des "années blanches*" depuis 1990? démission des parents et démotivation des étudiants devant le chômage des jeunes diplomés ? Quoiqu'il en soit, les troubles violents qui ébranlent les premières années du XXIème siècle ne peuvent qu'accroître la chute des performances du monde scolaire et donc celles de l'acquisition du français normé. Ainsi, le taux de réussite au baccalauréat, déjà bien faible à la session de 2001 : 36 %, est carrément catastrophique en 2002 : 22 %! (J.A. L'intelligent , 23-29.09.2002 : 107). Malgré la réorganisation des études supérieures à la suite de la totale saturation de l'Université d'Abidjan, on a mis en place cinq universités : (Universités autonomes d'Abidjan-Cocody, d'Abobo-Adjamé et de Bouaké, Universités régionales de Daloa et de Korogho) et une quinzaine d'établissements supérieurs. Les mêmes observations et doléances se retrouvent à ce niveau que les troubles politiques perturbent encore plus gravement que le secondaire. Il semble tout à fait clair à l'heure actuelle que, si la connaissance du français a largement progressé dans la population (c’est absolument manifeste pour le résident), ce n'est pas dans l’acquisition du français normé tant souhaité par les intellectuels, mais plutôt à cause de l'influence de la rue et de l'urbanisation. Car, plus que l'école en pleine déliquescence, c'est la rue qui peu à peu est devenue le véritable centre de "formation / création" de français véhiculaires et le lieu principal d'apprentissage. |
|
En 1991, Chaudenson (21) propose une méthode pour tracer un bilan de la situation contrastive du français à travers l'ensemble de la francophonie. Il s'appuie sur une grille d'analyse des situations linguistiques permettant, en ce qui concerne la situation singulière de chaque pays, d'établir ce qu'il appelle le « status » (: statut et fonction) du français puis le « corpus » (mode, condition d'appropriation et d'usage de la compétence linguistique). Dans ce même ouvrage, figure un bilan très succinct concernant la Côte-d’Ivoire établi par J. Kouadio N'Guessan (1991 : 112-112). R. Chaudenson y ajoute la petite note suivante : « Certaines valeurs de corpus paraissent excessives ; cf. Chapitre quatrième R.C) ». Nous allons donc reproduire ci-dessous (22) les quelques données chiffrées de notre collègue ivoirien en explicitant notre point de vue car les chiffres avancés nous semblent raisonnables, même s’il est vrai qu’ils auraient gagné à être accompagnés de quelques commentaires précisant leur signification. |
|
1. Officialité : langue officielle unique reconnue par la constitution
: 12 sur 12
2. Usages institutionnalisés : textes officiels (lois) : 4 sur 4 textes administratifs nationaux : 4 sur 4 » Certes, aucune exigence linguistique n'est requise pour exercer le droit de vote ou remplir des fonctions électives mais il est clair que ceux qui remplissent ces fonctions doivent implicitement connaître le français, compte -tenu de l'article 1 de la Constitution. Par ailleurs, la législation est souvent très explicite pour l’obligation de français dans le cas de certaines institutions : par ex. : inscription sur les listes électorales des Chambres de Commerce et d'Industrie, fonctions au sein de la Chambre d'Agriculture, etc. Enfin, tous les symboles nationaux (devise, hymne, etc.) et signes extérieurs de l'Etat et de la République ou discours officiels sont en français.
justice : 2 sur 4. Depuis la suppression des tribunaux coutumiers, il n'existe qu'une seule législation civile et, bien que cela ne soit pas expressément formulé, toutes les procédures judiciaires se déroulent en français. Seuls les citoyens sachant lire et écrire le français peuvent être jurés. Cependant un accusé de Cour d'Assise ne parlant pas la langue officielle peut faire appel à un interprète. C’est, semble-t-il, cette possibilité qui explique la quotation 2, octroyée à ce paragraphe par notre collègue.
administration locale : 4 sur 4. Depuis l'indépendance, il n'y a plus mention dans les textes législatifs de l'obligation de connaître la langue officielle pour accéder à la fonction publique. Mais le niveau minimum d'instruction requis (diplôme de fin de primaire pour les fonctionnaires de catégorie D) est en fait une exigence linguistique, toute la scolarité se faisant dans la langue officielle. Pour l'écrit, il n'existe aucune disposition législative exigeant le français pour la correspondance interne sauf dans quelques cas particuliers : le code minier, le code de santé publique, les livres de compte des commerçants, les agents d'affaires, les notaires, etc. Turcotte, déjà en 1981, (23) observait : « Les déplacements dans les bureaux de l'Administration ivoirienne permettent de constater que les fonctionnaires, autant les femmes que les hommes, s'expriment spontanément en français entre eux ou avec les administrés, peu importe qu'il s'agisse de sujets liés au travail ou de questions d'ordre strictement personnel ».
religion : 2 sur 4. C'est dans ce domaine que l'usage du français est le moins institutionnalisé : l'école coranique, les médersas et les cultes musulmans fonctionnent en arabe. Pour les chrétiens ou assimilés (religions syncrétiques), les langues locales prédominent dans l'exercice du culte. Néanmoins, le catéchisme est dispensé en français aux élèves ayant atteint le cours élémentaire et les catholiques urbanisés célèbrent la grand-messe ou divers évènements religieux dans la langue officielle.
3. Education - medium primaire : 10 sur 10 - medium secondaire : 10 sur 10 - medium supérieur : 10 sur 10 Nous l'avons vu, le français est la seule langue usitée à tous les niveaux de l'enseignement, tant comme matière que comme medium d'accès à toute autre discipline. Quelques expérimentations didactiques ont parfois tenté l'utilisation des langues locales les plus répandues. Elles n'ont pas véritablement eu de suites. Quant aux quatre langues nationales entrées à l'Université, elles constituent un objet d'enseignement à option relativement marginale, ouvert à toute personne intéressée.
4. Moyens de communication de masse
: presse écrite : 5 sur 5. Depuis l'instauration du multipartisme, la presse écrite a connu de spectaculaires bouleversements. mais elle demeure de langue française dans sa totalité. Plus de soixante-dix journaux ont vu le jour ces dernières années mais une bonne quarantaine ont disparu presque aussitôt. Fraternité-Matin, l'ancien quotidien gouvernemental déclare tirer toujours à 50 000 exemplaires, d'autres quotidiens connaissent aussi un certain succès, des quotidiens du soir comme Ivoir'Soir, des journaux de parti : La Voie (Front Populaire Ivoirien), Téré (Parti Ivoirien du Travail), Le Patriote (proche du parti d’A. Ouattara), Le Démocrate (PDCI-RDA). Le plus ancien des magazines, Ivoire-Dimanche a disparu mais d'autres hebdomadaires se développent : Notre Temps (enquêtes et dossiers ), Kabako (sports), Mousso (presse féminine), Détective , etc. Quelques publications destinées à distraire offrent des rubriques ou des bandes dessinées en « français de la rue» teinté de nouchi* : Ya Fohi ! Gbich !, voire même la colonne "Télexpress" d'Ivoir'Soir.
radio 3 : sur 5 La radio, née à Abidjan en 1960, a connu un surprenant essor ces dernières années. « Fréquence II, la station publique en modulation de fréquence, complète autour d'Abidjan, depuis 1991, la chaîne nationale, internationale et régionale. Ensemble ou à tour de rôle, ces dernières diffusent désormais vingt-quatre heures par jour en français, en anglais et en treize langues locales. » (Thiam, 1993 : 39). (24). De nouvelles radios sont apparues : Radio-Espoir (liée à Radio-Vatican), Radio Phoenix FM (partenaire de RTL), Radio Nosthalgie (filiale de Radio Montecarlo), Africa n°1, etc. Cependant, malgré cette abondance, il ne semble pas que la place accordée aux langues locales se soit véritablement étendue, sauf peut-être dans le domaine diffusé de la chanson. Il est vrai qu'une ancienne enquête ivoirienne de l'IFOP (: Institut français d'Opinion Publique) des années 1980 montrait déjà que 14 % seulement de la population enquêtée préférait des émissions en langues ivoiriennes.
télévision : 4 sur 5. La télévision a un rôle plus important qu'on pourrait le supposer. Car en 1983 déjà, 85 % des personnes interrogées (Enquête Marcomer) disaient disposer d'un téléviseur. En effet, par le biais de la télévision scolaire, la plupart des villages du pays ont été dotés d’un poste de télévision à écoute collective. La télévision a ainsi largement pénétré le monde rural. Deux chaînes publiques sont actuellement en service. La première date de 1963 et consacre une heure par jour aux informations dans les treize langues locales utilisées à la radio. Ces langues interviennent aussi éventuellement dans les émissions de variété, de vulgarisation ...ou la publicité. La seconde chaîne, Canal 2, est entièrement en français. Il en est de même pour Canal Horizons, ainsi que pour les autres chaînes privées à décodeur, seulement accessibles aux plus nantis. Les programmes diffusés sont aux trois quarts produits sur place, ce sont les préférés du grand public. Il faut donc préciser que le français de la télévision correspond généralement à des usages locaux du français, assez différents du français hexagonal, même familier. Selon une enquête déjà ancienne, (Lafage, 1983, 1-57) (25), les étudiants interrogés estiment qu’on parle mieux français à la télévision qu’à la radio (59,70 %). Cependant, ils apprécient plutôt moyennement la façon de parler français des présentateurs : (1,49% « aiment beaucoup », 40, 29% « aiment assez », 52,23% « aiment un peu », alors que 5,97% « n’aiment pas du tout » ). Des questions de même type posées récemment mais de façon informelle sembleraient souligner une évaluation plus favorable et montreraient que les performances en français à la télévision du pays sont plus en accord avec les attentes du public. Mais on pourrait interpréter cette attitude moins comme une amélioration qualitative des performances que comme une moindre exigence normative des auditeurs.
cinéma (circuit commercial) : 5 sur 5 Qu'il s'agisse des salles climatisées de haut standing, des salles dépendant des services culturels des ambassades ou des associations, des salles de quartier ou régionales, les films sont parlant français ou sous-titrés dans la langue officielle, quelle que soit leur origine : France, USA, Italie, Angleterre, Inde, Egypte, etc. Même les quelques rares films ivoiriens dans une langue du pays sont sous-titrés en français pour être intelligibles à l'extérieur du groupe ethnique concerné. Cependant la bande-son est, dans les salles populaires bon marché, d'une qualité technique approximative qui réduit son écoute et sa compréhension (la participation bruyante du public parachevant l’inintelligibilité). Il n'en reste pas moins qu'une certaine partie du vocabulaire français familier ou argotique de l'hexagone est ainsi introduit dans la communication ivoirienne populaire.
édition : 5 sur 5. Il existe depuis déjà longtemps dans le pays deux maisons d'édition : le Centre d'Edition et de Diffusion Africaine (CEDA) et les Nouvelles Editions Africaines (NEA), vouées au livre scolaire ou à la publication de quelques romans ou ouvrages ivoiriens, en français exclusivement. D'autres ont tenté de s'implanter sans beaucoup de succès. La grande majorité des ouvrages diffusés dans le pays, cependant, est importée, de France principalement ou d'autres pays francophones.
5. Secteur secondaire et tertiaire privé possibilités professionnelles ouvertes
18 sur 20 excellentes. Qu'il s'agisse des entreprises publiques du secteur secondaire ou tertiaire privé, il est évident que l'accès à l'emploi et surtout l'obtention d'une situation élevée passent par la maîtrise du français. Parler français, surtout s'il s'agit d'un français rudimentaire, cela ne suffit certes pas pour le commerce de gros ou de demi-gros, le secteur bancaire ou hôtelier par exemple, mais paraît cependant quasi indispensable parallèlement au dioula, en milieu urbain, même pour des « petite boulots » comme coiffeur, chauffeur de taxi, serveuse d'un maquis*, vendeur sur le marché, etc.(cf. N’Guessan Kouadio et als, 1992 : 111-191) (26). TOTAL : 98 total sur la base 100. : 91. Les résultats chiffrés présentés pour la Côte-d’Ivoire, quant au status, se situent à parité avec ceux du Gabon, parmi les plus élevés d’Afrique. |
|
Du point de vue du status, la langue française possède en Côte d’Ivoire une position tout à fait privilégiée par rapport aux autres langues. Néanmoins, l’évaluation des corpus et des conditions d’appropriation et d’usage de la compétence linguistique dans les diverses langues du pays montre une situation légèrement plus équilibrée.
« Acquisition (i.e. : compétence
en langue maternelle) langue
un (frcs langue mat. unique) langue
un/langue deux (frcs lang. principale. acquise en même
temps qu’une ou plusieurs autre[s] langue[s]) langue
un et 1angue deux (apprentissage simultané et équilibré
du frcs et d’une autre langue) langue
un\ langue deux (situation inverse de langue un/ langue deux) : 5 Apprentissage (i.e. : développement
d’une compétence en L2 : £ : mode d’apprentissage) £ 1(français médium du système
scolaire) : 5 £ 2(français enseigné comme
l. seconde) £ 3(pas d’enseignement en français ou du français). »
Ces estimations de Kouadio N’Guessan nous paraissent non pas surévaluées comme le suggère R. Chaudenson mais au contraire un peu faibles par rapport à la situation locale actuelle, notamment si on les compare avec les résultats fournis pour d’autres pays d’Afrique centrale dans la même partie de l’ouvrage alors que, sauf pour le Congo et le Gabon, la situation du français y est sans commune mesure avec celle de la Côte-d’Ivoire.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Queffélec, in Chaudenson, 1991 :107, ouv. cit.)
|
Certes les langues africaines, comme partout en Afrique, sont apprises généralement dans le cadre familial comme langues maternelles, spécialement dans le monde rural plus homogène. Il n’est pas rare que l’enfant issu d’un mariage interethnique apprenne la langue des deux parents ou la langue ethnique de la communauté villageoise dans laquelle il vit, parfois même, ce qui est moins fréquent, le véhiculaire régional. De même, dans les familles d’origine mandé par exemple, (autochtones ou allogènes) dont le parler maternel est proche du dioula commun ivoirien, l’enfant acquiert cette variante véhiculaire quasi-simultanément. En zone urbaine, là où le brassage ethnique est intense, la situation est plus complexe. L’enfant est conduit dans son foyer à apprendre la langue ethnique de ses parents (si c’est la même pour le père et la mère). Mais très souvent, il apprend presqu’en même temps le véhiculaire le plus usité par ses parents, et qui est quasiment imposé par l’environnement immédiat. Car, notamment dans les mégapoles comme Abidjan, pour les enfants (de couples exogames ou non), il arrive de plus en plus fréquemment que se développe en premier l’acquisition de la langue véhiculaire de la cour* commune dans laquelle sa famille co-existe avec des familles de toutes provenances, en partageant tout avec celles-ci et en n’ayant pour s’isoler que l’«entrer*-coucher» qu’elle loue. L’espace ouvert intérieur de la cour étant trop réduit pour les temps de loisir des nombreux co-habitants, la rue et bientôt le quartier finissent par être le lieu d’évasion et donc d’initiation aux deux véhiculaires populaires : le dioula tagboussi ou le français de la rue, en fonction de la prédominance des regroupements ethno-religieux du quartier, plutôt français s’il s’agit de sudistes ou de ressortissants étrangers de pays du Golfe de Guinée comme le Togo, le Bénin, le Ghana, etc, plutôt dioula s’il s’agit de nordistes ou de ressortissants de pays du Sahel ou de Guinée. Dans les cours familiales* des zones résidentielles des couches moyennes, ou les concessions* des nantis, généralement langue ethnique et français sont acquis quasiment en même temps, sauf dans le cas de familles mixtes : (européen ou étranger / ivoirien) ou d’intellectuels ivoiriens chez qui la variante parlée ordinaire de la langue officielle devient de plus en plus souvent le mode d’expression du foyer . De façon logique, c’est donc ce « français de la rue » qui semble la langue principale des groupes des Bakromen*.(Ploog, 2001) (27). Enfin, les quartiers administratifs ou commerciaux de la ville, le Plateau*, par exemple, semblent quasiment imposer l’emploi du français à leurs résidents. L’environnement extra-familial informel, s’il renforce généralement en Côte-d’Ivoire l’apprentissage quasi simultané d’une ou de plusieurs autre(s) langue(s), vernaculaire(s) régionale(s) ou véhiculaire(s), particulièrement chez les personnes appelées à beaucoup se déplacer, minore en milieu urbain les langues vernaculaires, d’usage trop restreint dans l’inter-communication, et valorise les deux véhiculaires de portée nationale, le « français de la rue » étant à son tour survalorisé par sa proximité apparente avec le français normé du monde scolaire et des élites. Cependant, les locuteurs, même ceux qui ne pratiquent que le « petit*–français » sont conscients des différences socio-linguistiques entre la variété qu’ils utilisent et le français de l’école, tant dans l’aptitude à la communication que dans les débouchés qu’ouvrent leurs utilisations respectives :
comme l’affirment les revendeuses* du marché à leurs rejetons : Pendant longtemps, l’apprentissage du français se faisait essentiellement par l’école, même si, en milieu urbain, l’enfant possèdait un peu de français véhiculaire avant d’être scolarisé. Cela n’est plus entièrement le cas. D’une part, nous l’avons vu, parce que l’école actuelle connaît de redoutables carences, que, en raison des situations précaires de leurs parents, de nombreux enfants sont très tôt déscolarisés et livrés à la rue pour s’y occuper à de petits métiers voire à la délinquance afin de survivre, d’autre part, parce que le mode de vie urbain : travail des parents, toujours absents car contraints d’effectuer de grands déplacements pour rejoindre leur emploi ou pour en chercher un, brise les liens familiaux traditionnels, déjà fragilisés par la co-existence dans un habitat regroupant dans la même cour jusqu’à une centaine de familles différentes. Qu’il s’agisse d’Ivoiriens ou d’étrangers, installés depuis peu ou de longue date, dans un tel cadre, la rupture entre les générations s’intensifie, les plus jeunes renforcent les liens avec ceux de leur âge dont ils partagent le mode de vie, les inquiétudes et les mirages, au détriment des valeurs anciennes, culturelles, morales ou religieuses. Le « français de la rue », seul médium commun, se vernacularise peu à peu, renforçant ses propres spécificités et devient, dans l’hétérogénéité urbaine, le substitut d’un parler ethnique dépassé, un signe d’identification à la nouvelle cohésion du quartier et des « bras* », le symbole d’une identité collective ivoirienne éventuelle, encore mythique dans l’agitation intense socio-politique de ces dernières années. Si donc le nombre des personnes déclarant parler français est en constante augmentation, la qualité générale de la langue officielle est déplorée par les intellectuels du pays, ce qui ne touche guère les jeunes générations, persuadées que leur français ivoirien est du français. Mais le français usité en Côte-d’Ivoire tend actuellement, à apparaître comme un système intralinguistique de parlers pour la plupart fortement régionalisés, au point qu’assez souvent, l’intercompréhension avec le reste de la francophonie est remise en question. On pourrait en prendre pour preuve le sous-titrage de la télévision française lors des reportages concernant les interviews de participants autochtones aux récents évènements du pays. C’est peut-être dans ce sens qu’il convient d’interpréter les résultats ci-dessous plutôt modérés de Kouadio N’Guessan.
vernacularitépartielle
: 1 véhicularisation urbaine étendue
: 13 rurale limitée
: 3 compétence
: 2 production langagière moyenne
: 6 exposition langagière forte : 8 TOTAL
43 sur 100 : 54.
Ces résultats situent encore une fois la Côte-d’Ivoire, en ce qui concerne le « corpus », parmi les pays africains, derrière le Congo, le Sénégal, le Gabon (55,5) et le Mali (55 ??).Ce dernier résultat étant des plus surprenants !! Nous ne reviendrons pas sur l’exposition langagière dont l’intensité dans l’environnement quotidien a déjà été démontrée supra. De toute manière, à côté des situations formelles où seul le français est possible et impose au non-francophone le recours à un interprète, il est de nombreuses situations informelles dans la communication ordinaire, dans lesquelles une variété locale de français s’intègre à des stratégies langagières de séduction (Gorce, 2002) (29), de rivalité (affirmation de sa position socio-économique privilégiée), de dissuasion (étalage de sa proximité du pouvoir) voire de parade (utilisation de termes ampoulés ou de phrases ronflantes pour provoquer l’admiration, ce que, pas toujours dupes, les Ivoiriens nomment le gros* français). Les francophones locaux les plus assurés, jouent de toute évidence à l’oral avec l’ensemble des variétés de français à leur disposition, pour s’adapter à la situation, à leur interlocuteur, au ton qu’ils entendent donner à leur propos, avec verve et créativité. (Lafage,1991) (30). C’est pourquoi il nous paraît maintenant indispensable de tenter une rapide description des spécificités linguistiques les plus visibles dans les variétés de français en présence . |
|
Le français est donc en Côte-d’Ivoire en situation de continuité intralinguistique « emboitée » car sa variété basilectale, le FPI est, comme nous le disions supra intrinsèquement un continuum dans lequel ont été classées jusqu’à ce jour des réalisations plus ou moins approximatives, allant d’un quasi sabir, jusqu’à des formes pidginisée voire créolisées. Nous opposerons donc le FPI à l’autre continuum que constituent les diverses variétés produites par les scolarisés, variétés entre lesquelles on a coutume de distinguer le basilecte, le mesolecte et l’acrolecte, même si cela ne correspond plus véritablement à grand chose dans la communication francophone ordinaire actuelle du pays. Nous essaierons de mettre succinctement en évidence quelques points de repères tentant de montrer certaines spécificités de chacune des variétés ainsi assez arbitrairement désignées mais nous chercherons surtout à en souligner les lignes d’évolution à partir des points de convergence qui aboutissent à faire de ce français abidjanais un « français avancé » dans lequel la vernacularisation pourrait déboucher sur l’autonomisation. |
|
Ainsi que nous l’avons montré (cf. 2.1.3.2), ce que l’on a appelé plus tard le « français populaire ivoirien » est la première et la plus ancienne variété de français local implanté en Côte d’Ivoire par les colons. Elle a évolué, selon toute vraisemblance, à partir du « forofifon naspa » ou « français-tiraillou » des troupiers indigènes dont Delafosse donne quelques exemples (1904 : 263-265) (31). |
|
 |
|
|
|
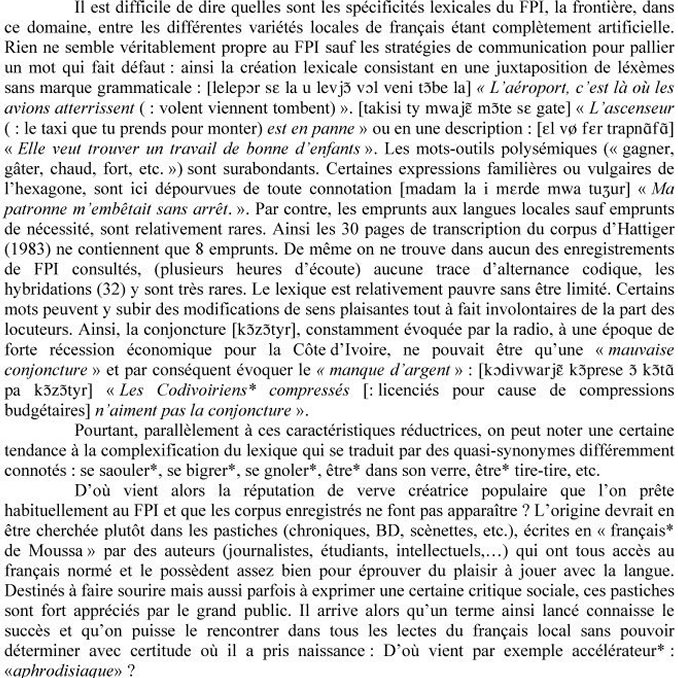 |
|
Dans une enquête à l’Université d’Abidjan, (cf. Lafage, note 25), nous avions tenté, en 1983, de sonder notre groupe d’étudiants de DUEL 2 de Lettres modernes afin de connaître leurs opinions sur le FPI. Ces opinions, dans l’ensemble étonnamment favorables pour un groupe de futurs enseignants, sont, quoique déjà lointaines, intéressantes car elles permettent de comprendre pourquoi ce parler a pu prendre peu à peu, en s’adaptant, la place qu’il occupe aujourd’hui dans le français ivoirien. Tous les étudiants, ivoiriens ou étrangers reconnaissent l’utiliser, certains : (52,23 %) « très souvent et souvent ». Beaucoup lisent les publications en FPI (très souvent : 8,95 %, souvent : 52,23 %), la grande majorité pensent « très utile ou utile »(31,34 %, 53,73 %) d’en étudier les caractéristiques en DUEL 2. Les opinions peuvent être regroupées en trois tendances : + 7, 46 % sont défavorables. Leurs positions
peuvent être résumées par cette réponse d’un
Mandé-Sud (Gouro) « C’est exagéré ! Ne pourrait-on
pas recycler le peuple ? On a l’impression au contraire que le FPI est
encouragé par l’Etat (radio, télévision, revues).
La classe dirigeante veut abîmer le peuple ! ». + 28,35 % ont des positions plus nuancées : « Il vaut mieux ce français que rien du tout ! (Kwa : Baoulé). « Le FPI n’est pas à négliger dans ce pays parce que ce qui importe, c’est le message. Si le message transmis par le locuteur est décodé par le récepteur, je n’y vois aucun inconvénient. Mais il ne faut pas l’instaurer en tant que français à enseigner à l’école ». (Kwa : Agni). + 65,67% sont favorables . Pour plusieurs raisons. D’une part, le FPI est divertissant (allusion aux textes en français de Moussa) . D’autre part, il est facile et utile comme l’exprime très clairement un Mandé-nord (Dioula) : « Le FPI me semble plus proche des réalités africaines. C’est le juste milieu sur le plan de la communication car il permet à celui qui n’est pas allé à l’école de s’exprimer et à celui qui y est allé et qui ne comprend pas son dialecte très bien, de se faire comprendre par les analphabètes. Et en même temps, il cache sa lacune linguistique [: en langue africaine] ». Mais la plupart voient dans le FPI un phénomène social : « Comprendre le FPI, c’est comprendre la classe sociale qui s’exprime de cette façon ». (Mandé-sud, Yakouba). « C’est le français du peuple. C’est celui qui réellement nous identifie et brise les barrières tribales et les particularismes. Ce français met le ministre au niveau du manœuvre et tout Ivoirien le comprend sans même l’apprendre ». (Mandé-nord, Dioula). Ces attitudes rejoignent la position d’un jeune écrivain, Kitia Touré, (Gour, Sénoufo), étudiant en maîtrise de lettres modernes et auteur d’un premier recueil de nouvelles « L’arbre et le fruit », répondant à des critiques sur son style estimé par le journaliste qui l’interroge « parfois assez proche du FPI » : « J’ai voulu traduire le langage africain, m’exprimer comme les Africains. Puisqu’il fallait écrire dans une langue véhiculaire, j’ai emprunté le français qui me sert d’outil . [.] Il faut savoir ce que l’on veut, on ne peut pas être Africain et classique à la fois ! » (Fraternité-matin, 12.03.1980). |
|
Nous ne parlerons que peu ici du « français des élites » (i.e. celui des diplômés de l’enseignement supérieur et des personnes occupant des fonctions de statut social élevé) parce que leur français diffère peu de celui de leurs homologues de l’hexagone. Nous nous contenterons seulement de noter que, plus le temps passe, plus le nombre d’Ivoiriens qui ont fait localement leurs études supérieures s’accroit, ce qui pourrait expliquer qu’un accent spécifiquement ivoirien est de plus en plus sensible, peut-être d’ailleurs parce que parler comme un Parisien (on dit ici «chocobiter*») induit désormais dans le pays une image défavorable de m’as-tu-vu ridicule. Par ailleurs, la langue châtiée locale, admet désormais en matière de lexique un certain nombre d’ « ivoirismes » de bon aloi : emprunts de nécessité (realia), créations ou glissements sémantiques correspondant à l’expression d’un univers de pensée africain, (cf. « bouche*»), expressions préférentielles estimées élégantes comme « poser* un acte ». Mais sans doute faudrait-il remarquer que même pour les élites, la norme n’est plus exogène, au contraire, par bien des côtés elle semble devenir endogène et intégrer des réalisations qu’on aurait classées autrefois dans le mésolecte. Les opinions qui se faisaient jour chez la majorité des étudiants des années 80 ont visiblement prévalu plus tard. En effet, les années 90, avec l’effervescence liée à l’amorce de démocratisation, la légalisation du multipartisme ont véritablement libéré la parole et levé les vieux interdits. Les « conférences nationales », la naissance d’une multiplicité de journaux de tous bords, l’explosion de la chanson contestataire ont véritablement provoqué une sorte d’accélération dans l’évolution de la langue française en Côte-d’Ivoire. Ce changement est même visible dans la langue littéraire. On est loin des boursouflures maintenant décriées de l’écriture d’antan. Le modèle serait plutôt un français harmonieusement africanisé « susceptible de devenir une langue littéraire, comme l’a tenté avec succès Amadou Kourouma dont la langue n’est pas plus celle des Abidjanais que des Guinéens ou des Maliens, mais un compromis littéraire qui compose avec le procédé du calque comme avec celui de la création néologique, une véritable « subversion du français » . (Prignitz, 2002, comm. pers.) (33). |
|
En fait, une variété de français semble dominer la communication quotidienne puisque l’acrolecte tend à se fondre dans le mésolecte, et que les formes basilectales plus ou moins proches du FPI se marginalisent avec le temps. C’est ce que, comme F. Gadet, nous sommes tentée d’appeler le «français ordinaire» de Côte-d’Ivoire, bien que nous entendions par là toute une gamme de niveaux différents de possession et de normalisation (liés à divers facteurs : durée des études, profession exercée, lieu de vie, durée d’urbanisation, etc., du locuteur). Car, actuellement, en milieu urbain, les situations de communication sont pratiquement isomorphes à celles que l’on pourrait rencontrer dans le milieu hexagonal équivalent. Un francophone moyen abidjanais a, en français, généralement le choix entre plusieurs modes d’expressions : langue orale surveillée, parler relâché, familier ou vulgaire, plus ou moins régionalisé, argot identitaire (nouchi, zouglou,..), voire FPI plus ou moins stéréotypé. Ce choix dépend à la fois de la personnalité que le locuteur veut endosser, des interlocuteurs auxquels il s’adresse, etc. Ce français « ordinaire » reste d’une certaine façon marqué par le FPI pour plusieurs raisons : - pour des raisons sociales : les plus cultivés sont souvent amenés à pratiquer cette variété dans les échanges quotidiens avec les peu ou non scolarisés dont c’est l’unique forme de français. - D‘autre part , au cours de leurs études, dans la cour ou à l’internat, à cause de l’hétérogéneité ethnique voulue dans les établissements, ils ont été amenés, lors des moments de détente, à pratiquer un argot estudiantin français qui repose sur des structures morpho-syntaxiques relevant en général du FPI. (Lafage, 1991 : 98, cf note 30). - Enfin, si dans le monde scolaire, la distinction entre la langue maternelle et le français est assez tôt démontrée et si les interférences sont vigoureusement combattues, par contre l’opposition entre «français parlé et écrit de l’école» et « français parlé de la rue» est rarement enseignée (l’enseignant la perçoit-il toujours clairement ?) et est, de ce fait, bien plus longue à être appréhendée par l’apprenant. C’est pourquoi en morphosyntaxe, les traits caractéristiques du FPI : problèmes de genre, de nombre, d’actualisation, de conjugaison etc. ne s’estompent que laborieusement et peuvent être rencontrés à tous les niveaux de possession. Quels sont donc les points de convergence de ce français ivoirien ordinaire ? - Du point de vue phonologique, Simard note (1994 : 90) (35) dans le parler des lettrés divers phénomènes comme une délabialisation des voyelles palatales, mais il observe surtout « un découpage de la chaîne parlée s’apparentant plus à celui de l’écrit » ce qui chez des scolarisés ayant fait l’apprentissage du français à partir du discours écrit pourrait paraître normal. Or « la prosodie du français des locuteurs non scolarisés présente, à peu de choses près, la même caractéristique ». Il constate en outre le changement de la courbe mélodique de la phrase, l’allongement très fréquent de certaines voyelles et tire de ses enregistrements de discours spontanés la conclusion que « le français de Côte d’Ivoire est une langue à ton ». Ce « morphème tonal » aurait pour traits : hauteur , durée, intensité, et serait « polysémique [car il peut] servir de modifieur à un adjectif, un noyau prédicatif, un nom ainsi qu’à différents adverbes et présentatifs » (Voir dans l’Inventaire les articles concernant : vraiment*, jamais*, voilà*, depuis*, jusqu’à*, etc.) - Du point de vue morphosyntaxique, Manessy (1994 :194) (36) avance l’hypothèse (qui paraît justifiée) d’une large convergence dans certains traits susceptibles d’être maintenus dans le parler ordinaire local, par exemple : l’expression de la comparaison, le «que*» conjonctif marque d’une parole latente ou extériorisée (: Il ment qu’il n’a pas volé), l’extension de sens pour un léxème qui « exprime une idée susceptible de multiples interprétations selon le contexte » (cf. gâter*, prêter*, pardonner*, ...), etc. Il soutient l’idée d’une sémantaxe qui traduirait des « manières africaines de voir les choses et de catégoriser l’expérience, [.] de discours élaborés selon des principes différents de ceux qui nous sont familiers. Il y a là un mode d’appropriation difficile à déceler par le locuteur mais qui manifeste l’inaptitude de la langue importée à rendre exactement compte des démarches de sa pensée ». Le niveau de la sémantaxe se situerait donc « dans les processus cognitifs qui président à la mise en forme et à l’organisation de l’information ». C’est ainsi que s’expliquerait une grande part des modifications morphosyntaxiques convergentes dans l’oralité des scolarisés ivoiriens, sans doute en raison de points de faiblesse propres au français mais aussi et surtout sous l’influence de cryptotypes communs à l’ensemble socio-culturel des langues africaines. - Du point de vue lexical, à propos du mot « vieux*» (Lafage, 1984 : 103-112) (37) dès 1984, nous avions montré les convergences entre toutes les variétés ivoiriennes de français et les divergences socio-sémantiques par rapport aux utilisations hexagonales de ce même mot. Nous n’insisterons donc pas sur cet aspect dont l’Inventaire montrera de multiples attestations. Par contre, pour expliquer l’évolution récente du lexique du français ivoirien ordinaire, il est indispensable maintenant d’évoquer l’influence du nouchi*. |
|
Le nouchi*, terme d’origine controversée, est mentionné pour la première fois dans un long article de Bernard Ahua et Alain Coulibaly paru dans Fraternité-Matin (06.09.1986 : 2-3). Il est décrit comme une langue métissée (français / langues africaines) qui serait apparue vers 1980 dans des bandes de jeunes des quartiers périphériques d’Abidjan, plus ou moins mêlés à des activités répréhensibles . Les Woya, groupe musical de François Konian auraient adopté ce parler pour les paroles de leurs « tubes » et les média en diffusant ces derniers l’auraient répandu à travers toute la jeunesse ivoirienne. La mode aidant, le nouchi aurait pris la place du FPI en l’assimilant et serait devenu emblématique pour les jeunes « qui le revendiquent en tant qu’affirmation de leur esprit créateur et de leur volonté de liberté » car ils y trouveraient « un palliatif affectif en même temps qu’un code qui peut avoir plusieurs fonctions : se faire reconnaître par les membres du clan, échapper à une autorité qu’on veut braver, revendiquer un certain talent créateur. » Ce parler, étudié et décrit
par un petit nombre de linguistes, en particulier Kouadio N’Guessan en
1990 (39) est en réalité un argot dont à l’origine
les raisons d’être n’étaient pas très différentes
de celles qui ont provoqué la vogue du verlan chez les jeunes des
quartiers défavorisés en France : volonté cryptique,
signe de reconnaissance, identification à un groupe, etc. Mais,
du point de vue linguistique, le nouchi a provoqué un phénomène
sans précédent en Côte-d’Ivoire et en pleine extension
: l’hybridation croissante des énoncés. (Lafage, 1998 :279-291) (40). Nous avons choisi d’utiliser le terme « hybridation »
plutôt que « métissage » car il ne s’agissait
plus là d’interpénétration entre deux langues déterminées.
Le corpus nouchi ne touche que le lexique (sa morphosyntaxe est celle du
français ordinaire ivoirien, largement marqué de FPI) mais
ce lexique est très clairement plurilingue, bien qu’on puisse distinguer
une certaine prédominance du dioula ivoirien véhiculaire
dans l’apport allogène du français local. Cependant l’etymon
étranger, sous sa forme d’utilisation est assez difficilement identifiable
: il peut avoir été emprunté à un des dialectes
différenciés que compte une langue et de ce fait s’écarter
sensiblement de la forme la mieux connue. De plus, en s’intégrant
au français, sa morphologie peut être profondément
altérée, d’autant plus que la grande majorité des
utilisateurs ne sont pas des locuteurs-natifs de la langue-source. Ainsi,
par exemple, « bras » ou « bra » : pote, frère,
écrit souvent à la française, est la troncation de
« baramogo* », du dioula Le nouchi est constamment en renouvellement, des
mots disparaissent, se transforment, sont remplacés par d’autres
d’une autre origine. La compréhension, malgré le peu d’innovations
syntaxiques, est loin d’être évidente d’autant que, comme
l‘ont constaté certains observateurs « le nouchi se parle
à une vitesse qui le rend pratiquement incompréhensible pour
le profane. (Krol, 1994 : 209) (41). Mais il a désormais largement
débordé le cadre des petits délinquants de banlieues
périphériques pour entrer dans ce que les jeunes eux-mêmes
nomment le « français des rues » ce qui « a
le mérite de délimiter l’espace dans lequel la variété
est parlée. Il ne s’agit pas de la langue employée dans le
cadre familial (qui est rarement le français) ni de celle employée
dans un cadre formel, mais bien d’une variété qui s’est forgée
dans le lieu où se croisent les gens les plus divers : la rue. ».
(Tschiggfrey, 1997 : 14) (42). Or cet argot est souvent revendiqué,
dans un pays multilingue et sans langue nationale prédominante,
comme « un parler franco-ivoirien, à la fois porteur d’une
certaine critique sociale, emblème contestataire d’une contre-norme
».
(Lafage, 1991 : 96 . cf. note 30). En principe, le nouchi est uniquement
d’usage oral. Il arrive néanmoins qu’actuellement un certain nombre
de termes et d’expressions en soient attestés à l’écrit,
en littérature parfois mais surtout dans la presse quotidienne .
Nous en prendrons pour exemple l’extrait suivant dont, de toute évidence,
les dialogues sont en nouchi et posent quelques problèmes de compréhension.
(Ivoir’Soir, mardi 29 juillet 1997, article de Michel Man, p . 4)
(44) :« Seul le plus grand nommé Vié* Père,
lève la tête. [.]. Il s’adresse à un des visiteurs
qu’il appelle Doum : « Doum Kèssiah ! C’est quel môguô
ça ? » Puis doucement : « C’est pas un zôguô
? » Doum essaie de le rassurer : « C’est pas un zôguô..
C’est un bras… Il veut un mide… » .[.] Doum tend un billet de
5000 F à Vié Père. Celui-ci se lève et prend
sous son vieux lit un sachet insignifiant qu’il donne à Doum. Puis
il déclare : « Pour tes togo, ce sera la prochaine fois…
». Doum se fâche : « Vié Père, donne
mon l’ar’ent ? Je ne suis pas là pour qu’un fafro krou mon pierre
! ». « Oh Kièèèè ! y sabaly
ca ! » rétorque Vié Père, « la
prochaine fois… ». On trouve dans ce bref passage des mots de
provenances variées, surtout d’origine dioula, mais transcrits de
façon fantaisiste : môguô La place prise par cet argot dans la communication et la revendication qui en est faite par les Ivoiriens sont également soulignées par l’existence actuelle sur le web d’un site (nouchi.com) consacré àl’établissement d’un dictionnaire du nouchi et largement ouvert à tout apport de vocabulaire fourni par les locuteurs. Néanmoins, c’est avec la naissance du mouvement zouglou que s’est accélérée l’invasion du français parlé ordinaire par certains mots du nouchi et l’hybridation croissante du lexique local, avec malgré tout une tendance prédominante à la fusion des deux parlers véhiculaires. |
|
Le zouglou est apparu à Abidjan au tournant des années 90 dans un climat de fortes tensions, tant à l’université que dans le pays tout entier, à l’instigation d’un groupe d’étudiants convertis à la chanson : « Les parents* du campus » (45). A l’origine, le zouglou est un syle mélodique venu de l’ouest (foyer de la contestation) qui, adapté et modernisé, est devenu une danse chantée très appréciée aux figures symboliques. « Du cadre estudiantin de départ, le mouvement se transforme rapidement en exutoire pour une génération d’exclus du système, refoulés de l’institution scolaire et du marché du travail qui prend la parole et témoigne de sa détresse, sans se départir d’un humour dévastateur ». (Tchisggfrey, n°33, 1995-2 : 72) (46). Le zouglou n’est donc pas à proprement parler une variété de langue mais il crée ce qu’on appellera bientôt le « style* Z ». Né de la chanson, il s’inspire des paroles de chansons et se répand dans toute la jeunesse par ce puissant canal médiatique. Du point de vue linguistique, il serait plutôt caractérisé par le passage continuel du standard au non-standard . On y rencontre pêle-mêle des traits relevant certes de l’oralité, sans aucune structure uniforme tant dans la morphosyntaxe qui passe du FPI au « français ordinaire » que dans le lexique qui puise aussi bien dans le nouchi que dans le lexique courant, les régionalismes les plus répandus, voire la langue recherchée. De sa naissance estudiantine, le zouglou tire son goût de la néologie (cf. lancer* le foulard, entrer*-coucher), et son humour dévastateur (cf. gouverner* , DCS* , séfonisme*). Il contribue par conséquent intensément à la naissance d’un « français des rues » qui, loin de constituer un rejet de la langue officielle importée, est dans son essence même une adaptation de celle-ci à l’expression d’un mode de pensée typiquement ivoirien et contemporain. Il se pourrait bien que s’exprime ainsi chez les jeunes, le désir profond de conforter une identité nationale encore chancelante par l’emploi d’un parler commun intégrant des mots de toutes les parlers du pays, les mêlant même pour en constituer de nouveaux et traduisant ainsi un sémantisme à leurs yeux à la fois moderne et pourtant profondément africain. Nous en donnerons un exemple, lui aussi emprunté
à la presse et qui, parce qu’il est écrit, sera bien plus
facile à comprendre que s’il était entendu dans l’oralité
quotidienne. « S’il y a un point commun entre les « parents*
» d’aujourd’hui, c’est bien leur insolence vis-à-vis des «
parentes*». Quelle que soit la cité, ils se mettent à
leur fenêtre ou devant leur porte et dès qu’une « parente
» passe, ils la sifflent ou l’interpellent grossièrement.
Au campus ils ont fait ça jusqu’ààà. Un jour
ils sont tombés sur une « go yankee* ». Une «
go », elle-même elle dit elle a « enlevé* depuis*
camarade avec la honte » . Est-ce qu’on la provoque ? Mais, comme
on ne connaît jamais « papa de chien », ils l’ont cherché
et ils l’ont trouvée. En plein midi elle les a lavés* normalement* ces insulteurs publics qui étaient tellement étonnés pour la circonstance qu’ils perdaient leur langage. Quand finalement ils se sont repris, la copine était un peu loin.[.] « Go ziguehi ! Toi tu peux effrayer qui ici, on a vu pire ailleurs. Même les « potes* de la rue » sont en drap* de nous. Espèce de fériman. ». (Ivoir’Soir, 23 avril 1998) (47). |
|
Ce français ordinaire foisonnant et hétérogène n’est évidemment pas du goût des plus âgés et des plus instruits. Les parents des familles aisées, les enseignants, tentent d’en interdire l’usage à leurs enfants, sans beaucoup de résultats, semble-t-il. Dans une enquête récente, portant sur ce que pensent et disent du français de jeunes Ivoiriennes de familles privilégiées, Gaid Corbineau (48) montre le reflet chez celles-ci de l’opinion officielle enseignée « le français, c’est pour notre culture / il faut qu’on sache+ qu’on apprenne correctement le français / on ne doit pas mélanger le français nouchi avec le français [.]. le bon français, c’est le français soutenu, je pense. (2000 : 49) le faux*-français, bon, c’est genre ce qu’on parle dans la rue entre amis- genre là le nouchi, tu vois. (2000 : 51) . Mais comment apprend-on le nouchi ? La réponse est assez surprenante « Ah à l’école ! » -« Mais à l’école t’es pas sensé// » -« Mais justement +à l’école avec les amis ». Or l’école dont il est ici question, c’est le lycée français d’Abidjan !! Il paraît donc difficile en contexte urbain d’échapper à la propagation de ce parler. D’autant plus que, malgré la réprobation
de leurs aînés, ces jeunes lycéennes, comme la plupart
des autres adolescents, si l’on en croit les divers sondages d’opinion,
revendiquent la particularité d’avoir un français unique,
spécial, ivoirisé et soulignent avec une certaine fierté
combien leur français est différent de celui des autres pays
africains. « ici on a le français soutenu et le français
nouchi + eux ils ont un seul français pour tout »,[.]
«
le nouchi, ça nous permet de nous retrouver entre Africains+ en
tant qu’Ivoirien » (55). Le « français des rues » est perçu alors comme une sorte de parler mixte qui réconcilierait les aspirations des Ivoiriens à une langue qui leur soit propre et l’ouverture sur le monde. Il apaiserait la permanente insécurité linguistique et la frustration à assouvir les besoins communicationnels que procure le français de l’école. Vers quel avenir débouchera ce phénomène où les ressources du français sont, semble-t-il, reprises et exploitées dans une restructuration relevant de la culture africaine du discours ? Il est encore trop tôt pour le pronostiquer. Il n’en reste pas moins important de tenter une description objctive d’une langue en mutation. Renforcera-t-elle sa dualité : français régionalisé / parler populaire hybride de français et de langues ivoiriennes diverses à partir du nouchi, un peu à l’imagede ce qui se passe au Québec oùle français québecois côtoie le « joual » ? A moins que le français des rues où se mêlent français et nouchi ne finisse par se fondre en une sorte de « créole » si la déliquescence actuelle du système éducatif devait perdurer. |
|
De 1972 à 1983, un vaste programme de recherches lexicales a été mené à travers un grand nombre de pays africains sous l’égide de l’AUPELF (Association des universités entièrement ou partiellement de langue française) devenue actuellement l’Agence Universitaire de la Francophonie. La collecte ivoirienne a été alors placée sous la responsabilité scientifique de Laurent Duponchel, directeur adjoint de l’Institut de Linguistique Appliquée d’Abidjan (ILA), jusqu’en juin 1975, date à laquelle ce dernier a regagné la France après avoir publié un « Dictionnaire du français de Côte d’Ivoire » (1975), première étape du travail dont il nous a confié alors la poursuite. Nous avons donc à la fois continué et complété les enquêtes ivoiriennes puis rédigé les fiches de synthèse pour les pays dont nous avions la responsabilité : Bénin, Côte d’Ivoire, Haute-Volta et Togo. L’Inventaire des particularités lexicales du français en Afrique noire (IFA) a paru en 1983 et a été réédité en 1987. Mais le terrain nous paraissait si complexe, si inépuisable et si mouvant que nous avons tenu à continuer nos recherches, dans le cadre de l’INaLF-CNRS (: Institut National de la Langue Française - Centre National de la Recherche Scientifique) lorsqu’en 1984, nous avons réintégré l’université de Paris III-Sorbonne Nouvelle. En fait, une poursuite élargie du projet IFA, au cours des années 85-90, envisageait une révision et une complémentation des travaux antérieurs afin d’opérer un regroupement complet des données africaines destinées à entrer par la suite dans l’établissement d’un Trésor Informatisé des Vocabulaires francophones (TIVF) mais il est apparu peu à peu que l’évolution de la langue française dans chacun des pays africains divergeait sensiblement d’un pays à l’autre, tout comme les troubles socio-politiques, de telle sorte que l’établissement de critères communs de sélection indispensables (comme cela avait été le cas pour l’élaboration de l’IFA) soulèverait d’assez graves problèmes et rendrait aléatoire la réalisation scientifique d’un IFA 2. C’est pourquoi, avec la collaboration de quelques étudiants de maîtrise et de doctorat (trop nombreux au fil des ans pour que nous les citions tous ici mais dont les travaux figurent dans la bibliographie finale), d’amis ivoiriens, de chercheurs de toutes disciplines, passionnés par la Côte-d’Ivoire, nous avons entrepris de constituer une banque de données lexicales ivoiriennes plus largement indépendante des critères généraux mis en place pour l’IFA et donc plus à même de coller étroitement à la réalité sociolinguistique du pays. |
|
Notre objectif premier est de décrire le lexique français contemporain utilisé en Côte d’Ivoire tel qu’il est usité par les Ivoiriens mais aussi par les non-Ivoiriens parlant du pays et contraints, de ce fait, à employer des mots locaux pour décrire certaines réalités historiques, culturelles, scientifiques, administratives ou techniques qu’il s’agisse d’emprunts à des langues locales et de néologismes français de forme ou de sens. C’est pourquoi on trouvera, dans la bibliographiedes ouvrages dépouillés, un grand nombre d’ouvrages ou d’articles spécifiques ayant trait au pays mais écrits par des étrangers. |
|
Le présent ouvrage n’a pas l’ambition de se présenter comme unvéritable dictionnaire du français de Côte d’Ivoire. Sa visée principale est de constituer une sorte de portrait du lexique français adopté et adapté par les Ivoiriens, un état des lieux actuel des spécificités d’une langue en pleine évolution. L’enquête a couvert essentiellement les vingt-cinq dernières années. Mais il arrive assez souvent qu’elle prenne en compte quelques lexies antérieures, soit parce qu’elles ont survécu en changeant de référent (cf. commandant*), soit parce qu’on les retrouve dans certaines œuvres littéraires assez récentes parlant du passé (cf. garde*-cercle). Déterminer des spécificités lexicales ivoiriennes, c’est recourir à une méthodologie différentielle, ce qui n’est pas particulièrement aisé à définir et à justifier. En effet « le corpus différentiel idéal devrait être celui qui résulterait d’une analyse contrastive entre tous les topolectes de la langue française, extensive à tous les domaines couverts par le lexique et exhaustive à l’intérieur de chacun d’eux ». (Lafage, 1997 : 88) (49). Une telle visée relève évidemment encore de l’utopie. N’ont donc été répertoriés dans l’IFCI ( : Inventaire des Particularités Lexicales du Français de Côte d’Ivoire) que les usages lexicaux locaux, absents du français de l’hexagone ou présentant des divergences par rapport à ce dernier tel qu’il apparaît non seulement dans les ouvrages descriptifs spécialisés (grammaires, dictionnaires de toutes natures : encyclopédiques, de langue, de français non conventionnel, de sport, etc.), mais encore tel qu’il est attesté dans le quotidien des locuteurs français dont les différentes usances sociolinguistiques ont servi de référence aux réalisations ivoiriennes estimées équivalentes. |
|
Il ne s’agissait aucunement dans l’IFCI de fixer une norme d’usage, ce que seules les autorités compétentes ivoiriennes sont qualifiées à effectuer. Il n’était pas davantage question d’établir une nomenclature de ce qui devait être accepté comme vocabulaire de bon aloi ou rejeté comme « faute ». Compte-tenu de la situation, il est apparu indispensable d’établir, seulement, face à une réalisation ivoirienne déterminée, quelle qu’elle soit, quelle était la réalisation habituelle hexagonale de même niveau, (domaine du discours formel, littéraire, scientifique, soutenu etc. ou usage oral quotidien, familier, argotique, relâché, etc). Pour chaque entrée de l’Inventaire, il a semblé cependant utile de porter simplement à la connaissance du lecteur un ensemble de notations sociolinguistiques appropriées indiquant les informations obtenues sur l’usage local qui en est fait, sans s’encombrer de jugements de valeur (cf. microstructure). On le voit, l’ensemble du travail est purement descriptiviste et tente de concilier l’imaginaire linguistique des locuteurs ivoiriens et la prise en compte de l’observation scientifique. |
|
Contrairement au choix adopté pour l’IFA et la plupart des inventaires publiés à ce jour, qui donnait comme visée exclusive la langue générale définie traditionnellement comme « l’usage linguistique des gens ayant atteint un certain niveau de scolarité (niveau de formation universitaire) » et prenait pour informateur-locuteur francophone type l’ « instituteur /professeur /journaliste /avocat /médecin ou tout autre représentant d’une profession intellectuelle » (Mel’Cuk /Clas /Polguère, 1995 : 43) (50), c’est-à-dire ce qui représente seulement une petite minorité des francophones nationaux, l’IFCI appuie ses enquêtes sur le français de la totalité des francophones locaux, scolarisés ou non, estimant que certaines catégories socio-professionnelles ( petits commerçants, planteurs, employés des secteurs techniques ou industriels, prestataires de service du secteur tertiaire, etc.) sont fondamentales pour l’économie nationale et jouent dans la communication, par leur nombre, un rôle non négligeable dans l’appropriation, la démocratisation ivoirienne du français et son évolution actuelle. |
|
Etant donné
la fonction officielle du français et son rôlevéhiculaire,l’enquête
a été étendue à toutes les formes de communication
potentielles, qu’il s’agisse de l’écrit littéraire, du para-littéraire,
du discours technique, de la presse, de la bande dessinée, des pastiches,
du web, en passant par l’oralité formelle (conférences, théâtre,
politique, média, etc.) ou informelle (conversations prises sur
le vif, entretiens radiodiffusés, etc). De même, aucun domaine n’a pu être exclu : de l’agriculture à l’industrie, de l’aquaculture à la foresterie, de la cuisine à la santé, de la vie traditionnelle aux activités urbaines, de la justice à la délinquance. Ce qui impliquait, évidemment, que tous les registres devaient aussi être pris en compte, du plus vulgaire au plus recherché. Car « on ne saurait réduire arbitrairement la réalité langagière aux seules manifestations de bon aloi ni prétendre qu’un locuteur francophone se limite toujours au bon français de l’école dans les échanges quotidiens avec ses compatriotes. » (Lafage, 1997 : 89, ouvr. cit. note 49). |
|
Le contexte
actuel de mondialisation et d’urbanisation en perpétuelle croissance
favorise le développement de véhiculaires appris par contact
direct, dans la rue, dans des conditions plus ou moins isomorphes, qu’il
s’agisse du verlan des banlieues françaises, du parler de Cool-Mondjers
gabonais ou du nouchi ivoirien. Mais, malgré une observation d’assez
longue durée, les informations sous l’angle diachronique ne permettent
pas encore de déterminer dans le cas de certains apports s’il s’agit
d’autre chose que de modes passagères très répandues.
Pour en vérifier la durée éventuelle, il nous paru
important de noter toutes les dates d’apparition ou de disparition d’une
lexie ainsi que tout glissement éventuel de sa signification ou
de son registre, tout effacement suivi d’une réapparition, portés
à notre connaissance, etc., car cela permettait de saisir en profondeur
les fragilités et les permanences . Parce que
la conscience de la non-exhaustivité d’un corpus de première
main était constante, nous avons également estimé
indispensable d’ouvrir largement le corpus et la sélection de données
dont la persistance pouvait sembler douteuse (sans qu’il soit possible
d’en être totalement assurée) afin d’enregistrer dans la banque
un maximum de renseignements sur l’évolution du lexique. Partant
du principe que « est pertinent non pas ce qui est a priori jugé
correct mais tout ce qui est attesté » (Berrendonner /
Le Guern / Puech, 1983 : 23) (51), nous avons adopté une perspective
polylectale et visé plutôt le « lexique linguistique
local », certes hétérogène, que le «
lexique
dictionnairique » de la langue française restreint et
idéalisé contenu dans les ouvrages de référence
usuels, (selon la distinction de D. Corbin, 1987 : 44) (52). Car nous avions
toujours à l’esprit que « le traitement différentiel
écrême la totalité de la langue, faisant disparaître
les convergences complètes entre le topolecte étudié
et le français commun de référence (ce qui en quelque
sorte
constitue ‘la partie immergée de l’iceberg’) alors que sont mises
en évidence les quelques divergences rencontrées dans
le lexique ». (Lafage, 1997 : 98, ouvr. cit. note 49). Cette recherche, vaine il est vrai, de l’exhaustivité à travers les divers domaines lexicaux du français local d’une époque donnée, provoque, nous en sommes pleinement consciente, malgré le traitement lexicographique systématiquement identique des articles de l’inventaire, un certain effet d’incohérence, sans doute inévitable, puisque, en raison de la perspective polylectale, le classement alphabétique rapproche des données de tous domaines, de tous types, de tous registres. |
|
Comment
définir une particularité lexicale ? Bien des lexicographes
s’y sont essayé sans y réussir totalement. A notre tour,
nous dirons que la particularité lexicale est un trait divergent
entre le lexique d’un topolecte particulier (ici, le français de
Côte-d’Ivoire) et le lexique du français de France servant
de référence, sous conditions de réalisations possibles
à confronter en raison de la similarité du contexte situationnel,
du domaine déterminé, du registre utilisé, des intentions
sémantiques des locuteurs, etc. + La particularité
lexicale, comme nous le verrons sur le tableau ci-après (cf. 4.3.2.)
présentant une typologie systématique des particularismes
rencontrés, peut également provenir de l’absence d’un mot
ou d’une expression dans l’un des topolectes confrontés alors qu’elle
est fréquente dans l’autre. Ainsi « engelure » n’a pas
de réalité ivoirienne, pas plus que « cécité*
des rivières » n’a de réalité française.
De même, on ne peut utiliser l’expression « manche à
balai » (personne très maigre) dans un pays où
les balais locaux n’ont pas de manche. Mais comment répertorier
une absence ? La divergence
peut aussi consister en un changement de fréquence dans l’utilisation,
une distorsion dans le sens, la forme, la graphie, la prononciation, l’emploi,
la connotation, etc. Cependant
quelques précisions préliminaires demeurent encore indispensables
: +
Ainsi, l’IFCI ne contient pas que des particularités strictement
ivoiriennes (made in Ivory Coast, oserions-nous dire). Pour des
raisons historiques, le français des colons et de l’administration
coloniale a marqué l’ensemble des pays africains relevant de l’autorité
française, si bien qu’il est même possible de percevoir encore
actuellement de légères différences lexicales entre
AOF et AEF dont la gestion a assez longtemps été séparée.
De même qu’une semi-frontière linguistique (en voie d’effacement
d’ailleurs) sépare le français des anciennes colonies belges
de celui des anciennes colonies françaises. Mais, parce que ces
barrières ne sont pas étanches, que les Africains et les
personnels français, belges, suisses ou québecois se déplacent
beaucoup, au fil du temps, de nombreuses lexies ont voyagé à
travers tous les pays dits francophones (constituant la base de ce que
l’on pourrait dénommer « français d’outremer »
par exemple). De
même, des expressions familières continuent encore à
voyager à travers l’Afrique subsaharienne. Ainsi, le terme «
deuxième* bureau » semble bien être apparu d’abord en
R.D. du Congo vers les années 60. Serait-ce une raison suffisante
pour l’exclure de l’IFCI alors qu’il est devenu usuel en Côte-d’Ivoire
depuis une trentaine d’années ? Il serait également délirant
de vouloir délimiter exactement les mots de naissance ivoirienne
et les mots de naissance burkinabé (qui seraient alors à
exclure de l’IFCI si nous adoptions une telle ségrégation)
alors que les mouvements de population entre ces deux états voisins
ont l’intensité que l’on connaît et que, de ce fait, une quantité
de particularités lexicales du français de Côte-d’Ivoire
et du Burkina sont communes. +
L’IFCI, par son volume, peut donner l’impression qu’il existe un très
grand nombre de particularismes lexicaux. Cela tient en grande partie à
la minutie de la recherche et surtout au temps que nous lui avons consacré.
Il faut cependant reconnaître, que, malgré cela, nous sommes
loin de pouvoir prétendre à l’exhaustivité. Ainsi,
l’analyse d’enregistrements effectués récemment à
Abidjan par M. Gorce (ouvr.cit. note 29) nous a montré, alors que
la mise en page de l’IFCI était terminée, un nouveau sens
d’enjailler*« aimer, plaire ». + La plupart de ces particularismes sont relativement rares dans l’usage écrit local et plus fréquents dans l’oralité quotidienne. Mais leur nombre reste lié au thème traité. Ainsi l’étude de R. Furmann (1986) (53) portant sur 8 numéros successifs du défunt Ivoire-Dimanche fait apparaître que sur un corpus de 180 000 mots, 750 seulement peuvent être considérés comme des particularités, soit 3, 78 %, et que ce taux, à y regarder de près, est tout à fait variable selon les rubriques de l’hebdomadaire. |
|
Dans le tableau ci-après (Lafage, 1976 : 130-141), nous tentons de catégoriser les trois types principaux de modifications de la lexie (usage, morphologie ou sémantique) qui aboutissent aux changements spécifiques du français déplacé en Côte-d’Ivoire. Précisons cependant que, dans bien des cas, plusieurs traits peuvent être cumulés, par ex. un changement de forme entraînant une modification du sens.
A.
Variations de l’usage. + modification de la fréquence : des termes rares ou
spécialisés en France relèvent en Côte d’Ivoire du vocabulaire commun
disponible : pian* ; onchocercose*,
etc. +
changement de distribution des parasynomymes : an*
est étendu àdes contextes généralement dévolus à année,
jour* à journée,
etc. + survivance d’états de langue : des mots vieillis
ou sortis de l’usage restent localement bien vivants : billetage*(paiement d’un salaire en espèces), accoutrement*
(vêtement), chanceux*
(soumis aux caprices de la chance), honnir*
(vilipender), etc. +
neutralisation de l’opposition des registres : belle* de nuit, d’euphémisme devient insulte (putain), un s’en
fout*- la mort est unrisque tout, etc. + modifications
d’expressions figées. Le figement est rompu par l’addition d’un élément
: ne pas avoir le gros sou*, (ne
pas avoir le sou), la fusion de deux expressions proches : demander
la main* d’une fille en mariage (demander la main d’une jeune fille / demander
une jeune fille en mariage), la suppression d’un élément : être
tiré*
(être tiré à quatre épingles), la
substitution d’un élément : baisser* les pieds
(baisser les bras), la permutation d’éléments : être
les oreilles et les yeux de qqun* (être
les yeux et les oreilles de qqun), etc. + modifications graphiques. L’orthographe du mot
est fluctuante : ceintrer*/ cintrer, cayas*
/caillasse, échis*/ équisse, (vipère à
dents de scie), ou usuellement erronée : traper* son cœur,s’accoster
à
(s’accoter à), briquettier (briquetier),
etc. + modifications d’ordre phonétique. bagas* (bagages),bandicon (venant de bande de cons compris comme bandit-con et appliqué à une seule personne), etc. |
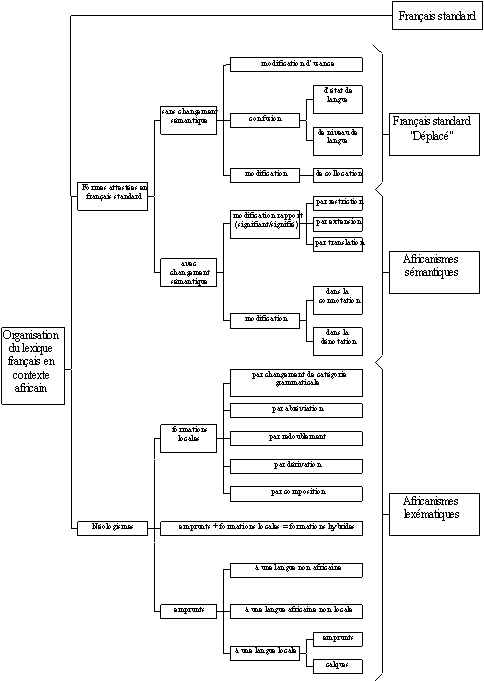 |
|
+ modifications
référentielles. Certains articles nécessitent l’ajout
de notations encyclopédiques, notamment les entrées : animisme*, dot*, masque*,danse* car
les définitions figurant dans les ouvrages de référence
sont trop « eurocentrées » pour être fidèles
aux réalités culturelles africaines. La distorsion à
éclairer peut également porter sur la forme du référé
: peigne*, ou sa fonction
:brasero*, etc.
B. Variations
sémantiques. Le mot est
attesté dans les dictionnaires de référence sans modification
de forme ou de nature grammaticale . Mais localement il subit quelques
transformations sémantiques : + restriction
de sens : ainsi, localement lunettes*
ne désigne que les lunettes de soleil par opposition aux verres
médicaux*, la piqûre*
ne peut provenir que d’un insecte et l’injection*
d’un infirmier. La graine*,
c’est la noix de palme et le charbon*du
charbon de bois. + extension
de sens. Ainsi affaires* recouvre
les significations de occupations, entreprises ; procès, disputes,
problèmes, projets, histoires, etc. Gâter
traduit toute idée de destruction : abîmer, détruire,
dilapider, désorganiser, gâcher, etc. + translation. goudron*
(route goudronnée), craie*
(profession d’enseignant dans « abandonner
la craie », dormir*
(habiter), etc. + changement
de connotation. Courte maladie*
(maladie d’origine suspecte ayant provoqué la mort), dialecte*
(langue africaine), affectation* (mutation
disciplinaire). L’araignée* devient
le symbole de la ruse et la hyène*
de la sottise, le ventre*
est le siège des sentiments. + changement
de dénotation. Un tablier*
est un marchand à l’étalage, un gros mot*,
un mot ronflant, un gendarme*,
un oiseau (Ploceus cucullatus Müller). Désormais*
prend la valeur de depuis un certain moment du passé jusqu’à
maintenant. C.Variations
lexématiques La néologie
peut naître de processus divers. + modification
de la classe grammaticale. Acharnément*,
de nom devient adverbe, façon*
devient adjectif (bizarre) ou adverbe (d’une drôle de manière), moyen*
devient un verbe (pouvoir), content*
également (aimer), etc. + d’un changement
de construction syntaxique. Préparer*
devient intransitif (faire la cuisine), de* suivi de
l’infinitif introduit une interrogative
: De sortir ? (est-ce-que
je peux sortir ?), etc. + abréviation. DCS*,
abréviation de deux chambres-salon (chauve),GVC*
(groupement à vocation coopérative) sont des siglaisons
courantes. Mais des abréviations comme po*
(policier), palu*
(paludisme), hippo*
(hippopotame) sonttout aussi
usuelles. + redoublement.
Distributif comme combien*-combien
?(combien chacun), intensificateur comme vrai*vrai (c’est
sûr et certain !), etc. + dérivation.
Processus très productif. Ainsi sur marabout*,
on trouve : maraboutal*, maraboutique*, marabouter*, maraboutage*,
maraboutisme*, démarabouter*, démaraboutage*,
etc. Préfixale, suffixale, parasynthétique, la dérivation
peut parfois être régressive : compétir*(à
partir de compétition), carent*
(à partir de carence), alphabète*
(à partir d’analphabète), etc. + composition.
Le plus productif des processus. Oiseau-trompette*
(grue couronnée), arbre* à chapelets
(sapindus saponaria Linn.), mange*-mille
(jeune fille intéressée par l’argent), tais-toi*
(billet de cent francs CFA), France au revoir
(véhicule d’occasion), taper clairon
(vider une bouteille en buvant augoulot) etc. + emprunts.
Fort nombreux et provenant de langues locales : dioula wourou
fato (littéralement chien fou
< véhicule de transport collectif), baoulé : djamo*-djamo
(salutations à des gens qui travaillent), bété
: didaga* (forme de
théâtre traditionnel), sénoufo : poro*
(étapes de l’initiation masculine) ; ou africaines non locales,
haoussa : aboki*(restaurateur
en plein vent), ou non africaines : anglais : wax*
(pagne de luxe), arabe : magrib*(quatrième
prière de la journée qui se fait au crépuscule), etc. + hybrides. bôrô*
d’enjaillement (jouissance) du
dioula « sac » + anglais « to enjoy » prendre
plaisir et suffixe français ; ndamance* :
mot valise du wolof ndama + « Abondance », race alpine (race
de bovidés de petite taille résistant à la maladie
du sommeil), zraman*
(fumeur d’«herbe»), du dioula « tabac/ herbe
» + anglais homme) , dioulakro*,
du dioula « colporteur » + baoulé kro «
village
» (quartier urbain où vivent surtout des personnes
originaires du Nord), etc. + calques. Du dioula : ne pas être à domicile* (ne pas arriver vierge au mariage), de presque toutes les langues locales : demander* la route (demander l’autorisation de se retirer), des langues akan : refroidir son cœur* (se calmer), etc. |
|
Etant donné
la durée de la collecte (près de vingt-cinq ans), celle-ci
ne peut qu’avoir été extensive (en fait, nous ne pouvons
nous empêcher de la poursuivre encore à travers les divers
documents portés à notre connaissance alors que l’IFCI est
pratiquement terminé). On trouvera dans la bibliographie finale
la liste de tous les ouvrages, articles, journaux, etc., dépouillés
ou consultés ainsi que les sites web sur la Côte d’Ivoire
le plus fréquemment visités. On pourra ainsi juger de la
diversité des domaines explorés. Mais ce n’est pas là
l’unique source de nos relevés. Il faut y ajouter l’ensemble des
enregistrements opérés (TV, radio, discours officiels ou
conversations privées,…) soit par nous au cours de nos douze années
ivoiriennes soit depuis, par des amis ou des étudiants, selon nos
directives, soit enfin par des chercheurs d’autres disciplines qui ont
accepté de nous communiquer leurs enquêtes. Tous les documents
oraux recueillis ont été accumulés et conservés
dans le but de constituer un fonds documentaire qui n’a été,
à ce jour, exploité que sous l’angle lexical. Les particularités
relevées, même si, à la longue, elles paraissaient
répétitives, ont fourni un très grand nombre d’attestations,
conservées dans la Banque de données. Mais comme il n’était
guère possible d’alourdir le volume du présent ouvrage par
une surabondance d’illustrations, nous avons restreint les contextes pour
ne retenir que ceux qui montraient la durée de vie de la lexie,
éclairaient son ou ses significations et pouvaient témoigner
de sa diffusion diachronique dans la communication locale : oralité,
puis presse, documents para littéraires, et littérature.
Il est intéressant d’ailleurs de noter que certains mots cantonnés
longtemps à l’oral, tendent à pénétrer l’écrit
ces dix dernières années. Aucune
entrée de l’IFCI n’est un hapax et la banque possèdetoujours
plusieurs illustrations de la lexie étudiée. Mais il arrive
souvent qu’un mot familier très typé : juron, insulte, formule
usuelle, etc , entre toujours dans des contextes tellement semblables qu’il
n’est pas utile d’en utiliser plusieurs comme illustrations.. De même,
tous les exemples fournis pour l’oral sont véridiques et ont été
effectivement réalisés. Cependant, nous avons été
parfois contrainte de les « toiletter », pour les réduire
à la seule séquence illustrative, et pour en ôter les
inévitables ratés (répétitions, hésitations,
autocorrections, etc.) afin d’en préserver l’intelligibilité.
Lorsque, d’ailleurs, cela s’avérait indispensable, nous avons accompagné
l’illustration d’une traduction entre parenthèses. Ceci posé,
il convient d’expliquer en quoi les critères de sélection
adoptés ont été beaucoup moins limitatifs que ceux
de l’IFA. + Ainsi
le critère de fréquence n’est pas très pertinent pour
une collecte qui ne s’en tient pas au lexique commun fondamental. Il est
tout-à-fait évident que les appellations concernant la faune,
la flore, la santé, etc., ne sont pas forcément connues du
locuteur moyen (sauf cas de dénomination populaire attestée
et parfois erronée cf. par exemple bambou*)
et se rencontrent peu hors des manuels spécialisés. Cependant,
dans un pays dont le bois est une des richesses, à l’heure où
des commission francophones de terminologie tentent d’unifier la diversité
des appellations d’un pays africain à un autre en établissant
un nom pilote unique pour le commerce du bois, il nous est apparu utile
d’effectuer plusieurs enquêtes auprès de forestiers et de
botanistes locaux, d’autant plus que nos collègues ivoiriens qui
essayaient de constituer des dictionnaires de langues du pays, nous demandaient
de les aider dans leurs efforts de traduction en français, afin
d’éviter par exemple de s’en tenir à l’identification scientifique
latine ou de crainte que l’appellation française locale courante
soit scientifiquement inadéquate. C’est pourquoi nous avons signalé
dans les articles concernant flore ou faune, chaque fois que cela a été
possible, dans la rubrique SYN. :
(: synonymie) l’équivalence de l’entrée dans quelques langues
du pays. + D’autre
part, nous avions pu constater que les appellations des domaines cités
supra (faune, flore, santé, etc.) si elles étaient présentes
dans le dictionnaire français de référence, soit y
avaient été introduites après la publication de l’IFA
dans lequel elles figuraient (et dans ce cas il s’agissait de realia impossibles
à omettre dans un lexique concernant leur propre lieu de vie), soit
fonctionnaient localement comme un générique, entraînant
une série de sous-entrées usuelles ou plus rares (cf. arbre*,
oiseau*, singe*, etc) qu’il fallait regrouper. + Placer
l’élaboration d’un inventaire dans une perspective pré-dictionnairique
nous semble, enfin, impliquer qu’il est impossible de cantonner le lexique
français en Côte-d’Ivoire à la langue courante mais
qu’il faut au contraire l’ouvrir au vocabulaire scientifique ou technique
intertropical. Ainsi, le pays a développé son agro-industrie,
d’où par exemple, la naissance à partir de « cabosse
» d’écabosser* (extraire
mécaniquement les fèves de cacao, de la cabosse), écabosseuse*, écabossage*…Il
améliore son cheptel : ndamance*, mouton*
dialonké,.. . + On l’a
vu puisque nous l’avons précisé supra, le critère
chronologique, nous a paru quelque peu aliénant dans une quête
aussi longue que la nôtre. Bien au contraire, il nous semblé
nécessaire de relever tout ce que nous rencontrions car, dans une
époque troublée où le mouvement du lexique est intense,
il est impossible de prévoir quelle sera la vie d’unelexie.
L’expérience nous a appris que des expressions rejetées en
1975 comme trop « dialectales » ou « trop récentes
», se sont depuis banalisées dans les média, voire
dans le théâtre ou le dialogue romanesque. Enfin, puisque
toutes les attestations relevées sont datées, même
celles qui proviennent de l’oralité quotidienne, cela permet pour
chaque entrée de fournir éventuellement la disponibilité
actuelle, l’attestation la plus ancienne et la plus récente, la
diffusion ou la régression polylectale, voire, pour les mots obsolètes,
la dernière apparition. Rappelons d’ailleurs que collecter une information
n’est pas l’entériner mais simplement la stocker en vue de la soumettre
à l’épreuve du temps. + Le critère
géographique n’a pas beaucoup de sens si l’on dépasse une
étroite synchronie, car les mots voyagent beaucoup. Se plaçant
à l’échelle d’un seul pays, l’IFCI ne tente pas de construire
l’histoire de la lexie. Mais il fournit un maximum d’informations locales
au linguiste qui, à travers les inventaires de plusieurs pays africains,
essaierait de le faire : origine de l’étymon, dates des attestations,
image de la dispersion polylectale éventuelle, etc. + Mais comment
vérifier la collecte ? Nous avons donc eu recours à la méthode
des « jurys » conçue par Duponchel et que nous avons
adaptée aux necessités du corpus retenu. -
Pour la langue « ordinaire », le jury est constitué
d’un échantillon aussi représentatif que possible de la population
francophone locale (personnes ayant effectué au moins le premier
cycle du secondaire et provenant de villes des diverses régions
du pays). L’unité litigieuse est présentée à
chaque membre du jury séparément, dans un contexte non éclairant.
La définition du mot proposé est alors demandée. Seuls
les items connus d’au moins la moitié des membres du jury est conservée
pour l’IFCI. -
Quant au problème délicat de l’acceptabilité des emprunts
aux langues locales, il est proposé à un second jury, constitué
de personnes non autochtones et résidant dans le pays depuis au
moins trois ans. Ainsi est vérifiée l’hypothèse d’abord
élaborée à partir du nombre d’attestations et des
marques linguistiques éventuelles (phonétique, graphique,
morpho-syntaxique, sémantique). L’accord du jury permet de conclure
à l’intégration du mot étranger dans le français
local. - Quant aux vocabulaires spécialisés, il impose le recours à des jurys spécifiques. Mais, de tout manière, une recherche comme celle que nous avons eu l’ambition de réaliser, exige une approche pluridisciplinaire, pour l’indication des ouvrages à consulter, l’établissement d’éventuelles synonymies, la vérification des identifications définitoires, etc. |
|
Fidèle
à la tradition dictionnairique (qui est d’ailleurs fort commode
pour l’aisance de consultation), l’IFCI classe ses entrées en fonction
de l’ordre alphabétique. - Dans
les cas assez nombreux où la lexie connaît plusieurs variantes
graphiques, celles-ci sont toutes indiquées par ordre de fréquence
dégressive, ce qui signifie que l’entrée citée en
tête de l’article est la plus attestée dans l’usage local.
Cependant, si les variantes diffèrent sensiblement, les autres graphies
importantes sont répertoriées dans l’Inventaire en fonction
de leurpropre classement alphabétique.
Elles sont alors suivies de leur identification grammaticale et d’un renvoi
à l’entrée de l’article principal, elles sont généralement
accompagnées d’une illustration écrite éclairante
référenciée. Ainsi l’entrée diakouadio
est suivie des variantes graphiques diékoudio, djékoudio,
djé kouadio, djé kouadjio, diékwadio, djakoidio, djakouadio,
djakouôdjo, djécouadjio, djékoudjo
puis de la totalité de l’article afférent. Par contre, quelques
pages de l’IFCI plus loin, on trouvera seulement : djekouadio,
n.m.V.
DIAKOUDIO*. Mais sa vengeance inachevée
laisse dans sa bouche un goût de piment, de djekouadio rouge, [.].
Adé Adiaffi, 2000 : 278. - Par contre, il ne nous a pas paru utile de faire un rappel de ce type lorsque les deux graphies sont orthographiquement très proches, par exemple gbass, gbas . - Pour les lexies seulement attestées à l’oral, nous avons procédé de façon à peu près identique mais en tenant compte du fait que la graphie couramment indiquée par les informateurs était l’objet d’une reconstitution orthographique le plus conforme possible au système graphique du français, ce qui reflètait certes la prononciation locale mais pouvait en camoufler l’origine. Nous avons alors choisi d’enregistrer les variantes indiquées mais de privilégier l’origine (anglaise, ici) pour l’entrée principale : cf. base, bèze, bèz. -
Comme nous utilisons fréquemment un système de renvoi quelque
peu compliqué, il faut en expliquer l’emploi : + Le renvoi V.
suivi du mot en majuscules grasses est accompagné d’un astérisque
qui, lorsqu’il s’agit d’une lexie complexe suit le segment permettant de
déduire la classification de l’entrée principale : EN*
BAS DE EN BAS > classé à
la lettreE, COURGE*-TORCHON
> classé à la lettreC,
SE SALIR LE CŒUR*, classé à
la lettreC. + Mais ce
renvoi, selon sa place dans l’article prend une valeur différente
: + Il suit
immédiatement l’identification grammaticale. Dans ce cas, il établit
entre l’entrée et une autre entrée une parenté sémantique
(synonymique, antonymique, etc.) : bangui,
n.m. V.
BANDJI*[variante dialectale]. + Il suit la définition. Dans ce cas, il établit entre l’entrée et le renvoi un lien de similarité (construction grammaticale, identité de composition morphologique, etc.). Ainsi, pour l’entrée alokodrome, après la définition, on trouvera le renvoi V. -DROME* qui signale un suffixe très créatif dans le français local. + Cependant,
lorsque l’astérisque accompagne un mot contenu dans une attestation
et qui n’est pas l’objet de l’article, cela signifie que le mot ainsi marqué
est l’objet d’un article ailleurs dans l’inventaire. -
Pour pallier l’effet arbitraire déstructurant que crée l’ordre
alphabétique, nous avons choisi de rassembler dans de très
longs articles une série de sous-entrées hiérarchisées
(classées par ordre alphabétique) de mots dérivés,
composés ou d’expressionsrelevant
du même thème : + soit parce
que le rapport entre eux est celui du générique (l’entrée
principale, par ex. : arbre), au
spécifique (42 composés, allant des sous-articles
arbre à bdellium à arbre-voyageur),
chaque arbre cité étant fort différent des autres
et généralement bien connu. + soit parce
que l’ensemble des expressions collectées relève de la perception
ivoirienne du monde, par ex. en ce qui concerne la symbolique du corps
humain. Les 24 expressions recensées successives contenant le mot bouche
sont l’objet d’autant de sous-articles permettant d’appréhender
les divergences des représentations symboliques africaines. Dans
ces conditions, casser la bouche,
figurant à sa place alphabétique (C.), ne contiendra qu’un
renvoi V. BOUCHE -8 (sous-entrée
où l’on trouvera informations sociolinguistiques, définitions
et attestations référenciées). - Toutefois, nous avons allégé les entrées très spécialisées, en rassemblant dans un seul et même article, les appellations françaises techniques désignant des espèces différentes relevant d’un même genre dont des non –spécialistes ont du mal à percevoir les subtiles distinctions : par ex : barbu*, tilapia*. + Lorsque,
pour une entrée, plusieurs sens ou plusieurs constructions sont
attestés, ceux-ci sont hiérarchisés, d’abord en fonction
du sens (sens propre puis sens figuré), puis de la nature grammaticale
: signification liée à la construction transitive d’un verbe,
puis à sa signification quand ce dernier est intransitif, ou bien
: distinction nom, puis adjectif. Une nuance de sens plus étroite
peut être indiquée par une subdivision A) et B) de l’entrée
ou de la sous-entrée concernée. + Par contre
les homonymes font l’objet d’entrées séparées et numérotées,
ex : poro (1) n.m. (de
l’abé). Arbuste (Ficus capensis Thunb), et poro
(2) n.m.(du tyembara). Initiation
masculine sénoufo . - Enfin, précisons que pour les articles de taille importante comportant un grand nombre de sous-articles, les indications concernant l’identification grammaticale et les diverses marques d’usage, sont notées une seule fois près du mot-vedette, si elles sont valables pour l’ensemble des lexies traitées dans l’article. |
|
Tous les
articles de l’Inventaire sont organisés selon une grille identique
: - l’entrée est présentée en caractères minuscules gras afin que toute accentuation puisse être représentée visiblement. Comme nous le disions supra, la forme vedette de l’entrée est suivie des variantes graphiques éventuellement rencontrées, toujours en caractères gras. Toutes les variantes graphiques mentionnées, quand elles sont rares, ne sont pas forcément illustrées dans l’article, pour ne pas alourdir inutilement le texte. Mais des attestations écritesen figurent dans la Banque de données. Lorsqu’il s’agit d’une variation fréquente et assez différemment orthographiée, elle est mentionnée à la place fixée par le classement alphabétique mais fait simplement l’objet d’un renvoi à l’article principal .caractèresdu style Chambers. Bien souvent la vedette s’accompagne d’une ou de plusieurs transcriptions lo
- la catégorie
grammaticale, notée en abrégé, en caractères
italiques, suit la transcription. Il arrive parfois que les deux genres
soient indiqués pour signaler l’instabilité locale du genre
d’un nom : palabre, n.m.ou
f. Par contre nous ne mentionnons à côté d’un nom
au masculin, la graphie d’un nom au féminin que si cette féminisation
présente une particularité cf. griot, griotte.
Il peut arriver également que le mot au féminin précède
le masculin équivalent lorsque l’emploi du féminin est beaucoup
plus fréquent dans l’usage local et présente une modification
sémantique plus marquée comme c’est le cas pour amante*.
La spécificité du nombre est précisée si la
lexie présente un emploi préférentiel au singulier
ou au pluriel : cf. funérailles,
n.f.pl.,
parfois masc., souvent sing. Tout pluriel exigeant une notation particulière
attestée est indiqué : boval,
n.m.
pl. : bové /bowé.
Quant aux adjectifs, ils ne figurent que sous la forme du masculin sauf
si la formation du féminin n’obéit pas aux règles
habituelles. Enfin, les verbes sont accompagnés de leur mode de
construction et d’éventuelles modifications de valence sont précisées.
La mention v.inv. (: invariable) signifie que la lexie, employée
localement comme verbe, ne reçoit aucune marque verbale : moyen,v.inv. - les
différentes marques d’usage viennent ensuite toujours en caractères
italiques. + La fréquence
:
Usuel
signifie que le terme est courant dans la vie quotidienne et dans tous
les milieux, Dispon. (disponible) qu’il est connu mais d’un usage
plus restreint, Spéc. (spécialisé) qu’il relève
d’un vocabulaire technique, dans ce cas il est suivi de l’indication entre
parenthèses du domaine au sens large, ex. : movingui,
n.m.
Spéc., (flore). Parfois la mention : mais fréq.
(fréquent) signifie que le mot technique est passé dans le
vocabulaire disponible commun, ex : néré, nété,
n.m. Spéc., mais fréq. (flore). Vx. ou
Vieilli signalent une lexie obsolète ou en déclin dans
l’usage. + Exceptionnellement
quand nous avons des certitudes sur le sujet, nous indiquons la date de
la dernière attestation rencontrée, comme nous donnons la
date approximative de la première apparition ou celle de la première
attestation écrite relevée, ex. : morguier,
n.m.
Dispon. (récent 1990). - L’étymologie
du mot-vedette emprunté figure ensuite entre parenthèses,
toujours en caractères italiques. La langue (ou les langues–sources
s’il s’agit d’un hybride) sont précisées, accompagnée
entre crochets de la signification du mot dans la langue d’origine, lorsque
la lexie a changé de sens en passant en français, ex : logobisseur, - Le code
n’est pas évidemment pas précisé pour les termes spécialisés,
le plus souvent attestés à l’écrit. Mais pour les
mots courants, la mention écrit ou oral indique si
la lexie est d’emploi préférentiel en langue écrite
ou dans l’oralité. L’absence de toute indication signifie qu’il
n’y a pas lieu de signaler une spécificité d’usage de l’un
ou l’autre code. - Quelques
notations
sociolinguistiques supplémentaires concernent la spécification
éventuelle d’un groupe d’utilisateurs : intellectuels
/jeunes urbanisés /tous milieux /etc. Le
type de réalisation
peut également être précisé si nécessaire
: langue recherchée /mésolecte (parler ordinaire)
/basilecte (parler spécifique des peu ou non scolarisés)
/stéréotype . Le registre est indiqué
: littéraire /familier /vulgaire /argot /etc.,
ainsi
que la connotation : mélioratif /péjoratif /plaisant
/ironique etc. Enfin, éventuellement une limitation géographique
de la diffusion peut être mentionnée. + Cependant,
précisons que le choix de la notation Usuel, entraîne
l’absence de toute autre mention sociolinguistique à l’exception
de la connotation. - La définition
est aussi brève que possible sans perdre de l’information. Le mot-vedette
est défini par une autre lexie de même catégorie grammaticale
. Nous avons aussi voulu en fournir un équivalent de même
registre en français hexagonal. Ainsi, si le mot est perçu
en Côte-d’Ivoire comme familier, argotique ou vulgaire, nous nous
sommes efforcée, dans la mesure du possible, de trouver un substitut
définitoire susceptible de produire le même effet dans l’hexagone
(mais il nous aurait sans doute fallu une meilleure connaissance de l’argot
français !!) : être moise /moisi
:
être fauché, être à sec. faux
rendez-vous : « lapin »
( : rendez-vous auquel on n’a pas l’intention de se rendre), etc. Pourtant,
pour des termes relevant de la culture traditionnelle ivoirienne, lorsque
les contextes illustratifs n’étaient pas toujours suffisants pour
éclairer un lecteur non ivoirien, nous avons jugé indispensable
d’ajouter quelques informations de type encyclopédique (cf. masque*,
fétiche*, gbasseur*, etc. - Pour les
items du domaine de la faune ou de la flore, la définition est toujours
précédée de l’appellation scientifique actuelle accompagnée
du nom de l’identificateur en abrégé et éventuellement
des identifications anciennes (notées = ). En effet, il n’est pas
toujours facile pour un non-professionnel de se retrouver dans les diverses
appellations qui se sont succédé ou qui ont coexisté
selon le pays (France, Angleterre, Allemagne par exemple), sans recourir
à un Index fixant les équivalences (quand il en existe, comme
c’est le cas de l’Index de Kew pour la flore). Ainsi filao
est défini (Casuarina equisetifolia Forst = C. littoralis Salisb.).
Lorsqu’un seul élément de la dénomination scientifique
a été modifié (généralement le nom du
précédent identificateur), l’ancienne forme est mise entre
crochets : arbre-miracle
(Leucaena glauca [Linn.] Benth = Leucaena leucocephala [Lam] de Wit). Mais
le nom de l’identificateur étant rarement mentionné dans
des ouvrages moins spécialisés que les flores ou les index,
nous n’avons pas toujours pu donner cette précision, en particulier
pour les quelques rares insectes possédant des noms populaires. - Les contextes
illustratifs sont donnés ensuite en caractères italiques
et classés par ordre chronologique, sans mention de la rubrique
d’appartenance (i.e. littérature, presse, ouvrage technique, etc)
bien que celle-ci soit soigneusement répertoriée dans la
banque de données. Mais il est apparu que, pour ne pas surcharger
le texte, il n’était pas nécessaire de préciser la
rubrique d’appartenance que l’on pouvait aisément déduire
des références qui accompagnent la citation. Ainsi l’IFCI
contient donc des attestations littéraires ( : littérature
de fiction, identifiées par le nom de l’auteur, la date de parution
de l’ouvrage et la page dont la citation est extraite, toutes les autres
informations pouvant être retrouvées dans la bibliographie
des ouvrages dépouillés), des illustrations provenant d’ouvrages
divers (histoire, ethnologie, tourisme, économie, thèses,
identifiées par le nom de l’auteur, la date de publication et la
page), ou d’ouvrages techniques (semblablement identifiés); Cependant,
pour les ouvrages scientifiques très spécialisés,
il arrive que le mot-vedette apparaisse dans des énoncés
où la plupart des termes sont très techniques et nécessiteraient
des gloses explicatives. Dans ce cas, nous ne fournissons pas d’illustration
et renvoyons simplement aux références habituelles (nom de
l’auteur, date de publication et page où figure le mot-vedette objet
de l’article). D’autres illustrations proviennent de documents variés
(bandes dessinées, dessins humoristiques, affiches, lettres circulaire
extraits de copies d’étudiants. Elles sont toujours aussi clairement
référenciées que faire se peut. Pour les enregistrements
d’émissions télévisées ou radiodiffusées,
les citations sont accompagnées du nom de l’émission, de
la date et heure de celle-ci. + Quant aux
contextes oraux, (par ex : extraits de conversations), nous les accompagnons
de la fonction du locuteur, du lieu et de l’année de l’enregistrement.
Si l’attestation provient d’un corpus qui nous a été communiqué,
nous le précisons, (par ex. pour certains extraits de chansons zouglou
: corpus Tschiggfrey). + Enfin,
pour certains contextes oraux, il nous a paru indispensable de joindre
une « traduction » complète de l’énoncé
qui, sans celle-ci, risquerait de ne pouvoir être compris. - une rubrique COM.:(Commentaire)
apporte éventuellement des éclaircissements supplémentaires,
par ex. pour l’arbre, appelé en Côte-d’Ivoire : aboudikro*,
aboudikrou,COM.:sapelli
est le nom pilote de ce bois . CTFT, 1989 : 35.Pour
le terme administratif acte* de notoriété, COM.:depuis
l’indépendance (1960), le terme semble avoir disparu de l’usage
courant au profit de « jugement supplétif ». Pour un
mot souvent d’usage basilectal : affaire*, COM.:
omission ou postposition de l’article, caractéristique du FPI, et
apparaissant même en contexte non-basilectal. Parfois réalisation
amalgamée « laffaire », etc.. - La rubrique ENCYCL.:
(encyclopédie) est réservée à d’éventuelles
informations de nature encyclopédique qu’il n’a pas été
possible d’insérer dans la définition et que les contextes
n’éclairent pas suffisamment. Ainsi à propos de 10-
acajou figuré, ENCYCL.:
parmi les bois figurés, les spécialistes distinguent les
frisés, les lamés, les mouchetés, les rubannés
; pour le plus cher, le bois drapé, il s’agit d’une loupe d’acajou
en hélice. Ou à propos d’agouti*,ENCYCL.:
le véritable agouti est un rongeur d’Amérique tropicale très
différent. L’animal local vit à l’état sauvage mais
est également parfois élevé pour sa viande. - Les rubriques DER.:
(dérivés) et COMP.:
(composés) soulignent la productivité du mot-vedette par
préfixation, suffixation, dérivation, para-synthèse
ou composition. Les léxèmes cités renvoient tous à
des entrées ou des sous-entrées distinctes et entérinent,
de ce fait, la pertinence de la sélection du mot-vedette. - LOC.: (locutions)
regroupe toutes les locutions ou syntagmes dans lesquels entre la lexie
objet de l’article. Ceux-ci également font l’objet d’une analyse
distincte dans une sous-entrée du l’article. - SYN.:
(synonymie) nécessite quelques explications. En effet, nous citons
dans cette rubrique la liste des équivalents du mot-vedette dans
le français local. Le point de vue est plus pragmatique que linguistique.
Nous nous appuyons avant tout sur la notion de mots ou expressions estimés
substituables car bien qu’ayant une forme différente, ils possèdent
une relation d’équivalence sémantique puisqu’ils peuvent
s’insérer sans en modifier le sens dans le même énoncé
que le mot-vedette. C’est dans une telle optique que, dans cette rubrique,
nous pouvons considérer comme fonctionnant comme des synonymes : + des variantes
graphiques qui pourraient ne pas être reconnues comme telles par
le lecteur. Ex.: bacosse,SYN.:
abacost*, etc, dè, SYN.:
kè*, djinamori,SYN.:
guinamori*, etc. + des variantes
dialectales ou argotiques ex.: bandji, SYN.:
bango*(argotique), bangui*, vin* de palme, etc. + mais aussi
des abréviations comme 13- banane pôyo, SYN.:
pôyo*, ceinture (2),SYN.:
poisson*-ceinture, poisson*-sabre, sabre*, bri
(nouchi), SYN.: brigander*. + voire des
impropriétés courantes dont les locuteurs ne sont pas du
tout conscients, ex. bentamarè, bantamaré, SYN.:
café* des noirs, café* nègre, casse* puante, faux*
kinkéliba, herbe* puante, kinkéliba* (impropre). De
même, nous pouvons considérer comme synonyme (parce que le
mot fonctionne comme tel) une dénomination complètement erronée
du point de vue culturel mais courante, ex.: wakasran,SYN.: blolo*-bian/
blolo* bla,époux de l’au-delà,
gens de bois, statue*-colon (impropre). + des lexies
d’emploi rare ou limités : barracuda , SYN.:
brochet* (impropre), bécune (manuels). + un pluriel
prenant la place d’un singulier lorsqu’il s’agit d’oppositions propres
à une langue locale et ignorées des autres locuteurs. Ainsi mossi (pluriel)
peut être en français local l’équivalent de moaga
(singulier) : un Mossi. + notamment
pour la faune et la flore, des lexies de langues ivoiriennes, certes inusitées
dans un contexte français mais destinées à des collègues
ivoiriens lexicographes.(cf. supra) ex. : 1- carpe blanche, SYN.:
truite* de mer, assiman (ébrié), kprékpré
(alladian), saboué (nzéma) + tous les
lexèmes cités en position de synonymes renvoient à
une entrée spécifique. Cependant pour éviter d’inutiles
répétitions définitoires, les mots possédant
de nombreux synonymes sont suivis d’un renvoi au mot le plus fréquemment
employé qui, seul , fait l’objet d’un article complet. - Quant à la rubrique antonyme, ANT. : elle n’est utilisée que pour signaler des lexies de sens opposés que le classement alphabétique ne placerait pas à côté. Ainsi abandonner la craie est l’antonyme de reprendre la craie (et vice-versa), faire contrat est localement l’antonyme de faire aboussa* ou de faire abougnon*, etc. |
|
Le présent ouvrage comporte environ 6
000 entrées (avec pour un certain nombre d’entre elles près
d’une trentaine de sous-entrées représentant de nouvelles
unités de sens, regroupées pour des motifs d’ordre sémantique.
Il en résulte quelques distorsions de l’ordre alphabétique
strict mais, croyons nous, une meilleure approche de l’appropriation locale
du français. On en prendra pour exemple l’entrée collective
des composés à partir de faux- qui range les lexies
selon deux groupes, le premier comportant le sème « porteur
d’une ressemblance pouvant induire une erreur » et contenant
un grand nombre de noms composés du domaine de la faune et de la
flore, de faux arbre à pain à faux thon, le
second contenant les sèmes péjoratifs d’« mensonge,
erreur volontaire, faux semblant, tromperie » et allant de faux
blanc à faux type . + Nous sommes, par ailleurs, consciente de l’anomalie dictionnairique que constitue un tel ouvrage. - En
effet, à le regarder de près, l’IFCI fonctionne comme un
lexique monolingue quand par ex. il présente l’article beurre*
ou
charognard* mais comme un lexique plurilingue lorsqu’il s’agit d’un
mot-vedette comme ahua*, var. ahuha, ahoya, hoia, hoya, ula,
waya, woya, n.m. Spéc. (faune). (onomatopée
visant à reproduire le cri de l’anaimal tel qu’il est perçu
en mandenkan : ahua, ahuha, ahoya, en baoulé, hoya, en ébrié,
woya, en attié, waya, en guéré, ula, etc pour désigner
le daman d’arbres) ou d’un mot relevant d’un emprunt à une langue
africaine quelle qu’elle soit (cf. matiti*), ou à
l’anglais (cf. been*-to), ou à l’arabe, cf. assalam* alekoum,
etc. - Il peut apparaître tantôt comme une sorte de dictionnaire de mots, lorsqu’il se contente de définir le mot-vedette, tantôt comme une sorte de dictionnaire encyclopédique lorsque l’article porte sur une réalité culturelle ivoirienne, qu’il faut expliquer ou préciser : interrogatoire* du mort, inceste*, post*-nom, etc. - Il se présente tantôt comme un dictionnaire d’encodage (pour les locuteurs non-ivoiriens), tantôt comme un dictionnaire de décodage (pour les lecteurs ivoiriens, voulant rendre en français hexagonal certaines réalités locales). - En outre, le critère d’intelligibilité n’est pas constant, même dans les attestations : certains termes sont accessibles d’entrée, d’autres entraîneront de sérieux risques de confusions (payer au kilo*) ou de rupture de compréhension (enlever* camarade avec la honte), même si localement ces expressions sont perçues comme françaises. - Le français de référence n’est pas non plus totalement homogène. C’est celui, contemporain, de l’hexagone (argot compris) certes, mais aussi le français de plusieurs références historiques successives : le français colonial général avec ses distinctions plus tardives (AOF et AEF, anciennes colonies belges), le français d’outremer caractéristique des pays du sud, etc. - Nous l’avons vu, aucun point de vue normatif n’est adopté, ni en ce qui concernela graphie du mot-vedette, ni pour la prononciation de celui-ci, ni en ce qui concerne son identification grammaticale, parfois bien délicate à établir, notamment quant la hauteur tonale et la durée phonétique pertinente vient modifier le statut : (ainsi, jusqu’aaa* est identifié comme adverbe puisqu’il peut permuter avec « pendant très longtemps »). - Ce travail hétéroclite, nous ne le considérons ni comme achevé car il nous a conduite à une réflexion socio-sémantique pour l’instant à l’état d’ébauche, ni comme exhaustif car bien des termes nouchi par exemple nous ont échappé. Il est vrai que nous n’avons pas souhaité faire un dictionnaire du nouchi (qui, semble-t-il, est en cours de façon artisanale sur le net) mais seulement relever les quelques termes de ce parler qui nous ont paru avoir acquis droit de cité et peuvent actuellement être rencontrés à l’écrit, dans certains dialogues familiers de romans, dans unecertaine presse ou dans l’oralité abidjanaise quotidienne des jeunes adultes, un peu comme certains mots de verlan ont fini par penétrer les plus respectés des dictionnaires normatifs du français. - En aucun cas cependant, cette collecte ne doit être prise pour une simple nomenclature amusante d’expressions imagées, même si la créativité ivoirienne fait montre parfois d’un humour féroce et d’une surprenante liberté de ton. L’appropriation locale du français dont nous portons témoignage n’est pas attestée seulement dans la langue familière, car les besoins du développement, l’extension contemporaine du français dans les divers domaines d’activités techniques, commerciales ou industrielles entraînent l’éclosion de termes peu usités certes en dehors du domaine où ils trouvent place mais qu’il serait dangereux d’écarter en raison même de leur utilité : A.M*., anti*-simulidien, coopérative* sanitaire, circuit*-lèpre (secteur médical), café* gradé, ciseau* palmiste, écabosseuse*, cacoette*, coagulat*, décocage*, (agro-industrie), brume* sèche, FIT* (météorologie), déguerpi* légal, gare* lagunaire, habitat* spontané, bidonvillisation*, durcification*, géo-béton*, (urbanisme), etc. - Fallait-il renoncer à la richesse de l’information collectée pour gagner en cohérence ? Ce qui nous a semblé important, c’était moins de trier par avance en fonction de présupposés les corpus à dépouiller, que de veiller à en accroître le nombre de façon à recueillir le plus vaste échantillonnage possible ouvrant sur un maximum d’informations, accompagnées de notations sociolinguistiques concernant l’usage, la fréquence, les lieux et contextes d’apparition, les groupes utilisateurs, les thèmes et les connotations, les collocations les plus courantes etc. Pendant plus de vingt ans, nous avons stocké, puis vérifié, affiné. Du corpus primaire que constitue la banque de données, nous avons essayé d’extraire ce qui représente ici le corpus secondaire retenu. Nous n’en ignorons pas les nombreuses imperfections. Pourtant, nous avons souhaité offrir l’IFCI au jugement du public, d’une part, nous l’avons dit, parce que le temps passant et l’âge aidant, il devenait impossible de continuer plus longtemps à jouer les Pénélope, d’autre part parce que nous avons l’espoir de susciter quelqu’interêt pour les problèmes onomasiologiques et sémasiologiques du français ivoirien et donc peut-être d’attirer critiques, conseils, idées neuves, corrections, collaborations… ou succession ! - Il faut cependant le reconnaître : nous avons passionnément aimé ce jeu de pistes et d’enquêtes dans lequel nous avons entraîné amis et étudiants, avides comme nous de mieux appréhender cet univers complexe et fascinant qu’est la Côte-d’Ivoire avec ses coutumes si variées, ses traditions millénaires, généralement ignorées du touriste de passage car c’est avec le temps qu’on les approche et qu’on peut les comprendre non seulement avec sa tête mais aussi avec son cœur, comme on dit « à chez nous pays ». Quels que soient les défauts de cette entreprise, sans doute trop ambitieuse, nous souhaitons simplement qu’elle laisse percer en filigrane le profond attachement que nous ont inspiré ce pays et ses habitants, la gratitude envers tous ceux qui ont bien voulu nous parler, nous expliquer, répondre à nos questions fastidieuses avec patience et gentillesse, pendant plus d’un quart de siècle. Puisse ce modeste travail, à eux tous dédié, parce que sans eux nous n’aurions pu le conduire jusqu’à cette publication, leur dire notre fidèle affection et notre immense reconnaissance. Et puisse la paix et l’unité revenir dans ce pays qui en offrit l’image au monde pendant si longtemps ! |
Suzanne Lafage
(1) Tous les termes marqués par * font l'objet d'un article dans les pages de l'Inventaire.
(2) Sources économiques : Caractéristiques socio-économiques de la population, Ministre Délégué auprès du premier Ministre, chargé de l'Economie, des Finances, du Commerce et du Plan, novembre 1991.
(3) Toutes les données démographiques ici citées proviennent de l'Institut National Ivoirien de la Statistique : Premiers résultats définitifs du RGPH-98, deuxième édition, janvier 2001. 30 p.
(4) Il est d'usage dans le pays, de laisser, en français, les ethnonymes invariables, faute de pouvoir utiliser la véritable opposition singulier / pluriel de la langue source. On écrit donc un Bété, des Bété, la langue bété, les traditions bété. Nous nous conformons donc à cet usage.
(5) Capitaine Binger. Du Niger au Golfe de Guinée en passant par le pays de Kong et le Mossi (1987-1889). Paris, Hachette, 1892, 2 tomes.
(6) Sources de la partie historique outre les sites web indiqués dans la bibliographie in fine : P. Biarnès. Les Français en Afrique noire, de Richelieu à Mitterand, Paris, Colin, 1987, le Bilan du Monde 1996-2001, le Dictionnaire de Géopolitique de Flammarion, les numéros 2175-2177 de J.-A. L'Intelligent. La présente introduction a été écrite en septembre / octobre 2002 alors que bien des éléments concernant les troubles ivoiriens ainsi que l’issue de ces derniers demeuraient mystérieux.
(7) Suzanne Lafage. «La Côte-d'Ivoire, une appropriation nationale du français? » in Le français dans l'espace francophone, D. de Robillard et M. Beniamino (eds.) Tome 2, Paris, Champion, 1996.
(8) Suzanne Lafage. « Esquisse des relations interlinguistiques en Côte-d'Ivoire », Bull.OFCAN n°3, 1982, Paris INalf-CNRS : 9-27.
(9) Jérémie Kouadio N'Guessan et als. « Les langues du marché en Côte-d'Ivoire ». In Louis-Jean Calvet, Les langues du marché en Afrique. Paris Didier Erudition, coll. Langues et développement. 1992, 359 p.
(10) La graphie "jula" semble être adoptée par les spécialistes des langues mandé. Pourtant nous nous en tiendrons ici à la graphie administrative usuelle qui facilite la prononciation française.
(11)
Cassian Braconnier, John Maire, Kalilou Tera. Etudes sur le mandingue
de Côte-d'Ivoire.Abidjan,
ILA/ACCT, 1983, 189 p.
(12) Kouassi Atin. « Les langues africaines, facteur de développement ». In Cahiers ivoiriens de Recherche Linguistique, Abidjan, ILA, n°3, avril 1978 : 1-82.
(13) Ouvrage déjà cité à la note 11.
(14) Gabriel Manessy. « Le français en Afrique noire : Faits et hypothèses ». In Valdman (ed.) Le français hors de France, Paris, Champion, 1979, 333-362.
(15) On en trouvera la liste quasi exhaustive dans la bibliographie finale de l'Inventaire.
(16)
Jean-Louis Hattiger. Le français populaire d'Abidjan : un cas
de pidginisation.Abidjan,
ILA,1983, 348 p.
(17) Ambroise Quéffelec. « Le français en Afrique noire ». In G. Antoine et R. Martin (éds.) Histoire de la langue française 1914-1945, Paris, INaLF, CNRS-Editions, pp.823-860.
(18)
Paul Désalmand. Histoire de l'éducation en Côte-d'Ivoire.
Des origines à la Conférence de Brazzaville. Abidjan
CEDA, 2 volumes.
(19) La plupart des élèves sont ainsi amenés à changer plusieurs fois d'établissements et donc à voyager à travers le pays, durant toute leur scolarité secondaire.
(20) Ghislaine Perrin. La langue française en Côte d'Ivoire. Paris, Commissariat Général de la langue Française, IRAF, 1985. 240 p.
(21) Robert Chaudenson (ed.). La francophonie : représentations, réalités, perspectives. Coll. Langues et développement. Université de Provence / Didier Erudition. 1991. 218 p.
(22) Les citations de Jérémie Kouadio N'Guessan reproduites ici sont en italique.
(23)
Denis Turcotte. La politique linguistique en Afrique francophone : une
étude comparative de la Côte d'Ivoire et de Madagascar.
Québec, Presses de l'Université Laval, 1981. 217
p.
(24) Augustin Thiam. « Côte d'Ivoire, les médias se démocratisent ». In Jeune Afrique, n° 1703, 26 août-1er septembre, pp. 38-40.
(25) Suzanne Lafage. « Petite enquête sur la perception du français populaire ivoirien en milieu estudiantin » In Bull. OFCAN, 4, 1983, Inalf-CNRS /Didier Erudition. pp.15-57.
(26) Jérémie Kouadio Nguessan et als, cf. note 9.
(27) Katya Ploog. « Les Bakroman abidjanais dans la dynamique de l'intégration urbaine ». Education et sociétés plurilingues. Centre Mondial d'Information sur l'Education Bilingue et Plurilingue, Aoste, 10. 2001. pp. 57-68.
(28)
« Avec le français populaire ivoirien, tu peux trouver
du travail pour avoir à manger. Avec le français des Blancs
[ : des Français, donc de l’école], tu peux faire tout
ce que tu veux ».
(29) Mathieu Gorce. L’usage du français dans le discours de séduction à Abidjan. Université de Paris III, mémoire. 2002. 240 p.
(30)Suzanne
Lafage. « L’argot des jeunes Ivoiriens, marque d’appropriation du
français ? » in Langue française : parlures argotiques.
(François-Geiger, / Goudaillier, éds.) n° 90,
1991. 91-105
(31)
Maurice Delafosse. Vocabulaires comparatifs de plus de 60 langues ou
dialectes parlés à la Côte d’Ivoire. Paris, Leroux,
1904.
(32) Au sens que nous donnons à ce terme (Lafage, 1998), c’est à dire : mot créé à partir d’étymons provenant de deux ou plus de deux langues différentes, dans un pays fortement multilingue susceptible de fournir des langues sources nombreuses. Le composé ou dérivé ainsi constitué et souvent déformé par des locuteurs qui en ignorent la provenance, appartient alors uniquement à la variété locale de français et ne peut en aucun cas être réintégré dans l’une ou l’autre des langues sources.
(33) Gisèle Prignitz . « Usages du français en Afrique noire : l’exemple du Burkina Faso ». Communication pers.
(34). Françoise Gadet. Le français ordinaire. Paris, Colin, 1989.
(35) Yves Simard, « Aspects du français de Côte d’Ivoire : prosodie et prédominance du concret. In A propos du français en Afrique ; questions de normes, Bull du centre d’Etudes de plurilinguismes (IDERIC), mars 1994 , pp 89-118.
(36) Gabriel Manessy. Le français en Afrique noire : mythe, stratégies, pratiques. Paris, l’Harmattan. 1994.
(37) Suzanne Lafage. « Note sur un processus d’appropriation socio-sémantique du français en contexte ivoirien ». In Langues et Cultures : mélanges offerts à Willy Bal, cahiers de l’Institut de Linguistique de Louvain 9, 3-4, 1984, 103-112.
(38) Suzanne Lafage. « Le rôle des médias et des intellectuels dans la transmission en Côte-d’Ivoire, signe d’une appropriation ?. in Paris, CILF. La solidarité entre le français et les langues du Tiers Monde pour le développement, 1988 : 98-113.
(39) Jérémie Kouadio N’Guessan, « Le nouchi abidjanais, naissance d’un argot ou mode linguistique passagère ? » In Gouaini / Thiam (eds.) Des langues et des villes. Paris, ACCT/ Didier Erudition, 1990, pp. : 373-383.
(40) Suzanne Lafage. « Hybridation et français des rues à Abidjan ».In Queffelec (éd.), Alternances codiques et langues parlées en Afrique, Publications de l’Université d’Aix en Provence.1998, pp.279-291.
(41) P.-A. Krol, Avoir vingt ans en Afrique. Reportage. Paris, L’Harmattan, 1994, 250 p.
(42) Thomas Tschigffrey. Zouglou : étude morphologique et syntaxique du français dans un corpus de chansons ivoiriennes. Université de Paris X-Nanterre, mémoire de DEA, 1994, 200 p.
(43) Suzanne Lafage. « Le français des rues, une variété avancée du français abidjanais ». In Faits de langue, les langues de l’Afrique subsaharienne n°11-12. Paris, Orphys, 1998, pp.134-144.
(44). Traduction approximative en hexagonal équivalent : « Doum, Qu’est ce qu’il y a ? C’est qui ce type ? »[.] « C’est pas un poulet au moins ? » « C’est pas un poulet, c’est un pote . Il veut sa dose »[.] « Pour tes jetons, ce sera la prochaine fois… »[.] « Vieux père, refile moi mes sous. je suis pas là pour qu’un couillon me barbote mon fric ! ». « Oh merde ! Laisse tomber ça ! La prochaine fois. ».
(45) C’est vraisemblablement à cause du nom que le groupe avait choisi que le terme « parent* » a pris la nouvelle signification locale d’«étudiant».
(46) Thomas Tschiggfrey. « Procédés morphologiques de néologie dans un corpus de chansons zouglou en français. » In Université de Paris X-Nanterre, Linx, n°33, 1995-2, pp 71-78.
(47) « parent/parente » : étudiant / étudiante « jusqu’ààà » : pendant très longtemps « go yankee » fille délurée « elle a enlevé camarade avec la honte »elle a cessé d’être intimidée, « depuis » depuis belle lurette. « On ne connaît jamais papa de chien » On ne peut pas savoir sur qui on tombe. « elle les a lavés normalement » elle leur a savonné les oreilles de son mieux. « go ziguehi » Eh boudin !. « potes de la rue » les poulets : les flics. « sont en drap de nous » sont au courant de ça. « feriman » pouffiasse.
(48) Gaïd Corbineau. Le français en Côte-d’Ivoire. Le parler de deux jeunes Ivoiriennes : ce qu’elles pensent de la langue, ce qu’elles disent. Université de Paris X –Nanterre, mémoire, 2000. 200 p.
(49) Suzanne Lafage. « Extensivité et cohérence : de quelques principes apparemment contradictoires dans la constitution d’un corpus lexicographique différentiel ». In Frey et Latin (eds.) Le corpus lexicographique, Louvain-la-neuve, de Boeck/Lastier, 1997, pp. 87-100.
(50) I. Mel’Cuk, A, Clas, A. Polguère. Introduction à la lexicologie explicative et combinatoire . Louvain-la-Neuve, Duculot/ AUPELF-UREF, 1995. 255 p.
(51) A. Berrendonner, M. Le Guern, G. Puech. Principes de grammaire polylectale. Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1983, 272 p.
(52) Danielle Corbin, Morphologie dérivationnelle et structuration du lexique. Lille, Presses de l’Université de Lille.1987.
(53) René Furhmann. Etude sociolinguistique d'un hebdomadaire ivoirien « Ivoire-Dimanche ». Paris III -Sorbonne nouvelle, mémoire de maîtrise, 1986 259 p.
(54)
Suzanne Lafage « Le dictionnaire des particularités lexicales
au Togo et au Bénin ». Annales de l’Université d’Abidjan,
série H (Linguistique). t.x.,1976 , pp 130-141
SIGNES
ET ABREVIATIONS UTILISES
*
symbole de renvoi placé après toute lexie faisant l'objet
d'une entrée distincte.
[
] élément supprimé ou facultatif.
[.]
coupure dans la citation.
[
] encadre la transcription phonétique.
(
)encadre l'origine de la lexie ou son mode de formation.
abrév.abréviation.
adj.adjectif.
adv.adverbe.
ANTON.:antonyme.
aux.auxiliaire.
Cf.confer.
COM.:commentaire.
COMP.:composé.
compl.complément.
conj.conjonction,
conjonctif(ve).
connot.
connotation.
dém.démonstratif.
DER.:dérivé,
dérivation.
dir.direct.
Dispon.disponible.
ENCYCL.:encyclopédie,
encyclopédique.
exclam.exclamation,
exclamatif.
ex.
exemple.
f.féminin.
fam.familier.
fréq.fréquent.
Hist.histoire,
historique.
IFA.Inventaire
des particularités du français en Afrique noire.
IFCI.
Inventaire des particularités du français en Côte-d'Ivoire.
impers.impersonnel.
impr.impropre.
indéf.indéfini.
indir.indirect.
inf.infinitif.
interj.
interjection.
interr.interrogation,
interrogatif.
intr.intransitif.
inv.invariable.
iron.ironique.
l.
langue.
l.loc.langue
locale.
LOC.:
locution.
m.masculin.
mélior.mélioratif.
n.nom.
nom.nominal(e).
part.partiel,
partiellement.
péj.péjoratif.
pers.personnel.
pl.pluriel.
pop.populaire.
poss.
possessif.
prép.préposition.
pron.
pronom.
pronom.pronominal.
qqch.quelque
chose.
qqn.quelqu'un.
sing.
singulier.
spéc.spécialisé
spécialt.spécialement.
sub.
subordonnée, subordination.
SYN.:synonyme.
tjrs.toujours.
tr.
transitif.
v.verbe.
V.
se reporter à
verb.verbal(e).
vulg.vulgaire.
vx.vieux.